|
la  obilisation obilisation
|
Nous sommes au 31 du mois de juillet 1914.
C'est le dernier jour de classe de l'année scolaire.
Le petit village de St Léger, généralement
paisible - sauf les jours de foire et les jours d'élections -
est très agité. Des groupes d'hommes se forment. C'est
que le bruit court que la mobilisation générale est
ordonnée. On parle de la guerre qui va devenir
inévitable. Déjà certaines catégories
d'hommes mobilisables ont reçu des ordres d'appels individuels
et ont rejoint ou vont aller rejoindre immédiatement leurs
dépôts.
L'anxiété est sur tous les visages, l'angoisse
étreint les cœurs.
Vers quatre heures du soir, une automobile venue du chef-lieu de
canton s'arrête devant la mairie... Un gendarme descend de la
voiture et se dirige à la mairie. Il apporte de larges
enveloppes cachetées contenant les affiches ordonnant la
mobilisation générale. Le maire est absent de la
commune. Je suis à la mairie, en ma qualité
d'instituteur-secrétaire ; j'inscris sur les affiches les
indications nécessaires et j'envoie chercher le
garde-champêtre. Celui-ci arrive sans se presser et, apercevant
le tas d'affiches qu'il doit placarder, s'écrie d'un ton de
mauvaise humeur : "C'est samedi, aujourd'hui ! Il faut que je "rase
!" - car le garde-champêtre est aussi charron, épicier
et perruquier - J'afficherai quand j'aurai le temps !"
La perspective de la guerre ne l'émeut guère - est-ce
inconscience ou bêtise ? - et j'ai toutes les peines du monde
à le convaincre que l'heure est grave, qu'il doit placarder
ses affiches immédiatement, et qu'il rasera ses clients une
autre fois. Il s'en va en grommelant, ses affiches sous le bras.
Le tocsin sonne à l'église du village. C'est la voix
grave de la Patrie en danger qui appelle ses enfants pour aller
combattre pour la défense du Droit.
|
Eugène
écrit : "Nous sommes au 31 du mois de juillet
1914. C'est le dernier jour de classe de l'année
scolaire."
Cette date correspond cette année-là à
un vendredi.
"(...) le garde-champêtre, (...) apercevant le tas
d'affiches qu'il doit placarder, s'écrie d'un ton de
mauvaise humeur : "C'est samedi, aujourd'hui !"
Il y a sûrement une erreur de date de la part
d'Eugène : ce doit bien être le samedi 1er
août.
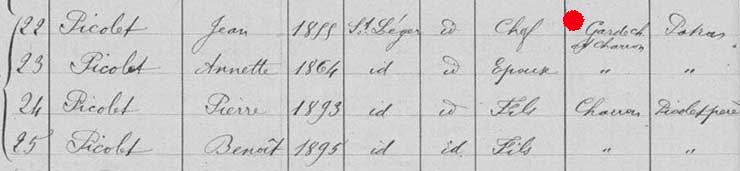
Né le 29
novembre 1855 à Saint Léger, le
garde-champêtre (et charron) Jean Picolet
a presque 59 ans à la déclaration de guerre.
Il est toujours en fonction en 1918.
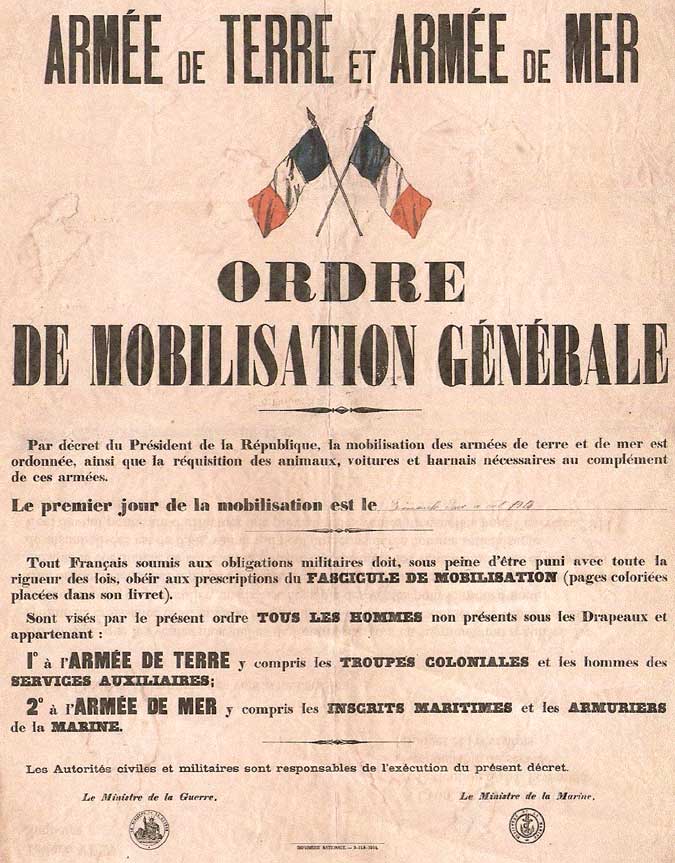
La date manuscrite est
le dimanche deux août 1914.
note historique
émise par la Mission du Centenaire de la
Première Guerre mondiale
29 juillet 2014
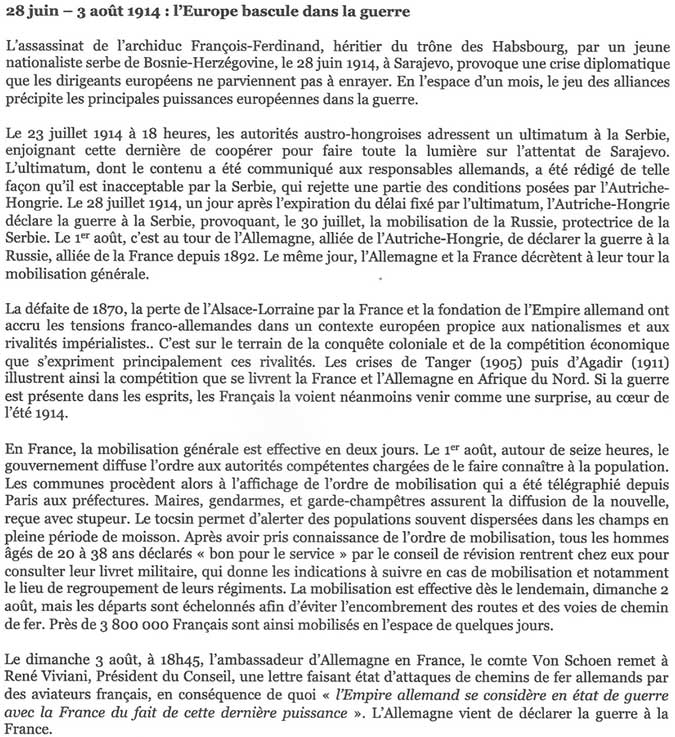

la
Grande Guerre vue par Thérèse
Bisch
|
|
le  épart épart
|
Les affiches de mobilisation terminées,
je fais mes préparatifs de départ. Je ne crois pas
à la guerre, ou plutôt je feins de ne pas y croire. Je
suppose que mon absence peut durer huit jours, quinze jours au plus.
Je me dis que les peuples ont intérêt à
s'arranger à l'amiable. On ne peut jeter ainsi les peuples les
uns contre les autres, sous prétexte qu'il y a des assassins
en Serbie. La France fera toutes les concessions non contraires
à l'honneur. Mais l'Empereur d'Allemagne et son complice, le
vieil empereur d'Autriche, voulaient la guerre. La catastrophe
était inévitable.
Avant mon départ, je conseille à ma femme, si je ne
suis pas rentré en octobre - il faut tout prévoir - de
prendre mes grands garçons et de ne faire qu'une seule classe
avec ses grandes filles (ma femme est institutrice). Quant aux petits
garçons et aux petites filles, ils iront dans la classe de
l'adjointe. On renverra, si l'administration académique n'y
voit pas d'inconvénients, tous les élèves
au-dessous de cinq ans, et il y aura ainsi deux classes au lieu de
trois. On fera l'économie d'une intérimaire.
Ma femme va avoir fort affaire en mon absence. En plus de son
rôle de mère de famille (nous avons trois enfants) et
d'institutrice, elle remplira à ma place les fonctions de
secrétaire de mairie. De plus, elle dirige un patronage de
jeunes filles assez important.
J'aurais voulu voir le maire avant mon départ. Sa
présence aurait été utile - en raison de la
situation - à la tête de sa commune. Comme
j'étais secrétaire-trésorier d'œuvres
agricoles (mutuelle-bétail, mutuelle-incendie, etc), j'aurais
prié le maire de se charger de ce travail ou de charger les
sociétaires restants de s'en occuper. J'avais
créé ces mutuelles ; je les administrais, comme
secrétaire-trésorier, gratuitement, mais je ne pouvais
laisser tout ce travail à ma femme. Aussi je résolus,
si la guerre devait avoir lieu, d'adresser ma démission au
maire pour lui faciliter le choix de mon successeur...
lire
à ce sujet
|
Après avoir pensé à mon
école et aux œuvres mutuelles, je pensai à moi. Je
fis mes préparatifs, passai avec ma femme et mes enfants la
dernière veillée avant mon départ. Je ne dormis
guère la nuit...
Et le lendemain matin, après avoir embrassé longuement
ma femme et mes trois enfants, je pris le chemin de la gare où
je devais m'embarquer... avec le secret espoir d'être de retour
bientôt.
|
|
remplacement
de l'instituteur
|
" Extrait
du registre des délibérations du Conseil
municipal de St Léger s/s la Bussière
:
l'an mil neuf cent quatorze et le vingt quatre du mois de
septembre, le conseil municipal de la commune de St
Léger s/s la Bussière, réuni au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Mr Vivier, adjoint ;
Étaient présents MM. Vivier, adjoint ; Lardy,
Laffay. A, Pehu, Berard, Philibert, Desroches, Pardon Claude
François.
Le Conseil, sur la
proposition de Mr Vivier, adjoint,
Vu la demande de Mr l'Inspecteur primaire de Mâcon,
transmise par Mme Perrussot, institutrice ; décide
que l'institutrice ; pendant l'absence de son mari,
instituteur mobilisé ; fera l'école aux cours
moyens des garçons et des filles ; et l'adjointe
aux cours élémentaires et
préparatoires.
Cela pendant la durée de la guerre si
l'administration ne nomme pas de suppléant à
l'école des garçons. Ainsi fait et
délibéré le 24 7bre 1914"
Source
: 3 T 273 dossier écoles communales - St
Léger sous la Bussière - Archives
départementales de Saône et Loire
|
|
les  artouches artouches
|
Je suis parti le dimanche 2
août pour rejoindre mon dépôt.
Dès le lundi (et pendant plusieurs jours de suite), je suis
chargé de préparer l'habillement, l'équipement
pour recevoir les hommes de la compagnie territoriale à
laquelle j'appartiens.
Mon bataillon sera cantonné dans un vaste immeuble à
deux kilomètres de la ville.
Je reçois l'ordre d'aller "toucher" les cartouches pour le
bataillon. Où doit-on aller "toucher" ces cartouches ?
L'ordre ne le dit pas. Je pars avec plusieurs voitures
réquisitionnées et j'arrive à la caserne
X...
Je demande à l'adjudant de service où se trouve le
local où l'on délivre les cartouches. Il me
répond : "Ce n'est certainement pas ici ! Ce doit être,
sans doute, à l'arsenal." Cette réponse paraît
logique.
Avec les voitures, je vais à l'arsenal. Là, le sergent
me dit : "Ici, nous avons les fusils, les armes, mais pas de
cartouches. Allez à la caserne Y : c'est là que vous
toucherez les cartouches."
Je pars à la caserne Y avec toutes mes voitures. Il n'y a
aucun gradé au poste de garde. Le sergent est allé
dîner tranquillement à la popote des sous-officiers.
J'aperçois un clairon suspendu à un clou dans le corps
de garde et je lance, dans la cour du quartier, la sonnerie : "Au
sergent !" Le gradé s'amène en courant et je lui pose
la sempiternelle question : "Savez-vous où l'on distribue les
cartouches ? - Je sais bien, répond le sergent, que les
cartouches pour le régiment actif étaient ici, mais
j'ignore si celles destinées au régiment territorial y
sont aussi... Attendez, je vais m'informer..." Il va questionner un
casernier qui demeure à quelques pas de la caserne Y, dans les
locaux militaires. Réponse : Les cartouches se distribuent
à la caserne X, c'est-à-dire la première
où nous sommes déjà allés, et où
nous retournons après avoir déambulé par toute
la ville.
En effet, malgré l'affirmation contraire de l'adjudant de
service (le seul gradé qui restât dans cette caserne,
car le régiment actif était parti la veille)
c'était dans la caserne X que se trouvaient les cartouches
réservées à notre régiment.
Cette anecdote prouve que le gradé doit toujours donner des
ordres complets et précis à ses
inférieurs.
|
un  iffleur
opportun iffleur
opportun
|
J'ai un billet de logement pour M. X,
pharmacien. Mais le potard tombe des nues. "Il n'a jamais vu
ça" dit-il !. Bref, il m'envoie à l'hôtel
où je logerai à ses frais. Mais l'hôtel est
bondé. Il n'y a plus de chambres, plus de lits... Heureusement
qu'un camarade a pitié de mon infortune. "J'ai une chambre
à deux lits ; je vous cède un lit si vous le voulez
!"
J'accepte avec reconnaissance, passe ainsi une bonne nuit. Mais le
lendemain matin, mon camarade me dit : "Je n'ai pu fermer l'œil
de la nuit. Vous avez ronflé comme un pompier !"
J'étais navré de l'aventure, car voilà un brave
type qui m'offre une place dans sa chambre et que j'empêche de
dormir par mes ronflements ! C'est le comble ! Aussi je me promis
bien de remédier à mon infirmité, et la nuit
suivante, au risque d'étouffer, j'attachai un mouchoir autour
de la tête afin de m'envelopper le nez. "De cette façon,
me disais-je, si je ronfle, ça ne pourra être qu'un
ronflement anodin, un ronflement atténué, incapable
d'empêcher quelqu'un de dormir !"
Sur cette assurance, que je fis partager à mon camarade, je
m'endormis avec l'idée, qui m'obséda toute la nuit, que
je ne ronflais pas... Même, je perçus très
distinctement et à plusieurs reprises des coups de sifflet
prolongés, lancés par mon camarade... et dans une sorte
de demi-rêve, je me disais : "Ah ! elle est forte,
celle-là ! Ce cochon-là dit que je ronfle, et c'est lui
qui siffle ! Qu'il vienne me raconter ses boniments demain matin
!"
Ma conscience tranquille, j'enlevai le mouchoir qui me gênait -
on était au mois d'août ! - et ne me réveillai
que le lendemain matin, après avoir dormi une bonne nuit. Mes
premières paroles furent : "Vous avez joliment sifflé
cette nuit !" et mon camarade de répondre : "J'ai
sifflé pour vous empêcher de ronfler ; vous faisiez
joliment du tapage ! Je n'ai pu fermer l'œil de la nuit !" Et
mon infortuné camarade en fut réduit à chercher
un gîte quelque part, je ne sais où, où il put
dormir tranquille.
Quant au potard, sommé de payer le prix de la chambre, il
refusa, sous prétexte qu'il avait déjà
donné de l'argent pour une souscription en faveur des
militaires...
J'eus donc à payer ma chambre à l'hôtel.
J'avoue que j'ai très peu rencontré de potard de ce
calibre dans mon existence.
|
 remières
nouvelles remières
nouvelles
|
|

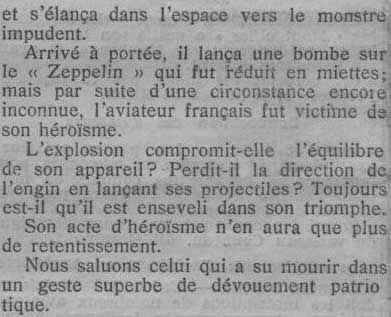
fausse mort de
Garros - L'Echo d'Alger du 3 août 1914

fausse mort de
Garros - Ouest Eclair du 3 août 1914
Pour info : l'aviateur
en question est vraiment mort le 5 octobre 1918.
|
Une grande affiche est apposée dans la
vitrine de la salle des dépêches. L'aviateur en renom,
X, avec son avion a abattu un zeppelin qui survolait notre territoire
et a trouvé une mort glorieuse dans ce combat
inégal.
Chacun commente cette nouvelle. Le sacrifice de X est trouvé
sublime ; l'enthousiasme est à son comble !
Un officier, les larmes aux yeux, explique à la foule qui se
presse devant l'affiche : "J'arrive de Paris... Je viens de quitter
l'aviateur X qui est mon ami. Et il m'a confié, il y a deux
jours à peine, qu'il descendrait le premier zeppelin qui
viendrait en France ; il lancerait son avion à toute vitesse
dans le monstre. Il y trouverait la mort, certainement, mais il
détruirait le zeppelin avec son équipage ! Je vois
qu'il a tenu sa parole !"
Donc, la nouvelle était vraie... Il n'y avait pas de doute
possible puisque l'aviateur... avait annoncé à cet
officier ici présent qu'il accomplirait l'exploit dont il
devait mourir...
Le lendemain on apprenait que la nouvelle était fausse.
Et alors, que deviennent donc les affirmations du lieutenant
?
|
 remier
prisonnier remier
prisonnier
|
Le lieutenant X est affecté à ma
Cie et je l'accompagne en ville. Nous allons dans un bazar pour
acheter divers ustensiles nécessaires quand on part en
campagne : assiette en fer blanc, cuiller, fourchette, gobelet,
etc.
Un pauvre hère est dans la bazar : il se présente tout
intimidé au lieutenant, en lui montrant un papier crasseux
mentionnant qu'il était sujet autrichien.
Le lieutenant empoigne l'autrichien au collet et lui dit : "Je vous
arrête ! Suivez-moi !"
Les demoiselles du magasin font cercle. Et le lieutenant
pérore : il allait conduire au poste de police son prisonnier.
"J'ai un cousin qui vous ressemble. Il est hardi comme vous !"
murmure une demoiselle de magasin à l'adresse du lieutenant
qui se rengorge !
L'officier, toujours tenant son malheureux et piteux prisonnier par
le collet, le conduit au poste de police. Là, le commissaire
de police apprend au lieutenant que ce soi-disant prisonnier est un
autrichien inoffensif qui habite notre région depuis plus de
trente ans ; qu'il est cordonnier ; qu'on a raflé tous les
sujets des puissances ennemies, suspects ou non, et qu'on les a
logés à l'hôtel du... sous la surveillance de la
police ; que cet homme pouvait circuler en ville et y faire des
achats...
Le lieutenant n'en raconta pas moins qu'il avait fait un prisonnier
autrichien. Ce fait lui valut d'obtenir un emploi de confiance : il
fut nommé officier-adjoint. Plus tard, pour le
récompenser d'autres exploits, on le nomma soldat de 2e classe
!
|
le  ou ou
|
Il y a foule dans la grande rue de la ville,
devant le n°... Une femme gesticule au milieu de cette foule et
crie : "Au secours ! au secours !" et côté d'elle un
homme, en chemise, montre un de ses bras aux gens qui
l'entourent.
Je passe dans la rue avec mon Capitaine ; et cette femme s'avance
vers nous et nous prie d'expulser un militaire qui loge dans sa
maison et qui est devenue subitement fou. On entend le fou qui hurle
: "En avant ! en avant ! à la baïonnette !" Le fou se
croit général, sans doute, et commande une armée
en imagination. L'homme qui montre son bras explique qu'il a
essayé d'expulser le furieux, mais que celui-ci lui a
serré le bras avec une telle force qu'il est tout meurtri ; et
il ajoute, en s'adressant au Capitaine : "Monsieur, il est tout nu ;
on ne peut pas le saisir, il glisse entre les doigts !"
Et on entend toujours le fou qui crie d'une voix de stentor : "Toute
la cavalerie au galop !" et on perçoit une belle sarabande
dans la chambre qu'il occupe.
"Oh ! Monsieur ! il casse tout ! crie la pauvre femme. Au secours !
expulsez-le !"
Le capitaine et moi ne nous soucions guère d'aller calmer cet
énergumène qui d'ailleurs ne voudrait pas entendre
raison. Le plus simple est d'aller prévenir le poste de police
le plus rapproché de là. Ce que nous fîmes. Les
agents purent se saisir, par ruse, du malheureux dément qui
fut emmené dans une maison de santé !
|
le  épart épart
|
Notre régiment part le huitième
jour de la mobilisation. Nous défilons dans la ville au milieu
de l'enthousiasme général. Des fleurs sont offertes aux
soldats par la population féminine. Les fusils ont le canon
fleuri. A mesure que les compagnies défilent, les acclamations
redoublent.
L'embarquement en chemin de fer se fait en bon ordre, d'une
façon impeccable. Et le train s'ébranle au milieu des
acclamations et des vivats. Nous pensions tous que nous partions pour
peu de temps : un mois, deux mois au plus. C'était l'opinion
générale. Quelques-uns pensaient que la guerre serait
terminée à Noël, mais ils étaient
l'exception...
Je me souviens d'un arrêt du train à la petite ville de
Le... Le train avait été signalé, sans doute, et
la musique était à la gare pour fêter notre
passage.
Des groupes de jeunes filles passaient de wagon en wagon et offraient
des fleurs aux soldats.
J'ai remarqué une jeune fille, tout habillée de blanc,
accompagnée de sa mère et qui, en tout bien tout
honneur, envoyait des baisers et offrait des fleurs à ceux qui
partaient défendre la Patrie... Le capitaine a
interpellé cette aimable petite Française et lui a
demandé des fleurs et une poignée de mains. Elle a
ajouté un baiser : "Pour vous porter bonheur, ajouta-t-elle
!"
C'est un tableau que je n'oublierai pas.
Notre régiment débarque dans une ville de l'Est
où nous devons faire des tranchées, car on suppose que
l'ennemi va attaquer par l'est, en violant la neutralité
suisse.
|
Eugène
relate : "Notre régiment part le huitième
jour de la mobilisation. Nous défilons dans la ville
au milieu de l'enthousiasme général."
Il s'agit, ce 9 août 1914, de la ville de
Mâcon.
"Notre régiment débarque dans une ville de
l'Est où nous devons faire des tranchées."
Nous sommes le 10 août 1914 et le régiment
débarque à Besançon :
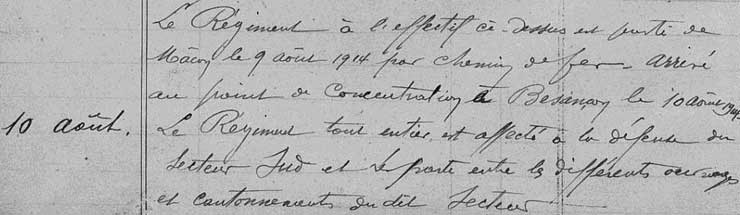
Journal de Marche et
Opérations du 60e Régiment d'Infanterie
Territoriale
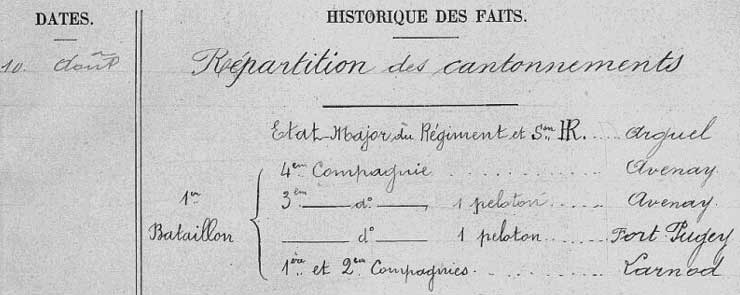
La 4e Compagnie du
Capitaine Corne - avec la section du Lieutenant Perrussot -
est cantonnée à Aveney, dans un des villages
des alentours de Besançon.


un gradé
à cheval - le Lieutenant Perrussot
?
Avanne et Aveney
s'associeront en 1973 et fusionneront en 2004.
En 1914, ce sont deux villages indépendants.
|
|
Mon  apitaine apitaine
|
Le Capitaine de la Cie approche de la
cinquantaine. C'est un "bel homme", à la physionomie fine et
énergique. Le Capitaine est un travailleur. Il s'occupe de la
compagnie dans tous ses détails.
Dans la vie civile, il est juge d'instruction, à Paris. Il
aurait pu obtenir un emploi dans un conseil de guerre. Il a
préféré faire son devoir de Français dans
un régiment combattant. Les hommes le trouvent un peu "dur"
et, en effet, à quatre heures du matin, on quitte le
cantonnement pour n'y rentrer que le soir à la nuit. La Cie
est chargée de creuser, sous la direction d'officiers du
génie, des tranchées pour défendre les abords de
la place fortifiée de... . Deux fois par semaine il y a des
marches et des manœuvres très fatigantes par les grandes
chaleurs d'août...
Mais le Capitaine a le sentiment du devoir. Il veut que la compagnie
soit entraînée pour le jour proche où nous
entrerons à notre tour dans la lutte.
Malgré son âge, le Capitaine est volontaire pour aller
dans un régiment actif, et nous nous sommes promis de ne pas
nous quitter durant la guerre.
Cher Capitaine, je n'oublie pas les semaines que nous avons
passées ensemble ! Aux heures tristes, lorsque les
communiqués indiquaient que "notre front s'étend de la
Somme aux Vosges", vous ne vouliez pas que le mot défaite soit
prononcé ! Vous ne pouviez admettre que nous soyons battus
!
Nous avions décidé de ne jamais nous séparer
pendant cette guerre, mais personne n'a pu tenir compte de nos
désirs, et nous avons été séparés
dès notre début dans les régiments actifs.
Pauvre cher Capitaine ! Son régiment fut engagé en
janvier 1915 dans la région de Crouy, et le capitaine fut
blessé très grièvement, d'après les uns,
mortellement, d'après les autres, d'une balle à la
tête. En tous cas, il resta aux mains de l'ennemi.
Depuis cette époque, aucune nouvelle n'est parvenue de lui
à sa famille. Son corps repose sans nul doute non loin du
petit village de Crouy, en un coin inconnu, dans une fosse anonyme,
comme il y en a tant dans cette cruelle guerre.
|
Eugène
écrit : " Le Capitaine de la Cie approche de la
cinquantaine. C'est un "bel homme", à la physionomie
fine et énergique (...)"
Dans la vie civile, il est juge d'instruction, à
Paris.
"(...)
Malgré son âge, le Capitaine est volontaire
pour aller dans un régiment actif, et nous nous
sommes promis de ne pas nous quitter durant la
guerre."
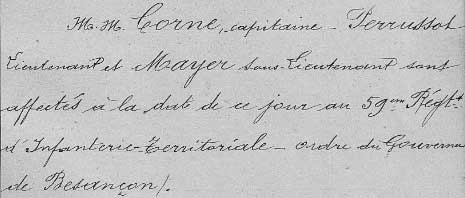
JMO du 60e
RIT
"(...) Nous avions
décidé de ne jamais nous séparer
pendant cette guerre, mais personne n'a pu tenir compte de
nos désirs, et nous avons été
séparés dès notre début dans les
régiments actifs. (1)
Pauvre cher Capitaine ! Son régiment fut
engagé en janvier 1915 dans la région de
Crouy, et le capitaine fut blessé très
grièvement, d'après les uns, mortellement,
d'après les autres, d'une balle à la
tête. En tous cas, il resta aux mains de l'ennemi.
Depuis cette époque, aucune nouvelle n'est parvenue
de lui à sa famille. Son corps repose sans nul
doute non loin du petit village de Crouy, en un coin
inconnu, dans une fosse anonyme, comme il y en a tant dans
cette cruelle guerre."
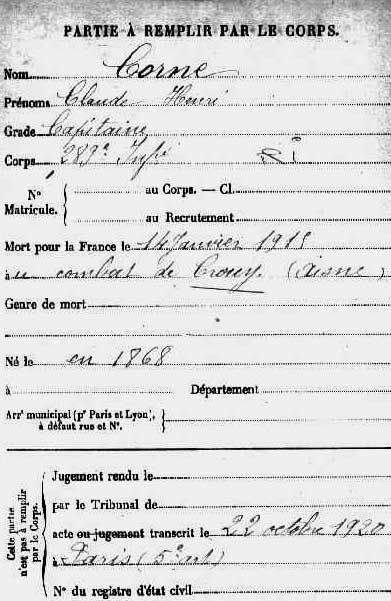
|
Nom : CORNE -
Prénoms : Claude Henri
Grade, unité : Capitaine
Commune du décès : Crouy
|
Conflit :
1914-1918
Date du décès : 12/01/1915
Département ou pays : 02 - Aisne
|
Autres informations : Capitaine au 289e R.I. 20e
compagnie
Marié 1 fils 13 ans Juge d'instruction à
Paris (75)
Né le 27/11/1868 à Châlon sur
Saône (71) - Matricule 639
avis corps 29/09/1915 Sens (89)
avis aux proches transmis le 6/10/1915 à Veuve 1 Quai
d'Occident chez Mme DEVIENNE
notes et commentaires : Jugement 8/10/1920 transcrit Paris
5
notifié le 8/3/1921, Mme DEVIENNE belle-mère
de M CORNE, habite Paris
Fiche issue
du relevé n° 38060
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complement.php?table=bp06&id=1728547
(1) Ailleurs,
Eugène écrit : "Quelques officiers volontaires
sont acceptés pour partir sur le front. Dans le
nombre figurent le Capitaine Corne et moi. Nous
sommes versés au 160e régiment
d'infanterie… Le lendemain, on nous apprend que
nous sommes affectés non au 160e, mais au 89e
et que nous devons rejoindre le dépôt à
Sens."
|
|
la  uérite uérite
|
Ordre est donné d'installer des
guérites pour les sentinelles aux issues du village où
nous sommes cantonnés.
Je fais construire une guérite à proximité d'une
croix en pierre. Cette croix est placée elle-même sur un
piédestal formé par trois marches d'escalier. Ma
guérite est faite avec des "perches" et de grands roseaux. Les
perches ont été coupées dans les bois, et les
roseaux au bord de la rivière. C'est une construction assez
sommaire, mais suffisante pour y abriter une sentinelle contre les
ardeurs du soleil ou contre la pluie.
Une autre compagnie, cantonnée également dans le
village, a construit une guérite. Elle est solidement faite :
les montants sont de fortes pièces de chêne ; elle est
bien couverte avec des roseaux dont les houppes argentées
s'élèvent gracieusement en l'air, et les tiges
rabattues sur la cabane forment le toit. Un petit drapeau aux trois
couleurs flotte sur la guérite.
Visite des guérites par les autorités
supérieures : la guérite aux gracieuses houppettes est
trouvée merveilleusement construite ; celle de notre
compagnie, lamentable.
Et pour comble d'horreur, une sentinelle, lasse, probablement, a
enfoncé un côté de la guérite pour
s'asseoir commodément sur l'escalier de la croix ! cela est
visible !
Grave affaire ! Il faudra refaire la cloison défoncée.
Et les autorités supérieures viendront voir si la
réfection a eu lieu. Et pendant ce temps notre front
"s'éternisait de la Somme aux Vosges !"
|
l' vrogne vrogne
|
Lombard est un soldat de la compagnie. C'est un
ivrogne. Dans la vie civile, il "faisait le lundi",
c'est-à-dire qu'il ne travaillait pas ce jour-là et
passait son temps à l'auberge. Quand il n'est pas pris de vin,
Lombard est un bon travailleur. Il n'y a pas son pareil pour creuser
des tranchées dans le roc. Le pic ne pèse pas lourd
dans ses mains. Les blocs les plus résistants s'effritent et
se désagrègent devant la ténacité de
Lombard. Sans son habitude de boire, Lombard serait bien
noté.
Un lundi, il s'échappe du chantier... il va au cabaret, il
s'enivre et est aperçu en état d'ivresse par le
Commandant. Grand émoi ! Le Commandant fait avertir le
capitaine du fait, et on envoie chercher Lombard qui est en complet
état d'ivresse...
Aux remontrances du capitaine, Lombard réplique d'une voix
avinée : "C'est aujourd'hui la saint-lundi !" et il lance un
bâton qu'il tenait à la main, dans la direction du
Capitaine. Lombard est emmené au cantonnement où il
cuvera son vin.
Coût : huit jours de prison. Lombard s'en tire à bon
compte. Son geste aurait pu lui coûter cher ! Mais le capitaine
a atténué le motif de la punition.
Quelques jours après, le Capitaine désigne les hommes
des jeunes classes qui doivent partir dans les régiments
actifs. Dans le nombre se trouve un père de famille ayant
quatre ou cinq enfants.
Lombard, l'ivrogne, va trouver le Capitaine : "Mon Capitaine, dit-il,
je suis un "vieux garçon" ; je veux partir à la place
de mon camarade chargé d'enfants." La démarche de
Lombard est acceptée séance tenante.
Le Capitaine le félicite. Son camarade, ému, le
remercie. On fait fête à Lombard.
Lombard, j'admire ton geste. Tu es un ivrogne, mais tu aimes ton
semblable. Tu es un dévoyé de la vie, mais tu
possèdes des qualités qui manquent à beaucoup
d'autres : le dévouement et la bonté.
Ah ! Lombard, sans ton vilain vice, imputable au milieu dans lequel
tu vis, quel brave homme tu aurais fait !
|
un  ergent
de ma section ergent
de ma section
|
J'ai un excellent sergent dans ma section.
Il était, avant la guerre, régisseur dans une grande
exploitation agricole. Il appartient à une ancienne famille,
et, après des revers de fortune, il avait dû accepter un
emploi chez autrui où il était traité en
frère et non en domestique.
Il est marié et a une gentille famille, deux petites filles et
un petit garçon. Il m'a montré la photographie de sa
femme entourée de ses enfants. C'est un ravissant tableau.
J'ai aperçu plusieurs fois mon brave sergent regarder cette
photographie et avoir ensuite les larmes aux yeux.
"Pleure, mon brave de la terre, en pensant au foyer, à ta
femme et à tes enfants que tu ne reverras plus. A la
pensée de tes larmes et de ton destin, mes yeux se mouillent,
car ton souvenir m'est cher !"
Mon sergent est volontaire pour partir dans un régiment actif,
et il veut me suivre car nous nous aimons comme deux frères.
Qu'elle est belle, la camaraderie d'armes !
Un jour, il me dit, après avoir regardé la photographie
: "Mon lieutenant, je pars et je ne reverrai plus les miens ; j'en ai
l'intime sentiment." Et à ma question : "Pourquoi partez-vous
alors ?" il me répond : "Parce que tout Français
capable de tenir un fusil doit demander à aller combattre,
sous peine d'être un lâche ; parce que j'ai le mari de ma
sœur, capitaine, tué à l'ennemi, à venger
!"
Le pressentiment du sergent était fondé. Il partit dans
un régiment actif. Il combattit vers Arras, puis en Belgique.
Il fut tué, à la tête de sa section, vers
Bischoote, et il repose dans cette terre héroïque de
Belgique qu'il a contribué à
défendre.
|
un  ubergiste
en temps de guerre ubergiste
en temps de guerre
|
Le vin vaut 0f 70 en août 1914, et
à ce prix MM.les aubergistes ont encore un honnête
bénéfice.
M. le mastroquet de ...., où se trouve cantonnée la
compagnie, a immédiatement décidé, en son for
intérieur, qu'il devait profiter de la guerre, et, par
conséquent, exploiter les soldats ; et il leur vend son vin
plus ou moins honnête au prix de 1f le litre.
Un jour, cet honorable commerçant m'amène un homme de
ma Cie. Il le tient par le bras comme un malfaiteur et me dit : "Mon
lieutenant, je viens de prendre dans mes écuries un homme en
train de me voler un œuf. J'étais caché dans un
coin de l'écurie, et je l'ai vu prendre l'œuf sur le
nid." Le voleur de l'œuf était blanc comme un linge.
Evidemment, il a eu tort de voler cet œuf, et le vol n'est pas
admissible. Mais j'étais outré de voir cet aubergiste,
dépouilleur de nos soldats, porter plainte pour une pareille
peccadille. Dans un cas semblable, il aurait été
préférable qu'il admonestât le soldat, sans
porter plainte.
Je me fais conduire à l'écurie, au coin où
s'était caché l'aubergiste. Je me fais montrer "le nid"
où a été commis le larcin.
Et avec le plus grand sang-froid, je dis à l'accusateur :
"Vous mentez ! Du point où vous étiez caché,
vous ne pouvez apercevoir que le bras gauche de l'homme. Quand on
vole, on se sert de son bras droit !"
J'ai donné 4 jours de prison à l'homme, en l'invitant
à ne plus recommencer.
J'ai invité les hommes à avoir un peu de cœur, et
à "mettre à l'index" le cabaretier qui ne craignait pas
d'exagérer ses prix, et qui portait plainte pour un œuf
qu'on lui volait ! Ah ! ces mercantis ! quelle sale race !
Le Capitaine a pu se procurer du vin qu'il a vendu aux hommes 0f 45
le litre.
Je vois toujours "la tête" de l'aubergiste lorsqu'il
s'aperçut que sa maison avait été mise à
l'index par les soldats.
|
une  rrivée
inopportune rrivée
inopportune
|
Je suis volontaire dans un régiment
actif. Un instituteur doit donner l'exemple. Mon départ doit
avoir lieu incessamment. J'écris à ma femme de venir
passer quelques jours auprès de moi, en attendant mon
départ.
Elle arrive un jour, vers midi, et je suis heureux de retrouver ma
chère femme que je ne reverrai peut-être plus. Je lui
cache mes démarches et je lui représente mon
départ pour un régiment actif comme une chose
absolument normale.
Comme je suis heureux de revoir ses jolis yeux bleus, de me blottir
contre celle à qui j'ai joué le vilain tour de partir
comme volontaire dans l'active !
Un remords m'avait pris, à la suite de mes démarches,
et c'est pour cela que j'avais fait venir ma femme pour la revoir
encore une fois...
Mais le Capitaine à la jolie guérite, qui remplissait
le rôle de major de la garnison, veillait au grain. Il avait
appris rapidement l'arrivée de ma femme, et me fit appeler
:
"Comment votre femme a-t-elle pu venir ici ? Vous savez bien qu'il
est défendu de faire venir sa femme ? Lord Kitchener l'a dit :
Pas de femme ! - que diable Kitchener venait faire dans cette
histoire ! - Il faut donc que votre femme reprenne le premier train,
sans cela je suis obligé de faire un rapport au Colonel sur
cette affaire, et cela pourrait être très grave pour
vous !"
Très grave ! Je répondis au Capitaine que ma femme
partirait le lendemain matin, par le premier train. Ce qu'elle fit,
courageusement d'ailleurs.
Le Capitaine qui faisait de si jolies guérites, qui faisait
partir les femmes, ne pouvait comprendre pourquoi j'avais pu faire
venir ma chère compagne : il avait oublié de s'inscrire
sur les listes des volontaires.
|
une leçon de  olitesse olitesse
|
M. le Maire (Joseph Plassard, fils de Jules
Plassard) et Madame son épouse sont à
Saint-Léger depuis le 4 août 1914.
M. le Maire a cinquante-et-un ans ; son épouse en a
soixante-deux. C'est un ménage bien assorti !! Ils ont
vécu maritalement tous les deux pendant de longues
années, puis ils ont fini par s'épouser
légalement un an ou deux avant la guerre.
Le Maire est un homme sec, aussi sec qu'Harpagon, aussi pingre que
lui, absolument insignifiant, et conduit par sa femme comme une
pauvre marionnette.
Madame est née dans le Luxembourg. Elle a les cheveux rouges,
et la figue ornée de grosses taches de rousseur. Elle se teint
et se peint.
Elle était intimement liée, avant la guerre, avec une
certaine demoiselle Koetsemberg, brêmoise d'origine, qui avait
une volumineuse correspondance avec l'Allemagne, et de nombreuses
visites, en son domicile, à Paris, rue...
Cette Koetsemberg, était-ce une espionne ? Sans doute.
Tous les Allemands, établis en France, couvraient notre pays
d'un vaste réseau d'espionnage...
Madame a voulu s'immiscer dans les réunions de jeunes filles
qui avaient lieu à l'école depuis de nombreuses
années, et elle a fini, avec son caractère hautain, par
vouloir diriger, commander, dominer...
Ma femme est appelée chez M. le Maire : Madame la mairesse
n'est pas satisfaite de la combinaison proposée par ma femme
et conseillée par moi : l'organisation des classes (ma femme
aura les grands garçons et les grandes filles ; l'adjointe les
petits garçons et les petites filles.) Madame est
outrée de voir que pareille combinaison ait pu avoir lieu sans
son avis, sans l'avis du maire. Mais ma femme explique que c'est par
devoir qu'elle agit ainsi ; qu'avant de partir je lui avais
demandé de prendre mes grands élèves, et que,
comme directrice d'école, elle estime que l'organisation doit
avoir lieu ainsi... et que les chefs hiérarchiques ont
approuvé cette manière de voir.
Et la femme rousse réplique, méchante : "Vous n'avez
pas le ton poli ! Toutes les fois que vous ne serez pas correcte, je
vous le ferai remarquer."
Et voilà une femme qui pendant trente ans a vécu
maritalement ; qui a mené une vie de bâtons de chaises ;
qui est d'origine étrangère, et qui donne une
leçon de politesse à une honnête femme ! C'est le
comble du culot !!
Ma femme sortit indignée de la maison du maire.
|
"Construit
en 1896 par l'architecte Alexandre Marcel, (la salle de
cinéma) La Pagode est influencée par le
japonisme de l'époque. Emile Morin, alors directeur
du Bon Marché, l'a fait construire pour son
épouse, Suzanne Kelsen.

Dès son
ouverture, l'endroit fait parler de lui : un dîner de
cent couverts, suivi d'un concert sur place de l'Orchestre
de l'Opéra défraye la chronique. Un premier
scandale étouffé par un second. Suzanne Kelsen
est la maîtresse de l'associé de Morin, Joseph
Plassard. Les époux divorcent l'année de
l'ouverture du cinéma. Magnanime, Morin laisse
à son ex-femme La Pagode.
A la mort de Kelsen,
Plassard se remarie et acquiert avec Antoinette Mougel, sa
nouvelle épouse, les hôtels particuliers autour
du cinéma. La Pagode devient un lieu de
réceptions où les gens du tout Paris viennent
se montrer et se divertir.
En 1927, pour des
raisons financières, l'ancien associé de Morin
est obligé de fermer la salle. La Pagode est
délaissée au point que des chèvres
broutent même dans le jardin !"
source et
lien : https://proprietes.lefigaro.fr/actualite/le-mobilier-du-cinema-la-pagode-mis-aux-encheres-a-paris-100710963
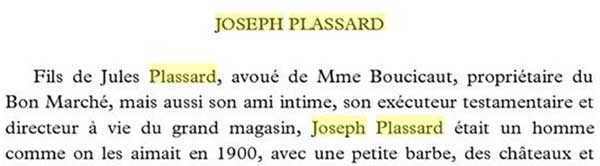
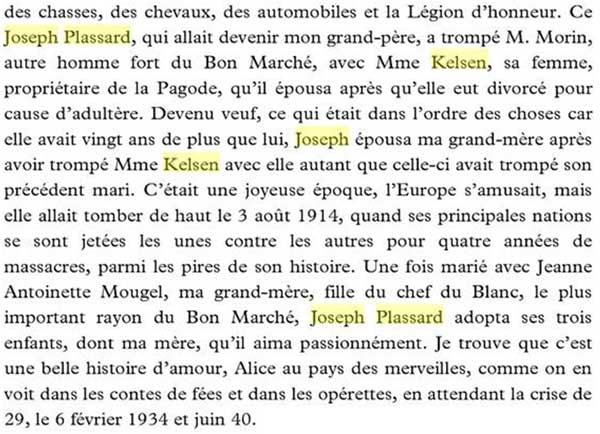
Extrait de "Libera
me" par François Gibault
pour tout
savoir sur leur généalogie : https://gw.geneanet.org/christophejeanteur?lang=fr&n=kelsen&oc=0&p=amelie+suzanne
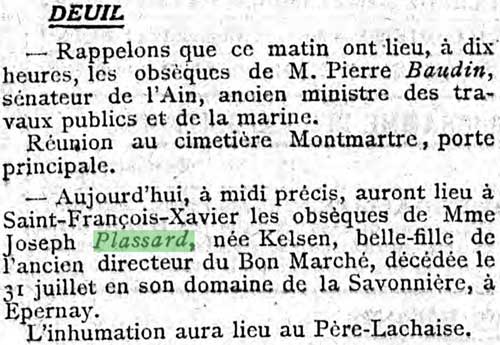
Le Figaro - 3
août 1917
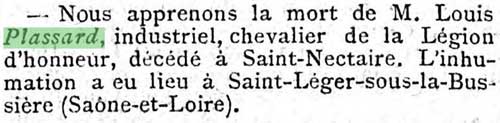
Le Figaro - 3
juillet 1920
C'est le fils de Claude-Jules Plassard, le bienfaiteur
de Saint Léger. Il est parfumeur à Paris.
C'est le frère du "méchant" Joseph, maire de
Saint Léger, qui fait des misères au couple
Perrussot.
|
|
le  épart
pour le front épart
pour le front
|
Quelques officiers volontaires sont
acceptés pour partir sur le front. Dans le nombre figurent le
Capitaine Corne et moi. Nous sommes versés au 160e
régiment d'infanterie.
lien
ici vers la biographie d'Eugène
|
Nous sommes chargés, à cette
occasion, de conduire un fort détachement (1500 hommes
environ) en renfort, sur le front, dans les unités actives.
Nous faisons nos adieux à nos bons camarades. Le commandant du
bataillon nous regarde partir d'un air distrait. Le Capitaine qui a
construit une si jolie guérite me tend la main que j'oublie de
serrer. (Il peut bien faire partir les femmes des camarades ! Il est
assuré de revoir la sienne, lui !)
L'embarquement a lieu sans encombres, à la gare de
Besançon. Au départ, les hommes sont loquaces. Le bruit
court que le détachement est dirigé sur une ville du
centre : quelques hommes bien informés prétendent que
le point terminus du voyage est Paris. Nous les laissons dans
l'erreur...
Jusqu'à la gare du Bourget, l'animation régna dans les
compartiments : mais quand, du Bourget, le train prit la direction du
Nord, le calme naquit comme par enchantement. Les hommes comprenaient
qu'ils allaient, non pas dans une ville tranquille, mais directement
sur le front de combat. Nous voyageons (à partir du Bourget)
toute une nuit avant d'arriver à Amiens. Le jour commence
alors à éclairer la campagne, et on s'aperçoit
que le train file dans des régions qui ont vu la guerre : on
aperçoit des maisons détruites, des ponts coupés
et restaurés au petit bonheur, des tombes de soldats, à
chaque instant.
Nous arrivons à la gare d'Authieule,
point terminus du chemin de fer à cette époque. Les
hommes descendent du train. Nous les groupons en ordre et les
conduisons dans un champ, en colonne de compagnie. Les faisceaux sont
formés. Les corvées d'eau et de bois sont
organisées, et les cuisiniers préparent le café.
En attendant, les hommes mangent un repas froid. Le Capitaine a
reçu un pli de l'autorité militaire : ordre de se
mettre en route sur Bertrancourt.
La colonne part et arrive à Bertrancourt en pleine nuit. Les
hommes sont fatigués. Les hommes s'installent dans les
cantonnements préparés par les fourriers partis
à l'avance. Dès que l'installation est terminée,
que les hommes, fatigués, commencent à s'allonger sur
la paille - quand il y en a - ou sur le sol - souvent -, ordre est
donné de déguerpir et de filer sur Sailly-aux-Bois. Les
hommes maugréent, car ils sont rompus de fatigue, par les deux
nuits et deux jours de voyage ; de plus, la nuit est d'un noir
d'encre... Il faut repartir quand même.
Dans le lointain, on entend le bruit du canon et de la fusillade.
Nous arrivons à Sailly-le-Bois, vers minuit. Personne ne nous
attend dans ce village. Le Capitaine et les gradés vont
répartir les hommes dans les locaux inoccupés, s'il y
en a encore. Pour ma part, je cherche, dans la nuit, un local pour
les officiers. Je heurte à une porte : "Qui est là ?"
me dit-on de l'intérieur - Ce sont des soldats qui cherchent
un gîte. - M... pour les soldats ! - Quel est le vieillard qui
vocifère ainsi ? - C'est le médecin à cinq
galons !" Je m'enfuis et je heurte à une autre porte : c'est
une bonne vieille qui vient m'ouvrir et qui a la hantise des boches
qui ont grillé le village il y a peu de temps : "Vous ne me
ferez point de mal ? - Non. Madame, nous sommes des Français.
- Oui, mais les Français m'ont volé mes lapins. - On ne
vous prendra rien."
Sur cette assurance, elle nous installe dans sa cuisine où je
fais placer des bottes de paille récoltées dans le
hangar voisin. Je vais à la rencontre du Capitaine et nous
revenons au gîte où nous nous allongeons l'un à
côté de l'autre comme deux frères, au son du
canon qui fait rage à proximité du village.
|
|
de
la gare d'Authieule à Sailly au
Bois
|
Eugène
raconte : " Nous arrivons à la gare d'Authieule,
point terminus du chemin de fer à cette époque
(...)"
Authieule se trouve en Picardie, dans la Somme, au bord de
l'Authie, pas loin du tout de St Léger les
Authie. Peut-être qu'Eugène est
passé par cet "autre" St Léger, en pensant au
sien ?
"(...) Ordre de se
mettre en route sur Bertrancourt. La colonne part et arrive
à Bertrancourt en pleine nuit."
Bertrancourt est à 18 kilomètres d'Authieule,
à deux pas de Bus lès Artois.
" (...) Ordre est
donné de déguerpir et de filer sur
Sailly-aux-Bois. Les hommes maugréent, car ils sont
rompus de fatigue, par les deux nuits et deux jours de
voyage ; de plus, la nuit est d'un noir d'encre... Il faut
repartir quand même. Dans le lointain, on entend le
bruit du canon et de la fusillade. Nous arrivons à
Sailly-le-Bois, vers minuit."
Sailly au Bois se situe à 5 kilomètres de
Bertrancourt.
Enfin arrivés
au cantonnement, les soldats auront fait, à pied et
en pleine nuit, 25 kilomètres depuis la gare
d'Authieule !
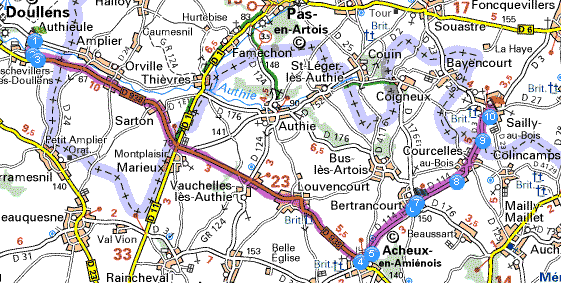
Cet épisode se
place alors qu'Eugène est Lieutenant au 60e
Régiment d'Infanterie Territorial. Avec le Capitaine
Corne, les Lieutenants Monnier et Bruy et le Sous-Lieutenant
Mayer, il fait partie des "Cadres de Conduite" de deux
détachements vers le 79e RI et le 160e RI.
Le départ à lieu de la gare de Besançon
le 8 octobre 1914. Les "Cadres de conduite" sont de reour au
dépôt de Besançon le 15 octobre.
Voir p.
7 et 8 du JMO - 60e
régiment d'infanterie territoriale : J.M.O. 9
août 1914-8 août 1915 o 26 N
786/29
|
|
 etour etour
|
Le lendemain (ou plutôt le même
jour), à 5 h du matin, j'étais debout. Je parcours le
village où l'on entrevoit de ci, de là, des
lumières. J'aperçois des soldats qui préparent
le café ; et je suis heureux de boire "un quart de jus".
A la sortie du village, il y a plusieurs batteries de 75. Ce sont
celles qui tiraient cette nuit.
Je rentre au logis. Le Capitaine est debout, lui aussi, et il est en
pourparlers avec la bonne vieille pour qu'elle nous donne à
manger. Elle n'a aucune provision chez elle : les Allemands lui ont
pris à peu près tout ce qu'elle avait : jambon, lard,
vin, légumes, etc. Elle nous dit que dans la maison "en face"
nous trouverons un bon lit pour la nuit suivante et peut-être
de quoi manger. Néanmoins, elle consentit à nous garder
encore la journée et nous fit cuire une poule, la
dernière qui lui restait, dit-elle. Elle n'avait plus de vin,
mais nous en trouvâmes une bouteille dans le village...
La maison d'en face est occupée par un brave instituteur
retraité qui nous accueille à bras ouverts. Nous
aurons, la nuit prochaine, un bon lit. Pour notre repas du soir, la
ménagère va nous faire une bonne soupe avec un "reste
de jambon" et un chou oublié dans le jardin. Une bouteille de
vin échappée aux recherches des boches
complètera notre repas, si nous restons au village.
Pendant toute la matinée, les hommes se nettoient,
préparent leurs sacs, et se tiennent prêts à
partir.
Dans l'après-midi, rassemblement du détachement,
à la sortie Est du village. Là, des officiers du 146e
et du 153e viennent prendre possession du détachement. Les
1500 hommes sont répartis dans les deux régiments, et
chaque groupe est à son tour réparti dans les 12
compagnies. La répartition a lieu sans incident
sérieux. A un moment donné, un avion boche survola
notre rassemblement, et l'ordre fut donné aux hommes de se
coucher et de garder l'immobilité. Chaque gradé
emmène ensuite son groupe. Nous disons adieu à tous nos
camarades que nous voudrions suivre mais le Général qui
commande la division n'a pas d'ordre pour affecter les officiers, et
nous n'aurons pas d'ordres avant le lendemain...
Nous nous dirigeons vers notre maison hospitalière et en cours
de route nous rencontrons un vieillard en uniforme de soldat de 2e
classe, décoré de la rosette de la Légion
d'honneur. C'est un ancien Colonel qui s'est engagé comme
simple soldat dans un régiment actif. Il a belle allure et
nous le félicitons pour sa bravoure.
Chez notre instituteur, nous passons une bonne nuit, malgré le
bruit continuel fait par le piétinement des troupes en marche
et par le canon qui tire sans cesse...
Le lendemain, on nous apprend que nous sommes affectés non au
160e, mais au 89e et que nous devons rejoindre le dépôt
à Sens...
|
 oyage
manqué oyage
manqué
|
Me voici à Sens. Je suis avisé
officieusement que je rejoindrai dans quelques jours le 89e qui se
trouve en Argonne. Mon bon Capitaine est versé au 289e.
Pourquoi sépare-t-on les amis ? Nous avions demandé
à rester ensemble. On n'a tenu aucun compte de nos
désirs. Pour me consoler, on me dit amicalement que je peux
faire venir ma femme. Je lui télégraphie de venir en
hâte me rejoindre à Sens.
Je me réjouis en pensant au bonheur qui m'attend. Ma
chère femme que j'ai quittée, à qui j'ai
joué le vilain tour, à 46 ans, de partir dans un
régiment actif, alors que je pouvais tranquillement rester
dans mon régiment territorial ou même dans une formation
de l'arrière, ma femme, dis-je, arrive demain. Mon
télégramme parti à 2 h de l'après-midi a
dû la "toucher" deux heures après. Elle a eu le temps de
prendre le train du soir. Demain matin, elle sera auprès de
moi.
Elle aura plus de chance qu'à son précédent
voyage. Ici, point de capitaine féroce pour la faire partir...
Avant d'aller au feu je pourrai donc revoir ma femme, pendant
quelques jours peut-être... Dans cette douce idée,
j'allais m'endormir lorsqu'on me prévint, vers 11h du soir,
que je devais partir le lendemain matin sur le front. Embarquement
à 10h 1/4.
Et ma femme qui arrive à 10 heures ! et elle est en route !
Impossible de lui télégraphier de ne pas venir !
Pourquoi m'a-t-on dit de faire venir ma femme ? Quelle nuit terrible
ai-je passé en pensant au désespoir de ma femme qui ne
pourra me voir que quelques instants, si le train arrive à
temps !
Ma femme est arrivée à 10h. Un officier, de mes
camarades, est allé la chercher à la gare des
voyageurs, et me l'a amenée au moment où je montais
dans le train.
Nos adieux furent empreints de tristesse. Elle ne pouvait retenir ses
larmes. J'essayai de rester calme.
Je lui expliquai que la guerre ne pouvait durer, qu'elle serait finie
avant un mois... Mais il fallut nous séparer. Notre train se
mit en marche, et pendant quelques instants j'aperçus un
mouchoir blanc qu'agitait ma femme qui me faisait des signes
d'adieu.
Et c'est ainsi que je suis parti sur le front !
|
 otre
arrivée sur le front otre
arrivée sur le front
|
Le sous-lieutenant M... et moi, sommes
arrivés sur le front, en Argonne, à Neuvilly, au sud de
Vauquois. Nous sommes deux territoriaux, volontaires versés
dans un régiment actif. Je suis affecté à la 3e
Cie que je rejoindrai le lendemain. Mon camarade est affecté
à une autre Cie.
Le village où nous cantonnons la première nuit est en
ruines, comme tous les villages que nous avons rencontrés
(Clermont-en-Argonne). Les rues sont encombrées de
débris de toutes sortes. Des chevaux crevés empuantent
l'air. Les maisons qui restent debout sont en triste état :
portes absentes, tuiles enlevées, murs crevés par les
obus. Dans les chambres, tout a été pillé par la
horde de brigands : coffres forts brisés, meubles ouverts et
vidés. Tous les papiers de famille, le linge, les
vêtements, toutes sortes d'objets jetés par terre,
pêle-mêle, souillés, piétinés,
forment un désordre inexprimable.
Dans ce désordre, je butine une
poésie touchante, que j'ai conservée :
|
Ma
mère
Ma mère ! c'est elle,
Seigneur,
Que tu formas selon ton cœur,
A qui tu confias mon âme,
Elle est douce et bonne : elle sait
Tout ce que mon cœur veut, et c'est
Des femmes la meilleure femme !
Son front est pur, son
cœur divin
Et tu l'as faite belle afin
Qu'en m'enivrant de son sourire,
Plus doux qu'un rayon de miel,
Ce soit la beauté de ton ciel
Que sur son front je visse luire...
Seigneur, ton ouvrage est
parfait
Le don qu'en elle tu m'as fait,
A genoux, je t'en remercie.
Celle qui te portait enfant,
Dans ses bars, sur son cœur aimant,
Tu ne l'avais pas mieux choisie...
Je l'aime autant que tu
l'aimais.
Oh ! ne me la reprends jamais,
Si tu veux que je sois fidèle
Au conseil que j'en ai reçu
Comme à la vertu qu'elle a su
Me rendre plus douce près d'elle
Jeanne
Fosse
|
|
Et tout de suite, ma pensée vole vers ma
famille, vers ceux que j'ai laissés là-bas et je me dis
:
"Moi aussi, je vais piller : je vais prendre cette page où est
écrite cette poésie. Je l'enverrai à ma famille.
Ma femme, institutrice, apprendra ces vers touchants à ses
enfants. Et quand, plus tard, je la relirai, je penserai au petit
village de Neuvilly, et à la pauvre maison abandonnée
et pillée ! - Où est l'enfant qui copia ces vers aux
jours heureux du temps de paix ? En fuite... sans maison... au milieu
d'inconnus et d'indifférents..."
Personne ne s'occupe de Mayer ni de moi. Nous avons l'air
d'être des intrus. La nuit arrive.
Nous nous réfugions dans une grange. Nous faisons deux nids
dans les gerbes non battues, et, après avoir "cassé la
croûte", nous nous endormons comme deux frères d'armes.
Mais Mayer, avant de s'endormir, a ces paroles de
découragement : "Mon pauvre vieux, qu'est-ce que nous sommes
venus faire là !"
Il est vrai que le premier accueil qui nous a été fait
au régiment manque d'enthousiasme et de camaraderie.
Des obus tombent de ci, de là, dans le village.
Mais, malgré tout, nous dormons une bonne nuit. Le lendemain,
nous apprenons qu'un obus était tombé à
proximité d'une grange où logeaient des soldats, et
avait tué ou blessé plusieurs d'entr'eux.
Nous nous dirigeons, Mayer et moi, sur nos Cies respectives, non sans
avoir échangé une vigoureuse et fraternelle
poignée de mains.
En arrivant à la 3e Cie, j'apprends que je suis affecté
à la 10e. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu ? Pourquoi
me fait-on faire une longue marche inutilement ? Ah ! "J'en verrai
bien d'autres" dans cette guerre ! Je rejoins la 10e Cie et suis
affecté au commandement d'une section.
|
l' ttaque
de Vauquois ttaque
de Vauquois
|
Le village de Vauquois est situé sur un
point culminant. Les boches l'occupent fortement. D'épais
réseaux de fil de fer en défendent les approches. Sur
la crête de la colline, on distingue très bien la ligne
des tranchées ennemies qui passe sur la lisière sud du
village dont certaines maisons sont transformées en
observatoire ou en forteresses.
Deux bataillons sont chargés d'enlever le village ; d'autres
troupes, plus à l'ouest, doivent enlever Bourreuilles.
L'attaque aura lieu à cinq heures du matin. Elle sera
précédée d'un bombardement avec quelques
pièces de 90 et quelques pièces de 65, bombardement
dérisoire qui ne pouvait faire aucun mal à la garnison
et qui mettait les boches en garde.
Les compagnies sont à pied d'œuvre. A l'heure dite, le
départ a lieu, par vagues successives, les sections
échelonnées les unes derrière les autres. Les
hommes marchent comme à l'exercice.
Mais les guetteurs boches ont aperçu l'attaque qui
débouche de nos lignes, qui progresse et s'approche de la
colline...
Un feu de mitrailleuses prend de face et de flanc nos lignes
d'assaut. Les sections sont fauchées, et des files
entières d'hommes tombent les unes à côté
des autres, tués ou blessés. En quelques instants, le
sol est couvert de morts et de mourants. A l'ouest, le village de
Bourreuilles est en feu.
Les survivants doivent réintégrer les lignes de
départ. Seule une section, emportée par son
élan, arrive devant les fils de fer des lignes ennemies. Mais
l'obstacle, non atteint par l'artillerie, était
infranchissable. Ces héros tombèrent à leur
tour, et leurs corps devaient rester ainsi sur le sol, sans
sépulture, pendant des semaines et des mois, et ils allaient
faire partie de la longue et interminable liste " des disparus " qui
ne reparaîtront jamais.
Après l'attaque, nous sommes chargés d'aller relever
les unités en ligne, et la relève se fait, sans
encombre, la nuit suivante.
|
la  igne igne
|
Au matin, nous vîmes, devant nos lignes,
les cadavres de nos malheureux camarades : les morts, étaient
là, par files entières, ou par groupes de quatre ou
cinq, parfois isolés, dans toutes sortes de poses horribles et
tragiques. Celui-ci, un adjudant, totalement exsangue, couché
sur le dos, élevait la main droite, comme dans un geste de
commandement ; celui-là était allongé le long
d'un ruisseau, la tête à fleur d'eau, comme s'il buvait
; cet autre avait dû être étouffé à
la suite d'une hémorragie interne, car sa figure était
toute noire et boursouflée ; et cet autre encore, assis par
terre et appuyé contre un arbre, était mort pendant
qu'il pansait sa jambe broyée : il avait pu développer
son paquet de pansement et en appliquer les bandelettes autour de la
plaie... Et les morts se succédaient dans cette triste
vallée, jadis paisible et belle. Nous trouvâmes un petit
sergent, à genoux, dans une baraque, non loin de la ferme de
la Cigalerie, le fusil encore installé dans une ouverture de
la baraque, et qui avait été tué d'une balle en
plein cœur.
Il fallut profiter du brouillard ou de la nuit pour relever les
cadavres, car les boches tirent sur le service de santé.
A ce sujet, je me souviens d'une triste affaire : j'avais
accompagné le médecin dans sa pénible mission,
et nous dirigions et encouragions les brancardiers qui, dans ce
carnage, n'avaient pas l'âme très solide. On les voyait
quelquefois accourir auprès de nous et tomber par terre avec
leur brancard, en tremblant de tous leurs membres. A la suite d'un
spectacle trop tragique (d'une trop longue file de morts) ou d'une
hallucination, ils étaient soudain pris de panique, dans la
nuit, ou dans le brouillard, et il fallait les réconforter et
quelquefois les menacer pour qu'ils continuent leur triste et
accablante besogne.
Au moment de quitter le docteur, je lui dis : "Ah ! docteur, vous qui
représentez en ce moment ce qui reste encore de civilisation
dans cette horreur qui nous entoure, vous êtes obligé de
vous cacher comme un malfaiteur pour relever nos pauvres camarades !
Je trouve cela bien triste." Puis j'allai vers mes hommes, car
l'heure du "quart" approchait pour moi.
Je n'avais pas encore rejoint nos lignes que le docteur tombait comme
une masse, frappé par une balle en plein cœur. Il avait
été tué par une de nos sentinelles
affolées qui, à travers le brouillard avait
aperçu des ombres et avait tiré, croyant avoir affaire
à des ennemis. Il avait complètement oublié
l'avertissement qui avait été donné aux
sentinelles, qu'une équipe sanitaire relevait les morts devant
nos lignes. La pauvre et héroïque dépouille du
médecin repose dans le cimetière d'Aubréville,
à côté de nombreux camarades de notre
régiment !
|
mort
d'un médecin français tué en
Argonne par une sentinelle française
5 novembre 1914
|
Eugène
raconte : " Je n'avais pas encore rejoint nos lignes que
le docteur tombait comme une masse, frappé par une
balle en plein cœur. Il avait été
tué par une de nos sentinelles affolées qui,
à travers le brouillard avait aperçu des
ombres et avait tiré, croyant avoir affaire à
des ennemis (...) La pauvre et héroïque
dépouille du médecin repose dans le
cimetière d'Aubréville, à
côté de nombreux camarades de notre
régiment !"
La scène se
passe au 89e RI "non loin de la ferme de la Cigalerie" en
Argonne, au début novembre 1914. Peut-on savoir
comment s'appelait ce malheureux médecin ?
Son identité
nous est révélée par le J.M.O.du 89e
Régiment d'Infanterie (1) :
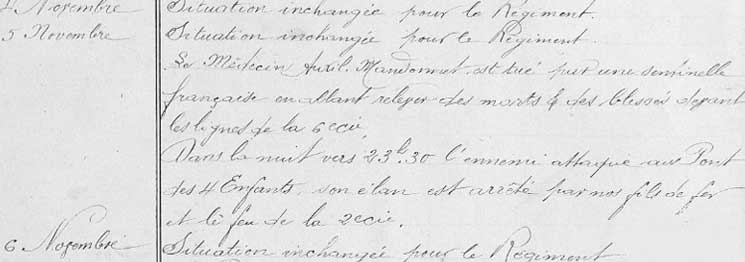
"5 novembre (1914)
…/… Le Médecin Auxil. Mandonnet est
tué par une sentinelle française en allant
relever des morts et des blessés devant les lignes de
la 6e Cie (Compagnie)"
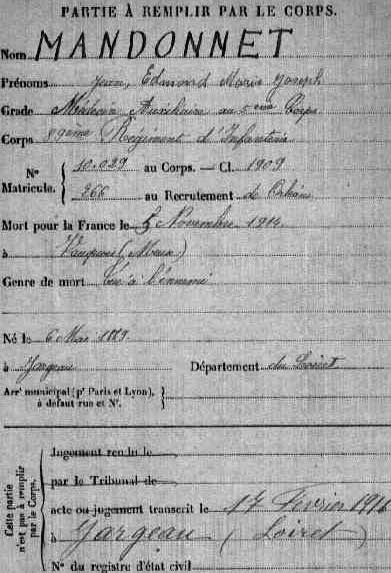
"Jean Edmond Marius
Joseph Mandonnet, Médecin Auxiliaire au 5e Corps, du
89e Régiment d'Infanterie ; Mort pour la France le 5
novembre 1914 à Vauquoi (Meuse) tué à
l'ennemi, né le 6 mai 1889 à Jargeau,
département du Loiret"
Il avait vingt-cinq ans.
(1)
7 avril - 31
décembre 1914 - 26 N 668/1
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/jmo/img-viewer/26_N_668_001/viewer.html
|
|
le  uart uart
|
Nous nous partageons le service, car nous
sommes trois officiers. Chacun fera quatre heures de garde la nuit et
quatre heures le jour. Et il ne faut pas croire que lorsque
l'officier a fini "son tour de quart" son service soit fini. Le
service de l'officier n'est jamais fini ; et, lorsqu'il tombe de
fatigue, il doit placer une sentinelle à côté de
lui pour le réveiller à la moindre alerte.
Prendre le quart, c'est veiller pendant qu'une partie de la compagnie
repose ; c'est passer d'une sentinelle à l'autre ; voir si
chacun est à son poste ; c'est être attentif à
tous les bruits, à tous les signaux, c'est empêcher
toute négligence des hommes de garde.
Je suis de service, cette nuit, de 10 heures à deux heures. Il
fait un froid de loup. Il y a dix degrés de froid. Le givre se
colle à ma moustache. Il fait une nuit absolument obscure, et
je ne vois pas la piste que je dois suivre, derrière la
tranchée où sont les hommes. J'oblique trop à
droite, et je vais me heurter dans une file de cadavres
couchés côte à côte, raidis dans leurs
dernières poses, attendant qu'on les enterre. J'appuie
à gauche, trop à gauche, car j'entends crier sous mes
pieds : je suis monté sur la tranchée, recouverte, en
cet endroit, de branchages et de terre, et je sens que je m'enfonce
dans l'abri et que les branches cèdent. Les hommes viennent me
sortir de ma fâcheuse position, et je continue ma ronde, allant
visiter les sentinelles assez éloignées les unes des
autres, car le front occupé par la compagnie est très
développé.
La tristesse me saisit : je pense à mes pauvres camarades dans
lesquels je me suis heurté, et qui dorment leur dernier
sommeil ; à ces tristes dépouilles qui étaient
naguère des créatures aimantes, et qui maintenant
répandent des miasmes épouvantables dans l'air. S'ils
ne sont pas encore enterrés, c'est parce que les terrassiers
ont fort à faire pour venir à bout de leur lugubre
besogne ; et puis, il faut bien l'avouer, les pelles et les pioches
manquent. J'avais vu ces corps dans la journée, corps
broyés par les obus, troués par les balles. J'avais
aperçu une cartouchière entr'ouverte, sur l'un de ces
corps, et, dans cette cartouchière, une carte postale que
j'avais eu la curiosité de lire : c'était la femme qui
écrivait à son mari (soldat Alphonse L...) et dans le
bas de la carte postale - qui représentait une épouse
dans l'attente de l'absent - son fils, un tout jeune enfant qui
commence à écrire, avait mis : Ton petit Roger qui
t'attend.
Je pense à ce pauvre orphelin, à cette pauvre veuve, et
à tous les deuils, et à toutes les souffrances
accumulées, et la désespérance me saisit. Je
sens entre les épaules un froid glacial, lourd comme du plomb.
Des larmes coulent de mes yeux. Est-ce l'émotion, est-ce le
froid ? Heureusement que mon tour de quart tire à sa fin et je
peux aller me réchauffer auprès d'un bon feu de
bois.
|
le  ervice ervice
|
Le service de quart fini, après un
léger temps de repos, il faut se mettre au travail, surveiller
les corvées, activer les hommes souvent négligents,
faire distribuer des munitions, creuser des tranchées, des
boyaux, des sapes ; placer des réseaux de fil de fer devant
nos lignes, faire aménager des emplacements pour les
guetteurs, vérifier chaque coin de la tranchée,
l'améliorer sans cesse.
Je me souviens de la répugnance des hommes à creuser
les premières tranchées ? Il fallait les faire sortir
des frêles abris où ils étaient blottis (abris
faits avec les branches feuillues placées en forme de cabane)
et les menacer de punition. Il fallait surtout employer la
persuasion, préférable aux menaces pour le
tempérament français et pour des hommes brisés
de fatigue. Nous avions pour faire ce travail quelques outils de
terrassier, mais surtout des outils portatifs, ce qui fait que la
besogne n'avançait guère.
La nuit, nous placions des réseaux en avant de nos lignes, et
nous avions le soin de ménager des sorties, des chicanes, dans
ces réseaux, pour le passage de la patrouille. Les hommes
plaçaient, sur le fil de fer des réseaux, des
boîtes de conserve, des cartouches vides, accouplées,
des clochettes même, dont le bruit, au moindre contact des
réseaux, avertissait les guetteurs qui redoublaient alors de
vigilance pour éviter une surprise.
On commençait aussi à se servir de bombes
sphériques qu'on lançait sur les agresseurs ou dans les
tranchées ennemies. Ces bombes, d'ancien modèle,
étaient lourdes à manier ; l'arrachement du rugueux
était difficile à opérer. Les premières
que j'ai aperçues étaient installées dans une
niche creusée dans la paroi de la tranchée, et un
Tartarin avait écrit sur une pancarte placée en
évidence à côté des bombes : "Dangereux !
Défense d'y toucher !"
Les cuisiniers apportaient la nourriture la nuit, car la circulation
était presque impossible le jour, à l'abord des
premières lignes, et les ennemis postés dans les arbres
ou sur les points culminants nous surveillaient et tiraient sur les
imprudents. Un cuisinier s'étant hasardé à se
montrer en plein jour fut tué d'un coup de feu qui l'atteignit
à l'épaule et lui coupa l'artère
sous-clavière ; un soldat du génie qui creusait une
sape ayant levé la tête fut tué net d'une balle
explosive ou retournée qui lui fit une plaie affreuse au
cou.
Il fallait donc conseiller la prudence aux hommes qui, en voyant le
danger, se mirent à creuser les tranchées et les boyaux
avec ardeur.
La nourriture arrivait toujours froide et les hommes prenaient leurs
repas froids : le riz, le bœuf formaient la base de la
nourriture. Les hommes couchaient "sur la dure" enveloppés de
leur couverture et de leur toile de tente. Et "sur la dure" est une
manière de parler, car la terrible boue nous servait souvent
de lit, et parfois de linceul.
|
une  lerte lerte
|
Par un clair de lune, on aperçoit une
ombre qui descend la colline de Vauquois, dans les terres qui
avoisinent la ferme dévastée de la Cigalerie. C'est
certainement un ennemi. Une autre ombre suit... puis une
troisième... Dans la vallée on aperçoit d'autres
ombres. A cent mètres de nos lignes une masse noire,
précédée d'autres ombres, comme une ligne
d'éclaireurs précédant une colonne d'attaque,
semble se diriger vers nous, sans bruit, en rampant, comme pour une
surprise.
A notre droite, un bruit de fusillade intense crépite... Le
bruit se rapproche et gagne de proche en proche toute la ligne. Les
hommes tirent sur les points noirs, sur les ombres, que l'on
aperçoit, sur la masse sombre qui paraît être une
colonne d'assaut. Les mitrailleuses, placées sur la hauteur,
en arrière de notre première ligne, se mettent de la
partie et balayent la vallée. L'écho des bois
répète avec fracas le bruit de la fusillade. Les balles
sifflent en passant au-dessus de nos têtes.
Après un quart d'heure de cette fusillade enragée
à laquelle répond une fusillade partie des hauteurs de
Vauquois, le bruit se calme, et l'on se rend compte que les points
noirs aperçus étaient des cadavres non encore
relevés, la masse sombre une haie, et ces trois ombres qui
descendaient la colline une patrouille boche ou peut-être des
détrousseurs de cadavres.
A peu près toutes les nuits, des fusillades intenses se
produisent ainsi sans cause souvent bien déterminée.
Quelques hommes, affolés, tirent au hasard, les voisins en
font autant, la première ligne s'embrase de proche en proche,
et cela parfois pendant des heures entières...
A partir de sept heures du soir, en octobre, il n'est pas prudent de
quitter la tranchée, car l'ennemi aussi est sujet à ces
paniques. Dès que la fusillade éclate, il faut rester
à l'abri. Mais si l'on est dehors, en patrouille ou en
service, à placer du fil de fer, il faut se coucher
immédiatement, s'aplatir contre terre. Ce ne sont pas
seulement quelques balles qui passent, mais des milliers de balles
qui volent, avec leur bourdonnement particulier. Le Capitaine que
j'avais remplacé dans le poste que j'occupe avait
été tué ainsi, une nuit, par une balle. Et on
l'avait trouvé le lendemain, raidi, dans la feuillée
où il était allé imprudemment.
Quand on quittait cet enfer pour aller au repos, le bruit du
crépitement de la fusillade persistait dans les oreilles
pendant plusieurs journées...
|
la  elève elève
|
La relève a lieu par une nuit noire.
Nous sommes remplacés par le 4e d'infanterie. L'officier qui
commande la Cie qui nous remplace est un jeune gosse
échappé de Maubeuge. En quelques mots, il nous raconte
son odyssée et, naturellement, nous parle de sa famille, de sa
mère... Pauvre cher gosse ! Pendant ce temps, la nouvelle
compagnie arrive, s'installe, et nos hommes prennent le chemin de
l'arrière, par des pistes remplies de boue, des
fondrières où l'on disparaît... Défense
absolue de se servir de lanternes, de lampes électriques. Il
est défendu aussi de fumer... Les hommes, à la queue
leu leu, dans les bois sombres, trébuchent les uns contre les
autres, dégringolent avec un bruit de marmite et de gamelle
qui s'entrechoquent.
Malgré tout, nous sommes contents de sortir de la fournaise,
et d'aller passer huit jours à l'arrière, dans un bon
petit patelin, où l'on pourra dormir tranquillement, la nuit.
Aussi, malgré le poids écrasant du sac, des armes et
des musettes, malgré les heurts et les à coups, la
colonne avance assez vite...
A quelques kilomètres des lignes, en un point masqué
aux vues de l'ennemi, la troupe fait halte et le capitaine permet aux
hommes de fumer ; et malgré le cauchemar qui nous enveloppe
encore, les hommes rient et échangent des lazzis.
Après huit longues journées et huit longues nuits
d'angoisse, les nerfs se détendent, le cœur
s'épanouit à la pensée d'un bon gîte, d'un
bon lit de paille, de repas chauds, de café brûlant et
d'un bon repos à l'arrivée.
Un sergent s'approche de moi et me montre, dans l'horizon noir, vers
le sud, une lumière : "Ce sont sans doute des signaux faits
aux boches par un espion." Je regarde attentivement cette
lumière et, en effet, on aperçoit distinctement une
lueur qui tantôt brille puis s'éteint pour luire un
instant après.... Cela paraissait venir d'une colline
lointaine, car la lueur avait un éclat très
atténué. Mais en observant plus attentivement, je vis
que la lumière était produite, non par un espion
faisant des signaux, mais par un troupier qui, placé à
quelques pas de nous, fumait tranquillement un cigare qui brillait,
la nuit, à chaque aspiration du fumeur.
La route fut reprise et, après une heure de marche, il y eut
une nouvelle halte. J'étais accablé de fatigue. A un
moment, je dis au Capitaine : "Voyez donc ces lueurs qui filent,
là-bas ! On dirait des cyclistes ! Pourquoi ont-ils
allumé leurs lanternes ?" Et au même instant je tombai
à terre, pris d'évanouissement. (Les lueurs que j'avais
aperçues étaient des feux de cuisine. Si j'avais cru
les voir filer, c'est parce que la tête me tournait.) Quelques
gouttes d'eau de vie me ranimèrent, mais j'étais
épuisé, incapable d'un grand effort.
Une voiture de vaguemestre d'artillerie passant, je donnai mon sac au
conducteur qui devait déposer mon "fourniment" au poste de
secours de Clermont en Argonne. Mais le conducteur s'appropria le
tout (mon sac contenait tout mon linge et une chaude couverture) et
je ne trouvai rien en arrivant à Clermont...
Je fis tout le trajet à pied, et arrivai au cantonnement (les
Islettes) avec un soupir de satisfaction.
|
 u
cantonnement u
cantonnement
|
Nous sommes au village des Islettes pour huit
jours. Je suis logé dans une maison située sur la route
de Tuteaux. Le "patron" de la maison est forgeron, et il me loge dans
une petite mansarde, sur un grabat où couchait son apprenti
avant la guerre. Je suis content de trouver ce grabat qui excite
l'envie d'un camarade logé à la belle
étoile.
Aussi je reçois sa visite. Il entre dans la pauvre
pièce, examine, et dit : "Vous êtes logé dans mon
secteur, et je vous prie de me céder votre place." Je lui
réponds que ma Cie est logée à proximité,
ainsi que le Capitaine, et que je reste où je suis. Il
répond qu'il est lieutenant commandant de Cie et, comme tel, a
le droit de priorité. (J'avais refusé de prendre un
commandement de Cie, ne me jugeant pas apte et
préférant le commandement d'une section.) Je lui
affirme que cette affaire va se régler par ancienneté,
devant le Commandant.
L'intrus quitte la place sans insister...
Ceci, simplement pour montrer combien un simple grabat pouvait
exciter les convoitises, après huit jours et huit nuits
passées à coucher à la belle étoile, dans
l'eau, dans la boue, dans le froid, dans l'enfer...
Après un bon repas, dans une cuisine bien chauffée mise
à notre disposition par le forgeron, je ne ressentais presque
plus aucune fatigue. Un bon sommeil, sur mon lit de camp, dans ma
chambre obscure, acheva de me remettre.
Le lendemain, je visitai le village. Il n'avait pas trop souffert de
la guerre ; les boches, à leur passage, s'étaient
contentés de piller et non d'incendier, contrairement à
ce qu'ils avaient fait à Clermont-en-Argonne. Aux Islettes,
quelques maisons étaient détruites. Comme
c'était un dimanche, je me rendis à l'église.
C'est là que j'aperçus pour la première fois le
général Gouraud, adoré des soldats.
C'était un bel homme, imposant avec sa longue barbe, mais
affable et souriant. Je pénétrai ensuite dans le
cimetière où dorment tant de soldats et je vis une
femme qui sanglotait, soutenue par des sous-officiers. C'était
la veuve d'un adjudant, tué récemment (l'adjudant
Bernard).
Elle était venue prier et pleurer sur la tombe de son mari, et
la détresse de cette malheureuse femme faisait venir les
larmes aux yeux de tous les assistants. Quelle terrible chose que la
guerre !
Nous passâmes huit jours dans ce village pauvre mais
hospitalier, puis nous fûmes envoyés dans la forêt
d'Argonne.
|
un  ncendie ncendie
|
Le sergent Rollet, de ma section, s'est fait
construire un petit abri, aux premières lignes où nous
sommes venus, non loin de la Haute-Chevauchée. L'abri n'est
pas très solide : les murs sont faits avec des mottes de terre
empilées les unes au-dessus des autres. Le toit est
formé avec de légers rondins recouverts de mottes. Une
ouverture forme l'entrée. Une cheminée, en mottes
aussi, dans laquelle flambe un bon feu, réchauffe mais enfume
la pièce dans laquelle on entre à "quatre pattes".
Mais Rollet exagère. En sybarite qu'il est, il chauffe, il
chauffe la pièce - le bois ne manque pas ! - et les
étincelles communiquent le feu aux rondins. Comme il est nuit
noire, les boches aperçoivent les lueurs de l'incendie, et ils
tiraillent dans la direction de la baraque en feu. Pas de
récipient pour puiser l'eau. Rollet prend un soulier, puise de
l'eau (?)
dans un urinoir à proximité, et éteint assez
rapidement l'incendie, non sans risque d'être tué, car
les balles pleuvent autour de lui.
Cet incident défraya longtemps la popote des sous-officiers,
et Rollet reçut, à cette occasion,
l'épithète de pompier, qu'il avait bien
méritée.
|
un  iège iège
|
Nous occupons un élément de
tranchée avancée et il faut réunir cet
élément à notre système de
tranchées par une sape. Quelques soldats du génie y
travaillent. A mesure que la sape avance, elle est recouverte avec
des rondins.
Des créneaux en acier protègent les travailleurs. Un
guetteur, le fusil prêt à tirer, surveille les
tranchées des boches.
Un jeune soldat du génie, observant par l'ouverture du
créneau, aperçoit un casque boche. Sans se douter du
piège, le jeune soldat veut avoir le casque. Il se procure une
perche qu'il munit d'un crochet et essaye d'attraper le casque. Mais
les bandits veillaient. Le pauvre jeune homme reçut une balle
en pleine tête et tomba sans vie dans la sape. Mais notre
guetteur qui avait vu le boche ajuster fit feu, les deux coups de
fusil se confondirent, et l'assassin tomba mort aussi.
J'étais accouru au bruit de la double détonation et me
rendis compte de ce qui s'était passé et du
piège dans lequel étaient tombés nos
soldats.
|
un  rdre
bien donné rdre
bien donné
|
Je vais en réserve avec un peloton. Les
hommes sont employés, les uns à charrier des rondins
pour les premières lignes ; les autres sont établis en
petits postes, en arrière de la première ligne. Le
commandant prend les 2 ou 3 hommes qui restent à "faire" du
bois pour sa cagna. Tout le monde étant ainsi employé
et dispersé, le commandant me fait appeler :
"Vous allez faire une tranchée en travers de la
Haute-Chevauchée ; puis vous ferez des flanquements, ici et
là, à droite et à gauche de la
tranchée..."
Oui, mais je n'ai pas d'homme disponible. De plus, je n'ai pas
d'outils, ni pelles ni pioches. Ce que la compagnie possède
d'outils est resté aux premières lignes, pour le
travail. Je fais mes objections au Commandant :
"Débrouillez-vous, répond-il. Si le travail n'est pas
fait ce soir, j'aviserai."
J'avais trois outils en tout, des outils "volés", et il en
faut deux pour creuser une fosse à un camarade tué.
Et dire que nous avons laissé tant de pelles et de pioches
à Besançon ! J'avais vu dans l'église de Larnod
tout un amoncellement d'outils tout neufs qui auraient bien fait
notre affaire ici. Depuis le mois d'avril, les hommes ont perdu la
plupart de leurs outils portatifs ; et les outils de parc sont
presque introuvables. Comment faire creuser une tranchée sans
hommes et sans outils ? Je n'ai jamais pu résoudre le
problème.
Mais le lendemain, on supprima quelques petits postes, on me donna
quelques outils et je pus commencer le travail.
|
 eux
bons repas eux
bons repas
|
Nous sommes revenus à Neuvilly,
où j'ai débuté en arrivant au régiment.
Ma compagnie est logée dans les granges. J'adopte un coin,
dans une chambre où je fais placer une bonne épaisseur
de paille qui me servira de lit.
Les officiers du bataillon prennent leurs repas dans une salle
commune, une salle à manger à peu près
respectée par les obus.
Le premier jour de notre arrivée au village, les obus pleuvent
autour de l'église. C'est la Toussaint et les ennemis visent
certainement l'église qu'ils supposent remplie de gens.
La trajectoire du tir passe invariablement au-dessus de la
rangée des maisons où nous sommes en train de manger.
Un obus tombe sur notre local, démolit la toiture en
éclatant, perce le plafond dont les débris
dégringolent avec fracas dans les assiettes, les plats sans
occasionner d'accidents de personne.
Depuis plusieurs jours, paraît-il, le tir de l'ennemi passe
au-dessus de la même rangée de maisons (celle de gauche,
en faisant face au nord) et nous décidons d'aller nous
installer en face, dans la rangée de droite. Nous trouvons une
maison à peu près intacte, habitée par une
vieille femme, la seule habitante du village, qui n'a pas voulu
quitter le local où elle avait vécu. Les cuisiniers
transportent leur "barda" dans cette maison, et nous allons nous
mettre à table, dans la salle à manger, vers onze
heures, à l'abri du tir.
Le bombardement boche recommence sur le village. Un obus bien
pointé tombe devant la maison que nous occupons. La cloison
peu épaisse s'écroule avec fracas, et une grande
quantité de terre, de plâtras, s'écroule dans la
pièce, tombe dans la casserole posée sur la table.
Adieu le bon bœuf aux carottes qui paraissait si savoureux !
Heureusement qu'aucun de nous n'est blessé !
Le bombardement redouble. Un obus tombe en face du petit ponceau
placé sur la route qui traverse un ruisseau affluent de
l'Oise. Quelques hommes qui s'étaient réfugiés
sous ce ponceau sont tués ou blessés.
Un autre obus tombe dans un local occupé par mes hommes.
J'avais eu le soin de les placer entre deux meules de foin, mais
l'obus tombe exactement devant l'ouverture et tue ou blesse sept
hommes. Le clocher est atteint par un obus. Vraiment le séjour
en réserve n'est pas agréable, surtout à l'heure
des repas. On croirait que les boches sont renseignés sur nos
faits et gestes : les hommes sont au travail, de ci de là,
à creuser des tranchées, à charrier des
matériaux, à réparer des chemins, enterrer les
cadavres des chevaux, etc, et sont dispersés aux quatre coins
de l'horizon pendant toute la journée, sauf au moment des
repas où ils se réunissent dans le village. Qui peut
renseigner ainsi les boches ? Et pourquoi bombardent-ils Neuvilly au
moment même où les hommes y sont rassemblés ?
J'ai appris par la suite qu'on avait fusillé un fermier des
environs du village. Au moment où les troupes entraient au
village, il conduisait ses vaches dans un certain pré, signal
convenu à l'avance avec l'ennemi qui avait des vues sur ce
pré. Je n'ai pu vérifier l'exactitude du
fait.
|
les  remiers
abris à Neuvilly remiers
abris à Neuvilly
|
Neuvilly étant bombardé, il faut
l'évacuer, car le séjour y est très malsain. On
crée des abris à l'est du village. On creuse le sol,
à découvert, et on découpe ainsi de vastes
rectangles pouvant contenir 30 ou 40 hommes couchés. Les abris
sont couverts avec des poutres enlevées aux maisons, des
portes des granges, des planchers, des portes d'appartement, des
meubles de toute espèce, buffets, armoires, etc. Les habitants
retrouveront, après la guerre, tout leur mobilier placé
ainsi sur ces abris, mais en quel état ?
Le sergent Rollet, antiquaire de profession, fait mettre en lieu
sûr quelques portes d'armoire très anciennes, qu'il
estime à plusieurs milliers de francs.
Les abris, une fois couverts de planches, meubles, etc, posés
sur les solives et les poutres, sont encore revêtus d'une
couche de terre.
Le sol de chaque abri est tapissé de paille
récoltée dans les granges. Les constructions n'offrent
aucune résistance aux obus, et ne présentent que des
dangers. Pendant un bombardement, 20 hommes furent tués dans
un de ces abris. Il aurait fallu les faire plus résistants,
mais les rondins manquaient. Nous n'avions pas assez d'outils pour en
couper dans la forêt voisine (nous n'avions que quelques haches
et serpes régimentaires qui ne coupent pas) et d'ailleurs les
moyens de transport manquaient, les ennemis ayant brisé toutes
les roues et les brancards des charrettes ou voiture de la
contrée. On avait eu beaucoup de mal à abattre un seul
arbre qu'un cheval avait amené à grand' peine en le
traînant sur le sol, avec une chaîne.
Aussi, pendant les bombardements, les hommes sortent des abris et se
mettent en ligne d'escouade par un, à larges intervalles. Tout
au plus ces abris préservent-ils des intempéries, mais
cet avantage n'est pas suffisant, et nous y sommes à la merci
du premier obus lancé par l'ennemi qui a, par avions,
exactement repéré nos positions.
|
un bon  aire aire
|
Je suis évacué pour fatigue
générale et bronchite. Je vais à l'hôpital
(à Mâcon, au lycée de filles, transformé
en hôpital) où je suis dorloté pendant quinze
jours, puis j'obtiens quarante-cinq jours de convalescence.
Je suis heureux d'aller passer quelques jours
chez moi. C'est l'époque du jour de l'an. Je m'installe au
coin du feu et j'aide ma femme à faire le travail de mairie,
et cela n'est pas superflu, car depuis la scène burlesque de
Mme la mairesse, le maire, vengeur, complique la besogne. Il garde
les circulaires, ce qui rend le travail inextricable ; il conserve
chez lui les papiers qu'il doit signer. Il joint à cela de la
mauvaise volonté, passant devant la mairie sans y entrer
jamais, laissant "traîner" toutes les affaires pendantes. Il
est évident qu'il veut se débarrasser de ma femme comme
secrétaire pour donner cet emploi à son valet de
chambre. Il me fait appeler chez lui et me laisse debout dans sa
bibliothèque. Je lui dis qu'étant officier
convalescent, je ne pourrai désormais me rendre à ses
appels à son domicile ; et que les affaires se
régleront à la mairie. Mais il exige que ma femme et
moi y allions chaque soir à six heures. A six heures du soir,
en janvier, il fait noir pour circuler dans les chemins, et il faut
côtoyer un étang. Mon fils, se rendant chez le maire,
par une nuit obscure, était tombé à l'eau et
avait failli se noyer, ce qui avait fait rire aux larmes les deux
époux. Je défends à ma femme d'aller chez le
maire. Je n'y vais pas non plus, car je suis fatigué, et
j'estime que le maire doit traiter toutes les questions à la
mairie.
Ce qui m'indignait le plus, c'est de penser qu'avant la guerre ces
gens-là frayaient avec nos ennemis, étaient les intimes
de cette Koetsemberg, une espionne sans nul doute. De plus, on
racontait que Madame la mairesse avait reçu par la Hollande
une lettre de Brême, dans laquelle la Koetsemberg demandait
à Madame de mettre en sûreté son mobilier,
surtout sa bibliothèque... et je devinais le reste.
Tout cela me mettait hors de moi. Un officier français,
convalescent, ne peut aller se tenir debout devant des gens qui
veulent l'humilier dans sa qualité d'officier français.
Quoiqu'instituteur, j'avais conscience d'être dans mon
rôle en ne retournant pas chez le maire.
Aussi, il m'apprit qu'il diminuait mon traitement de mairie de 20f,
chose inadmissible : il prit pour prétexte ma démission
des œuvres agricoles que je gérais gratuitement. Ma femme
en profita pour laisser la mairie au maire et pour se retirer du
patronage de jeunes filles qu'elle avait créé.
Elle retrouva son indépendance, mais non sa
tranquillité.
Le valet de chambre du maire fut nommé secrétaire de
mairie.
|
Au  épôt épôt
|
Je ne reste que quelques jours chez moi, juste
le temps de faire le travail de fin d'année de la mairie,
travail auquel j'étais habitué en temps de paix. Ayant
renoncé à ma convalescence, j'arrive au
dépôt le 18 janvier. Je passe "la visite" et je demande
à repartir sur le front. Mais le médecin m'ayant
déclaré "inapte momentanément", je suis
désigné pour commander une compagnie du
dépôt en remplacement d'un capitaine malade et je vais
rester quelques semaines à l'arrière. Ce seront les
seules, mais je ne les regrette pas, car j'y ai vu certaines choses
intéressantes.
Ma compagnie compte 550 hommes à l'effectif. A cette
époque, les dépôts avaient encore un grand nombre
de disponibilités provenant des
récupérés, de gens qui s'étaient
débrouillés jusqu'alors pour ne pas partir ; de GVC des
jeunes classes ; de malades ou de blessés ayant
déjà été au front et renvoyés au
dépôt après leur guérison ; de
territoriaux, etc.
Et à chaque instant on puise dans nos effectifs des renforts
pour le front ou pour divers services.
La Compagnie va à l'exercice chaque jour, souvent nous faisons
du service en campagne et des marches assez longues. Le Commandant du
dépôt, blessé au début de la guerre, le
Chef de Bataillon L... est un excellent homme ; et le commandant du
Bataillon, Capitaine B..., dont j'ai gardé un bon souvenir,
s'occupe activement de son unité. Je les vois souvent tous les
deux et nos relations sont empreintes de cordialité.
Nous cantonnons dans une commune aux environs de S... et nous menons
la vie monotone du soldat en caserne, entrecoupée de petits
incidents.
|
la  isite isite
|
A chaque départ pour le front, les
hommes désignés passent la visite et je me fais un
devoir d'y assister. Les hommes défilent dans une salle
chauffée de l'infirmerie. Ils sont tous en costume d'Adam, et
le médecin les examine l'un après l'autre. Voici un
soldat résolu qui déclare : "Je demande à partir
!" On dirait que cette déclaration est contagieuse, car les
suivants, gagnés par l'exemple, font de même. Puis,
arrive un "froussard" qui a combiné sa petite affaire : "J'y
vois double, M. le Major ! - Comment ! Comment ! Qu'est-ce que cette
histoire ? Combien y a-t-il de doigts ? (le docteur montre un doigt.)
Réponse : Deux. "Combien y en a-t-il à présent
?" (le docteur montre deux doigts) Réponse : quatre... Le truc
a réussi.... pour cette fois, croit le trouffion.
Et quand un homme a commencé a dégoiser ses maladies,
les suivants imitent son exemple : c'est alors la série des
froussards. L'un dit : "Je suis trop gros !" Un autre : "J'ai des
grosses couilles !" Un troisième : "J'ai une maladie de
cœur" (Que de lascars se sont trouvés une maladie de
cœur pour ne pas partir !) Un quatrième, frais et rose :
"J'ai le ver solitaire !"
Et le bon médecin classe tous ces gens qui défilent, en
trois catégories : 1° ceux qui sont bons à partir
; 2° ceux dont le départ est laissé à mon
appréciation ; 3° enfin, ceux qui ne peuvent pas partir
encore...
Pour ceux de la 1re catégorie, rien à faire : ils
doivent partir ; pour ceux de la 2e catégorie, ils partiront
aussi, quoi qu'ils fassent pour échapper au filet.
Le gros bonhomme pesant 104 kilogs, classé dans la 2e
catégorie, se déclare incapable de partir. Le
Commandant auquel il a voulu parler lui annonce froidement qu'au bout
d'un mois de tranchées, il ne pèsera plus que 80
kilogrammes et que son envoi au front lui sera salutaire. L'homme qui
a le ver solitaire partira aussi. Un homme, jeune et bien portant,
venant des GVC, vient me dire qu'il ne sait pas prendre la ligne de
mire. Et alors, que faisait-il avec son flingot, depuis août
1914 jusqu'en janvier, le long des voies ferrées. Il partira
et apprendra à mettre en joue derrière les
créneaux, à la tranchée.
Un autre me dit : "Mon lieutenant, vous ne pouvez me faire partir,
car vous encourriez une grave responsabilité : j'ai des
éblouissements parfois." Je lui réponds que j'encours
cette responsabilité sans crainte, car j'ai vu "de braves
petits gars" moins bien bâtis que lui faire bravement leur
devoir.
Quant à l'homme qui voit double : "Tu tueras deux boches
à la fois, ça sera chic !" et le tour est
joué.
Quelques-uns, cependant, échappent au filet, et je n'ai pu
réussir à faire partir le sergent L..., malgré
toute ma bonne volonté. Mais si j'étais resté
quelques jours de plus à S... je l'aurais porté
moi-même dans le train pour le voir partir.
C'était un "gars" pistonné sans doute...
Bref, c'est ainsi qu'on opérait au moment d'un départ
au dépôt de mon régiment.
|
 épart
brusqué pour le front épart
brusqué pour le front
|
Il est sept heures du soir. Les hommes ont
quitté le cantonnement et ne seront tous rentrés
qu'à l'appel de neuf heures. L'ordre arrive de préparer
immédiatement un renfort de 40 hommes qui doit se trouver
à 10 heures du soir à la gare de S..., prêt
à embarquer pour le front. Comment faire pour trouver ces
quarante hommes ? Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu plus
tôt, avant la sortie des hommes qui, après le repas du
soir, vont faire une promenade en ville ? N'importe, il faut agir et
agir vite. A mesure que les hommes vont revenir, on prendra leurs
noms, d'office, on les fera équiper immédiatement. Ils
seront rassemblés devant le bureau, et... en route pour le
front.
La nuit est noire... On ne voit pas à deux pas devant soi. Je
me poste à l'entrée du village, une lanterne à
la main. Le fourrier est à côté de moi.
Et à mesure que les hommes arrivent, ils sont
arrêtés au passage. Ils fournissent leur nom et
reçoivent l'ordre d'aller s'équiper
immédiatement. Le fourrier trouve ainsi, au petit bonheur,
quarante noms, et le détachement peut partir assez tôt
pour être en gare à l'heure fixée. Oui, mais il
fallait entendre les cris et les vociférations de ceux qui,
n'ayant pas été désignés pour partir,
étaient ainsi pris d'office !
Bref, avec ma lanterne, j'ai trouvé 40 hommes, alors que
Diogène n'en avait point trouvé.
les
gares pendant la Grande Guerre / un repère pour
le soldat
|
|
 on
arrivée au 143e on
arrivée au 143e
|
J'ai demandé à être
renvoyé sur le front. Je suis affecté au 143e
d'infanterie qui vient d'avoir des pertes sérieuses aux
attaques du bois Sabot, en Champagne. J'arrive à Valmy. De
Valmy je vais à St Jean sur Tourbe, où je passe la
nuit, et le lendemain matin je rejoins le régiment qui est en
ligne ? Il occupe le secteur entre les Hurlus et Mesnil les
Hurlus.
Le paysage est d'une tristesse déconcertante. Les villages que
l'on traverse (St Jean sur Tourbe, Laval, Hurlus...), à peu
près entièrement détruits, sont lamentables. Les
chemins, les pistes, sont de véritables cloaques dans lesquels
on enfonce jusqu'à la cheville et parfois jusqu'à
mi-jambes. La terre est blanchâtre, crayeuse... Quelques
plantations de sapins, de ci de là, dans la campagne, mettent
une note sombre dans cette blancheur.
A partir de Mesnil les Hurlus, totalement rasé par la guerre,
mais où j'aperçois un vaste cimetière, on quitte
la piste et on prend le lacis de boyaux. Un guide me conduit
auprès du Colonel qui est dans son P.C. construit dans un
bosquet de sapins, à 500 m. en arrière des
premières lignes. Le Colonel m'affecte au commandement de la
2e Cie. Je continue ma route, et je rencontre le Chef de Bataillon au
moment où il s'engouffre dans sa cagna car les 77 pleuvent. Il
n'est pas pressé de lier connaissance, car je ne le revois
plus. Je rejoins ma Cie qui occupe les premières lignes.
Le Lieutenant qui commande la Compagnie (le Capitaine avait
été tué) m'indique mon abri. C'est un trou
creusé dans le parapet. Je peux y tenir couché, ou
assis en courbant un peu la tête. Le lieu n'est pas très
confortable. Il y a mieux. N'importe ! Puisque d'autres camarades
vivent là, pourquoi n'y vivrai-je pas aussi ?
Le lieutenant m'informe qu'il a enlevé la paille de la cagna
parce qu'elle était remplie de poux. Les Marocains que nous
remplaçons - car le régiment occupe le secteur depuis
deux jours seulement - ont laissé beaucoup de vermine et le
sol des cagnas en est pavé.
Il place mes couvertures dans le fond de mon abri ; et à
défaut de paille, je m'allongerai sur une couverture, tandis
que l'autre servira à m'envelopper lorsque, pris de sommeil,
je voudrai dormir un instant. Bref, j'organise mon home.
Parfois une odeur épouvantable se fait sentir. "C'est Fritz
qui lance cette odeur, me dit le lieutenant." Fritz est un boche
mort, entre les lignes, et il nous envoie ses pestilences. Il est
là, à deux mètres de ma cagna.
Mais d'autres Fritz sont étendus ainsi, tout le long de la
ligne - à côté de Français, hélas !
Jetant les yeux du côté de la cote 196, je la vois
jonchée de cadavres. C'est un véritable charnier. On en
enlève chaque nuit. Ceux qu'on ne pourra pas enlever resteront
ainsi.
En parcourant les tranchées, partout où je regarde,
j'aperçois des cadavres. Les uns sont à peine
enterrés : on aperçoit une main qui sort, une botte qui
émerge, une tête qui grimace, un thorax qui a
été sectionné. D'autres n'ont aucune
sépulture et ils empoisonnent l'air. Je circule avec un flacon
d'eau de Cologne sous le nez.
Le secteur de Perthes les Hurlus - les Hurlus - Mesnil-les-Hurlus est
un énorme cimetière où nous allons passer de
longs mois de souffrances, de mars à avril 1915.
Ce fut certainement un des plus mauvais coins du front, et je
n'exagère pas en disant que le régiment a perdu, de
mars à août 1915, plus de deux mille tués ou
blessés.
|
les  ombes ombes
|
La Cie doit faire six jours de ligne.
Dès mon installation, je parcours la première ligne.
J'examine chaque emplacement de guetteur. Je donne des ordres pour
l'aménagement, l'amélioration de chaque créneau.
Le chef doit veiller sur ce point, car si l'installation est
défectueuse la sentinelle est en danger. Les tranchées
ennemies sont assez rapprochées des nôtres. On compte de
30 à 40 m en moyenne d'une ligne à l'autre. Les petits
postes sont bien plus rapprochés. Il y en a qui sont à
4 ou 5 m d'un autre P.P. ennemi. Les tranchées ne sont pas
rectilignes, et parfois les lignes ennemies prennent d'enfilade les
nôtres. Il faut donc protéger les sentinelles et ceux
qui circulent dans la tranchée contre le tir d'enfilade.
Voilà la besogne du chef de section. Mais le commandant de
Compagnie doit s'assurer que cette besogne se fait. Pour
préserver l'homme, on creuse une niche dans le parapet ; on
place des "ponts" sur la tranchée, on élève un
mur de sacs à terre...
A courte distance, l'envoi des bombes à main est facile et on
ne s'en prive pas. Puis, on se servait des crapouillots, des canons
Aazen qui lançaient les bombes à une assez grande
distance.
Le crapouillot se compose d'une lourde pièce de bois qui forme
la base de l'instrument. Dans cette pièce de bois se trouve
fixée une chemise d'obus qui forme avec la pièce de
bois un angle d'environ 45 degrés. La chemise d'obus est munie
d'une ouverture à la base pour y placer la mèche.
Le crapouilloteur met de la poudre dans l'obus qui sert de canon,
place la mèche, met une bombe Gellerier dans le canon et
allume la mèche. La bombe est projetée plus ou moins
loin. Il s'agit pour le crapouilloteur de régler son tir,
c'est-à-dire d'orienter convenablement son instrument, afin de
lancer sa bombe sur un blockhaus ennemi, à un croisement de
boyaux, sur les crapouillots adverses, etc.
Il doit savoir doser la quantité de poudre, pour obtenir un
tir à peu près à la distance voulue. Un guetteur
est chargé de voir le point de chute de la bombe, afin que le
tir soit modifié s'il y a lieu, soit pour la direction, soit
pour la distance.
Le Ct de la Cie doit choisir judicieusement les emplacements de
crapouillots, et trouver d'autres emplacements lorsque les premiers
sont repérés par l'ennemi.
Il faut aussi que le Ct de Cie vérifie les abris des hommes
qui se composaient, à mon arrivée au régiment,
de simples alvéoles creusées dans la paroi du parapet.
J'examine si les hommes sont, dans leur abri individuel, suffisamment
protégés contre la chute ou les éclats d'une
bombe, et je fais placer devant chaque alvéole des
rangées de sacs qui serviront de
pare-éclats.
|
 n
bon abri n
bon abri
|
Vraiment, mon abri est malsain. Fritz
l'empuante de plus en plus. Il faut fuir. Je charge quelques hommes
de me faire un abri. Je le fais creuser dans le boyau qui
accède à la première ligne, exactement au point
de rencontre de la tranchée et du boyau.
Je fais creuser une pièce de 2 m. sur 2 m. La terre est
placée dans des sacs. Une ouverture de 1 m est
aménagée. Des rondins sont placés sur l'abri.
Les sacs à terre sont placés sur les rondins, et
voilà un gîte confortable. Je le baptise : "Villa des
Cent Sous" car j'avais donné 5f d'étrennes aux
ouvriers.
Je fais placer de la paille fraîche dans un coin : ce sera mon
lit. Avec quelques planches, un homme adroit m'installe une table et
un banc. Mon gîte me servira de chambre à coucher et de
salle à manger. Je suis loin de mon boche. Il ne m'empoisonne
plus. Je n'ai presque plus de poux, tout au plus une ou deux
douzaines chaque jour. C'est peu ! Mon camarade Gobillard, lieutenant
à la Cie, agrégé de philosophie, m'aide à
les tuer. Il est heureux quand il en trouve un blotti dans un pli de
la chemise. Le pou a beau être roublard, et chercher à
esquiver la mort, il ne l'est pas autant que l'agrégé
de philosophie qui l'occit sans pitié. Et voilà
comment, lorsqu'on est mal, on peut être mieux, sans
être, d'ailleurs, confortablement installé !
Bagues en aluminium et
cannes en bois
lire
à ce sujet
|
|
 e
sous-lieutenant de ma Cie e
sous-lieutenant de ma Cie
|
Je dois un chapitre à mon cher camarade
Gobillard, le seul officier de ma Cie. Le régiment a subi
beaucoup de pertes depuis le début, et les cadres sont
réduits. Sans les renforts fréquents, il y a longtemps
que le régiment n'existerait plus ni en cadres ni en
hommes.
Mon camarade, ai-je dit, est agrégé de philosophie. Il
est du département du Nord, des régions envahies. Avant
la guerre, il était à Anvers, professeur dans un
lycée d'influence française ? C'est un jeune homme
plein de bon sens, animé d'un patriotisme
éclairé, qui fait la guerre depuis le début. Il
sera pour moi, plus qu'un excellent camarade, mais un ami
sincère. Quand on vit en commun, qu'on partage les mêmes
périls, les mêmes dangers, comment ne pas s'aimer ? Nous
avons vécu plusieurs mois ensemble, dans un des plus mauvais
coins du front français, et cela ne peut s'oublier. G... est
comme moi, il a des poux, mais il ne se contente pas d'une douzaine
de ces malfaisants insectes, il lui en faut davantage. Son corps en
est couvert, à tel point que le docteur l'évacue
à St Rémy sous Buxy pour huit jours. Il faudra bien
huit jours pour qu'il soit débarrassé de sa sale
vermine.
G... est philosophe - il doit l'être par définition,
puisqu'il est agrégé de philosophie - et il accepte la
vie comme elle vient, et les poux par-dessus le marché.
Mais, par exemple, il n'aime pas que les boches le chatouillent trop.
Dès qu'une bombe est lancée par l'ennemi, il fait
riposter par 20, par 50, par 100 bombes et davantage, s'il le faut.
Et chaque jour, et souvent plusieurs fois par jour, il y a combat de
bombes. Parfois la lutte devient homérique. Les deux partis
s'entêtent. Alors, on a recours au juge de paix, en
l'espèce notre vaillant 75, et les boches se taisent comme par
enchantement.
Notre secteur n'est pas le "filon", et les nombreuses tombes de nos
chers camarades, tombés dans ces combats de bombes ou de
grenades, sont là pour l'attester. Je ne puis penser sans
pleurer aux héros du 143e qui dorment leur dernier sommeil aux
Hurlus ou au Mesnil, ou dans les cimetières avoisinants.
Dans un de ces combats, mon brave G... reçut un éclat
de grenade dans l'œil gauche. Il a été
évacué, et après guérison - il a perdu un
œil - il a continué à servir son pays dans un
bureau au Ministère de la Guerre.
|
 on
cher Gob... on
cher Gob...
|
Mon camarade Gob..., ancien sergent
retraité des troupes coloniales, est arrivé comme
sous-lieutenant au régiment.
Il a été nommé lieutenant, puis capitaine, et
chevalier de la Légion d'honneur. A Verdun, un obus (210) l'a
rendu fou et il a été interné dans une maison de
santé. Sa perte me fut cruelle.
|
 es
crapouilloteurs es
crapouilloteurs
|
Je n'oublie pas dans mes souvenirs mes bons
crapouilloteurs. A tout seigneur tout honneur : je parlerai d'abord
du caporal Delcellier qui fut plus tard sergent.
Il était plein de courage et d'audace, et je suis sûr
que son tir a été souvent d'une grande
efficacité, et qu'il a démoli quantité de
boches. Il a toujours le dernier mot avec les boches. Il était
d'un entêtement admirable. Il avait pour le seconder le brave
Barthélemy et le brave Bouillet.
Barthélemy avait un assez fort embonpoint et le
sous-lieutenant l'avait surnommé Sancho Pança.
Bouillet, au contraire, était long et mince, et avait
été surnommé Don Quichotte par mon
facétieux camarade. Braves gens, admirables soldats tous les
trois. Ces trois hommes formaient une équipe incomparable.
Le caporal installait ses crapouillots, mettait la poudre et la
mèche. Barthélemy plaçait les bombes et
allumait. Bouillet regardait les points d'arrivée des bombes
et faisait allonger ou raccourcir le tir ou changer de direction. Il
fallait aussi veiller à la riposte : écouter les
départs et suivre la direction des bombes boches. Et pendant
des heures entières, s'il le fallait, ils combattaient,
bouleversant les lignes ennemies, rendant tranchées et boyaux
boches intenables, occasionnant à l'adversaire des pertes
appréciables dont on se rendait compte par les hurlements, les
cris des blessés, ce qui avait le don de faire sourire
Delcellier.
Inutile de dire que Delcellier possédait la croix de guerre,
et jamais récompense ne fut mieux méritée.
Bref, pour la manœuvre des crapouillots, il était d'un
cran inimitable, et bien souvent on a fait appel à la science
de mon brave caporal pour l'organisation d'une équipe.
Bouillet, pendant un combat, eut le bras atteint par une bombe. Il
fut amputé. Aujourd'hui, il porte la croix de guerre et la
médaille militaire qu'il a glorieusement gagnées.
Delcellier fut blessé, pendant les attaques de septembre, par
un obus qui blessa en même temps son père (car le
père avait demandé à servir dans l'active, et
était dans ma Cie avec son fils).
Barthélemy commanda dans la suite, en qualité de
caporal, une équipe de canon de 37.
Que sont devenus par la suite ces trois braves ? Je souhaite qu'ils
soient toujours de ce monde et fassent souche de braves
gens.
|
 a
cote 196 a
cote 196
|
La cote 196 ressemble de loin à un
paysage lunaire. Elle est parfaitement dénudée, et
d'une blancheur de neige éclatante. Elle possède aussi
ses volcans.
La pente nord de cette colline appartient aux boches. La pente sud
nous appartient. Les tranchées françaises sont
sensiblement sur la crête, les tranchées boches sont
installées à quelques mètres des
nôtres.
Ma Cie va occuper ce secteur et relever une Cie du 15e. Le brave
lieutenant que je vais remplacer me fait visiter son secteur et me
fait les honneurs de sa "tagna." (Il prononçait t pour c). Il
me montre l'emplacement des péristopes (périscopes) et
m'annonce qu'il est juriste-linduiste (linguiste) de profession. Tout
en déambulant dans les tranchées, il tient, en
soulevant sa vareuse fendue en arrière, à me montrer -
je suis placé derrière lui - qu'il a un torset
(corset). Un corset dans une tranchée !
Le secteur n'est pas agréable. Un boyau qui y accède
s'appelle le boyau de la mort. Il est pris d'enfilade par les boches,
et il ne faut pas s'y aventurer en plein jour car il est
balayé par une mitrailleuse.
A chaque pas, on voit des morts plus ou moins enterrés, des
morts dans les différentes phases de la décomposition :
celui-ci montrait une tête absolument décharnée ;
un autre, au contraire, étalé sur le parapet,
était en pleine décomposition ; cet autre,
enterré sous une mince couche de terre, en était
à la période des mouches : la terre se fendait, et on
entendait un bourdonnement souterrain, puis les mouches sortaient une
à une, lourdement, et elles allaient s'installer quelque part
pour digérer, au soleil ; et celui-là était
couvert de larves desséchées : les mouches
étaient parties. Et il fallait vivre dans cette horreur, dans
une atmosphère épouvantable.
Les brancardiers venaient chaque nuit pour désinfecter les
corps, mais la besogne, en raison du nombre considérable de
cadavres et la difficulté du travail, compliquée par la
proximité des boches qui au moindre bruit lançaient des
fusées éclairantes, des bombes, des grenades,
déclenchaient un tir de mitrailleuses ou d'artillerie, la
besogne dis-je, n'avançait guère.
La cote 196 est toute bouleversée par les entonnoirs - et j'ai
des petits postes installés sur les lèvres d'entonnoirs
- car le secteur de Perthes-les-Hurlus, les Hurlus et Mesnil les
Hurlus est un secteur où la guerre de mines vient s'ajouter
à toutes les autres horreurs de la guerre.
|
les mouches  leues leues
|
Les grosses mouches bleues s'échappent
des centaines de cadavres qui gisent sur le terrain, de ces pauvres
dépouilles qui n'ont plus rien d'humain. Elles volent
lourdement. Elles vont où leurs ailes les portent, mais, je ne
m'explique pas le fait, je l'ai constaté, elles sont toutes
réunies dans un boyau, un peu en arrière des lignes.
C'est un boyau peu fréquenté. Et comme le Ct de Cie
doit visiter le secteur en entier, je me trouve engagé dans ce
boyau, sans me douter de son contenu, et me voilà au milieu de
centaines de millions de mouches. Le boyau en est entièrement
couvert.
Quelle chose atroce ! Se trouver dans un brouillard de mouches
provenant de cadavres humains ! Il faut cependant que je sorte de ce
boyau. Je prends une toile abandonnée, et je remue cette toile
devant mon visage pour en chasser les mouches ! Quel affreux contact
! Quel essaim épouvantable ! Et voilà ce que deviennent
les créatures aimantes, pensantes ! Voilà ce que
devient notre jeunesse : un paquet d'ossements broyés, un
grouillement de larves, des tourbillons de mouches ! Quelle horreur !
Je cours de toutes mes forces en secouant avec frénésie
ma toile de tente, et je sors enfin de l'enfer avec une forte envie
de vomir.
|
un  amp
de repos amp
de repos
|
Après six jours d'enfer nous avons droit
à trois jours de repos, y compris le temps passé pour
le trajet aller et retour. La Cie qui nous relève arrive
à la nuit. Les consignes sont passées, et nous partons,
les sections les unes derrière les autres, les hommes un par
un dans l'étroit boyau où le sac a parfois de la peine
à passer. On n'y voit goutte, et ce sont à chaque
instant des heurts, le nez dans le sac de l'homme qui marche devant ;
des pieds qui s'enfoncent dans les flaques d'eau ; des puanteurs de
cadavres ; des piétinements sur place suivis de marches
rapides car, si on ne veut pas se perdre dans le lacis des boyaux, il
faut suivre l'homme qu'on a devant soi ; des montagnes russes qu'il
faut escalader pour redescendre ensuite ; des glissades dans la boue
gluante ; des rencontres de corvées qui, venant en sens
inverse, retardent considérablement la marche. Mais que sont
ces misères à côté de celles
endurées pendant les six jours écoulés ? On
trouve que le boyau est un bon petit chemin agréable, car au
bout de ce boyau, c'est le terrain où l'on marche à
découvert, où l'on respire à pleins poumons et,
à une certaine distance, c'est le camp - camp Guérin ou
camp Bonnefoy - où l'on ira se reposer trois longues
journées, une éternité !
Nous passons au Mesnil. J'aperçois, à la lueur d'une
fusée, un enchevêtrement de croix, à perte de
vue. C'est le cimetière où dorment nos camarades, et
ils sont nombreux, hélas ! On dirait, par son
immensité, la nécropole d'une petite ville... Les
idées noires reviennent, car on pense aux braves que l'on a
connus et qui dorment là leur dernier sommeil.
Une balle siffle au passage du Mesnil. Un blessé. Ce sera le
seul incident grave de la route.
Les compagnies se rassemblent à un point fixé par le
chef de bataillon, car tout le bataillon va au repos.
Et ces méridionaux qui, pendant six jours, ont eu un
bâillon sur la bouche - car les conversations sont
forcément restreintes, aux premières lignes, et ne
peuvent avoir lieu qu'à voix basse - s'en donnent à
cœur joie. Les "macarel !" retentissent.
Mais le commandant vocifère : "Défense de parler ! Les
commandants de Cie seront responsables de l'exécution de cet
ordre !" Peine perdue. On empêcherait plutôt un fleuve de
couler qu'un Carcassonnais de manifester sa joie ! D'ailleurs, les
boches sont loin !
La marche est reprise dans l'ombre la plus épaisse. Parfois la
lueur lointaine et rapide d'une fusée éclairante
illumine subitement le paysage, puis l'ombre redevient plus noire
après cet éblouissement passager.
Enfin, on arrive au camp. De simples trous un peu plus larges que des
tranchées. Pas de paille. Rien n'est prévu pour les
troupes aux repos. Les hommes maugréent. La joie du
départ est atténuée : "Quoi ! C'est ça le
repos !"
Les cuisiniers, partis et arrivés avant la troupe, distribuent
le café et la "gnolle". Cela ramène la gaieté.
Puis les hommes s'installent dans leurs fosses aux débris plus
ou moins suspects ; ils s'enveloppent dans leurs couvertures.
Quelques-uns, plus raffinés, installent au-dessus de leur
tête, leurs toiles de tente, en forme de toit, et chacun
s'endort en pensant sans doute à la famille, à la
maison paternelle, là-bas... dans un lointain
ténébreux... au foyer où l'on est si bien...
pendant que l'enfant est là, grelottant au fond d'une fosse
malpropre.
Je passe la revue du camp dans la nuit. Et, comme mes braves soldats,
ma pensée va à ma famille, à tous ceux qui me
sont chers, à ma femme que l'on torture, à mon foyer
que l'on n'a pas respecté, et je maudis ceux qui me causent
des souffrances plus atroces que les souffrances de la guerre. Tout
le monde dort. Tout est calme dans le camp. On n'entend que le bruit
des rats qui pullulent et qui font ripaille aux dépens du
contenu des sacs des dormeurs... Le bruit lointain des bombes qui
éclatent, des coups de feu, la clarté d'une
fusée, nous rappellent la réalité du drame dans
lequel nous sommes plongés.
|
 u
repos u
repos
|
Nous sommes arrivés au repos la nuit
dernière. Les hommes ont passé le reste de la nuit
couchés dans des abris sans toiture. Les officiers ont pu
coucher sur de la paille, dans une baraque pourvue de toit. Mais
quelle nuit ! Le gourbi était rempli de rats qui dansaient la
sarabande dans la baraque, qui couraient sur les dormeurs qui se
réveillaient en sursaut. Je passe sous silence les cris et les
vociférations articulés par des gens brisés de
fatigue et qui ne pouvaient dormir.
A l'aube, n'y tenant plus, je sors du gourbi et je vais humer l'air
avec mon bon camarade, le Capitaine de St F..., et boire un quart de
jus à la cuisine, car les cuisiniers étaient
déjà à l'œuvre et je ne saurai jamais assez
les louer pour leur dévouement dont ils ont toujours fait
preuve.
Peu à peu, les camarades sortent tous de la cagna, en
bâillant, en s'étirant, et chacun songea à faire
sa toilette.
Nous étions tous blancs de craie, sales à faire peur,
couverts de vermine. Toute la journée est employée par
les hommes à des travaux de propreté, au nettoyage des
armes et des chaussures. On les conduit à Sommes-Suippe, aux
douches.
Quelques officiers, la toilette terminée, vont excursionner
à cheval, dans la grande steppe blanche ; d'autres font leur
correspondance, mais il faut écrire sur ses genoux, ou se
servir de sa cantine comme pupitre, car il n'y a ni table, ni banc,
ni planches pour en faire.
Mon sergent major, débrouillard, avait pu, en suppliant
beaucoup un sergent du génie qui gardait un dépôt
de matériel à une certaine distance du camp, obtenir
quelques vagues planches pour faire une table, un bureau pour
écrire. Et chacun jette un coup d'œil d'envie sur les
planches du sergent major, et le capitaine Targeon ayant dit d'un ton
de commandement : "Posez ces planches, là", essuya un refus
catégorique de mon sergent major.
Pourquoi nous laisse-t-on sans matériel, sans installation ?
Et voilà le repos qu'on donne aux fantassins ?
Quelques-uns s'étant "débrouillés" - ayant
profité de la nuit pour aller voler des planches je ne sais
où - on lut cette note au rapport :
"Des vols de matériel sont signalés au camp des
baraques. Les soldats sont prévenus que le camp est
gardé par des cavaliers qui ont ordre de tirer sur les
maraudeurs, sans préjudice du Conseil de Guerre pour les
délinquants."
Chacun se le tint pour dit !
L'heure du repas venue, nous mangeons, assis mélancoliquement
par terre, notre cantine servant de table. Tout de même,
ça manque de confortable.
Après dîner, le capitaine de St F..., mon camarade G...,
le sous-lieutenant D... et moi fîmes une longue partie de
bridge... et, pour cela, nous nous installâmes sur une
couverture, dans un boqueteau.
Nous passons ainsi trois monotones journées de repos, et nous
remontons en ligne.
|
 esquineries
et manigances esquineries
et manigances
|
M. le Maire, poussé par sa rageuse et
plus que sexagénaire moitié, fort de mon absence, s'est
employé à faire souffrir ma femme, et fait la guerre
à sa façon.
Les jeunes filles du patronage n'allant plus au cours du jeudi, M. le
Maire dénonce ma femme comme s'employant à
détourner les jeunes filles du patronage.
Ma femme, à mon départ à Sens, m'ayant
accompagné - entre deux trains - jusqu'à Chalon, M. le
Maire l'a encore dénoncée sous prétexte
qu'à son départ elle n'avait pas remis la clef
d'entrée des écoles au garde-champêtre. Or la
porte est commune pour le logement et pour l'école, et il n'y
a pas qu'une clef. De plus, le garde demeure à un quart
d'heure de l'école.
M. le Maire a encore dénoncé ma femme sous
prétexte que le mélange des filles et des
garçons n'est pas moral, et que l'école manque de
surveillance. Et à l'appui de sa thèse il
possède une lettre apocryphe écrite par un
garçon de l'école à une fillette. Il conserve
précieusement cette lettre...
En plein conseil municipal, il insinue aux conseillers d'avoir
à recueillir les plaintes des parents, au besoin de susciter
ces plaintes, et que lui se fait fort d'obtenir le déplacement
de l'institutrice, ajoutant : "A la Préfecture, j'obtiens tout
ce que je veux !" Cela est fort possible.
M. le Maire, suivi du garde-champêtre, a
pénétré dans le jardin de l'école que
j'avais créé, et il a fait placer une barricade le
séparant en deux parties, et il annonce à ma femme
qu'il lui enlève le 1/3 du jardin, la partie la meilleure. Et
cependant, l'adjointe, à qui il donne cette portion de jardin,
avait refusé nos offres de terrain et ne veut pas - ou feint
de n'en pas vouloir - du tout du jardin qui restera sans culture
pendant une année. Cela, c'est le bon plaisir du maire.
Le maire, dans sa folie de dénonciations, écrit au
Ministre de l'instruction publique, faisant savoir que je suis un
mauvais éducateur ; que le curé publie mes louanges
(alors qu'il avait publié sur le bulletin paroissial une
citation dont j'avais été l'objet, citation qu'il avait
recueillie sur les journaux locaux).
L'Inspecteur primaire, l'Inspecteur d'Académie,
essayèrent bien de nous soutenir. Tous deux
m'écrivirent des lettres réconfortantes ; mais cela ne
donnait pas la tranquillité à ma femme, obligée
d'écrire rapports sur rapports pour se disculper ; faisant
l'objet d'enquêtes bienveillantes, peut-être, mais qui
finissaient par tuer lentement celle que le mari ne pouvait
défendre puisqu'il était là-bas, bien loin, dans
la tranchée, sous une pluie de feu, dans la boue, dans la
puanteur des cadavres.
"Mauvais éducateur !" disait le maire, pendant que je
combattais, comme volontaire, pour la Patrie. Mes
élèves tués à l'ennemi se lèvent
de leur tombe pour lui crier : "Menteur et lâche !"
J'ai appris par la suite que Mme la Luxembourgeoise (née de
quelle origine ?) avait essayé de mettre en
sûreté le mobilier de la Koetsemberg, sa chère
amie. Elle avait envoyé sa femme de chambre - n'osant
apparaître en personne - au domicile de la boche. Mais
là, on lui apprit que le nécessaire avait
déjà été fait, ce qui satisfit grandement
Mme la mairesse.
Plus tard, ce mobilier fut retrouvé et placé sous
séquestre.
C'est bien cela : pourchasser une institutrice française dont
le mari est au feu, et placer sous son égide "une pauvre
institutrice allemande qui aimait tant la France", disait la Kelsen -
une ennemie de notre pays, espionne par-dessus la
marché.
|
 otre
colonel otre
colonel
|
[Le colonel Henry a été
tué par un obus en septembre
1918, au cours d'un combat
d'arrière-garde allemand.]
Le lieutenant-colonel Henry commande le régiment. C'est un
excellent chef, adoré de tous, officiers et soldats.
C'est un homme assez grand, mince, brun, la physionomie intelligente
et fine, respirant la bonté. Il grisonne à peine.
Dès qu'on le voit, qu'on l'entend parler, on l'aime.
Il est toujours souriant, plein de bienveillance pour tout le monde.
Jamais je ne lui ai entendu dire un mot plus haut que l'autre. S'il
fait une remontrance, il la fait avec tant de tact et de douceur
qu'on ne peut en être froissé. C'est un père qui
parle et on lui obéit comme à un père. C'est le
chef épris de justice, possédant un jugement sûr,
sachant apprécier les mérites de chacun, et voyant tout
par lui-même.
Cher et brave Colonel Henry ! Dès qu'il y avait une attaque,
une explosion d'entonnoir, un point menacé, on pouvait
être sûr de le voir arriver au danger.
Je me souviens de l'avoir accompagné du Bois Jaune où
était son P.C. à la cote 196 que nous devions
reconnaître.
Nous suivions le boyau Souligne lorsqu'une bombe boche arriva
à sa hauteur. Il eut à peine le temps de se coucher et
l'explosion se produisit un peu au-dessus de lui, contre la paroi du
boyau, sans qu'il soit atteint. Il ne marqua aucune émotion et
continua tranquillement sa route. Et cependant les oreilles me
sifflaient.
Pour les attaques de Champagne, il paya largement de sa personne ; le
6 octobre 1915, il était dans la tranchée de
départ. A la reprise de Tahure, le 31 octobre, je le vis sur
la route de Tahure à Somme-Suippe, observant la bataille,
donnant des ordres. Et cependant, cette route était
labourée par les obus...
Avec un chef pareil, chacun s'efforce d'accomplir consciencieusement
sa tâche.
Il nous aimait tous, officiers et soldats, paternellement, et je l'ai
vu pleurer, après Verdun, lorsque le régiment,
cruellement éprouvé, descendit des lignes pour se
reformer. Plein de bravoure et de mépris du danger, le Colonel
Henry était admiré de tout le régiment.
Le Colonel Henry fut tué - j'avais quitté le
régiment - en septembre
1918, lors des attaques de Coucy le
Château. Comme d'habitude, il allait aux premières
lignes lorsqu'il fut atteint par un obus.
L'aumônier de la 32e D.I. qui m'annonça sa mort me dit
qu'il fut regretté de tous et pleuré comme un
père.
Cher et brave Colonel Henry, je ne vous oublierai pas. Jamais votre
bonne et souriante physionomie ne s'effacera de ma mémoire.
Vos traits demeureront gravés en moi. J'apprendrai à
mes enfants, à mes élèves, vos nobles
qualités. Car c'est avec des chefs comme vous que nous avons
pu gagner la Victoire.
|
Eugène
écrit, parlant du Lieutenant-Colonel Henry qui
commande le 143e régiment d'infanterie : " C'est un
excellent chef, adoré de tous, officiers et soldats.
C'est un homme assez grand, mince, brun, la physionomie
intelligente et fine, respirant la bonté. Il grisonne
à peine. Dès qu'on le voit, qu'on l'entend
parler, on l'aime (...) Le Colonel Henry fut tué -
j'avais quitté le régiment - en septembre
1918, lors des attaques de Coucy le Château. Comme
d'habitude, il allait aux premières lignes lorsqu'il
fut atteint par un obus. L'aumônier de la 32e D.I. qui
m'annonça sa mort me dit qu'il fut regretté de
tous et pleuré comme un père."
Grâce à
l'historique du 143e Régiment d'Infanterie, nous en
savons les circonstances :
"Le 2 septembre
(1918), à midi, la situation (du 143e RI) est la
suivante :
De la gauche à la droite, et le long du canal
(1), la 7e Compagnie, la 5e Compagnie , une section
de la 3e Compagnie, un peloton de la 9e Compagnie (...)
A 14 heures, la 7e Compagnie réussit à
franchir le canal par la passerelle de l'Ecluse, la 5e
Compagnie par la passerelle III, toutes deux se portent dans
le bois de Monthizel, corne sud-ouest.
Le 3 septembre,
le 3e bataillon s'infiltre dans le Bois de Monthizel,
l'occupe, atteint la lisière nord et pousse des
patrouilles vers la voie ferrée ; l'activité
de l'artillerie ennemie se maintient très vive ainsi
que son aviation.
Le 5 septembre,
à 13h15, le Colonel reçoit l'ordre
d'opérations prescrivant de reprendre l'offensive.
Deux bataillons sont en première ligne : le 3e
Bataillon à droite, le 2e Bataillon à
gauche.
A 18 heures, la 10e Compagnie (...) a atteint la
tranchée Courval (...) La tranchée de la
Bataille paraît fortement tenue ; des mitrailleuses
s'y révèlent ; leur tir et celui de
l'artillerie ennemie nous causent quelques
pertes.
Le 6 septembre
1918, grâce à l'allant de nos patrouilles
et au judicieux emploi des obus VB, l'ennemi se voit
contraint au petit jour, d'abandonner la tranchée de
la Bataille ; nous l'occupons aussitôt.
Le 6 au soir, le 3e Bataillon du 15e, mis ce jour-là
à la disposition du Colonel commandant le 143e RI,
s'empare des villages d'Aulers et de Bazoles
(2).
Le 7 septembre,
le front du Régiment, pour quelque temps, se
stabilise. L'artillerie ennemie bombarde fréquemment
et avec violence les pistes et les boyaux.
Le Colonel HENRY, commandant le Régiment, est
tué. Il tombe un jour de victoire, en plein
succès, emportant avec lui l'affection de tous ses
soldats."
(1) Canal de
l'Ailette
(2) Aujourd'hui Bassoles-Aulers, dans l'Aisne
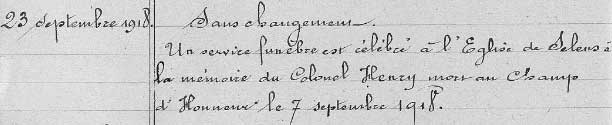
extrait du JMO du
143e RI (26 N 694/6)
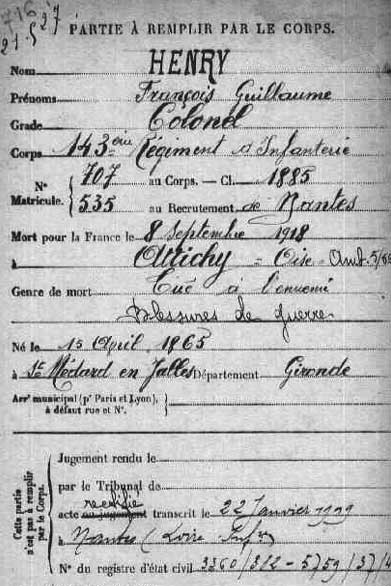
Attichy est un village
de l'Oise, sur la rivière de l'Aisne, à l'est
de Compiègne, à quelques kilomètres de
la Clairière de l'Armistice de Rethondes (et de St
Léger aux Bois).

François
Guillaume Henry, Mort pour la France à
cinquante-trois ans, repose dans la nécropole
nationale de Vic sur Aisne (carré B1).
|
|
l' djudant
Morin djudant
Morin
|
Morin est arrivé à la Cie comme
sergent, en même temps que moi. C'est un excellent gradé
que j'ai remarqué immédiatement pour son sang froid,
son grand courage et pour la somme de travail vraiment prodigieuse
qu'il fournit. Il a un grand ascendant sur les hommes qui savent vite
juger et apprécier un chef.
Quand j'ai fixé la tâche à accomplir, je peux
être certain qu'elle sera faite. Le mot impossible n'existe pas
pour lui. Comme organisateur de secteur, il n'y a pas son pareil. Il
veut que les sentinelles soient protégées dans la
limite du possible, et sa grande préoccupation est de faire
construire de petits blockhaus à chaque sentinelle, des niches
où l'on est préservé des tirs d'enfilade,
où l'on est à l'abri de l'éclatement d'une
bombe, à l'aide d'un toit assez résistant et d'une
entrée en chicane formée de sacs à terre.
Où Morin est le plus précieux, c'est pour
écouter le travail de mines des boches. Il avait l'ouïe
très fine. Pendant la nuit, à certaines heures
déterminées, les hommes reçoivent l'ordre de ne
faire aucun bruit, et Morin écoute, tout le long du secteur,
le travail souterrain. Il place l'oreille contre terre et se rend
compte du degré d'avancement des travaux de mines de l'ennemi.
Ici, l'ennemi creuse une galerie : Morin entend, chaque nuit, le
bruit des pelles, des wagonnets qui roulent sur les rails. Puis, tout
à coup, ce bruit cesse. C'est le bourrage de la mine. C'est
à présent qu'il faut être sur ses gardes.
Je suis heureux d'avoir cet homme précieux, car lorsqu'on est
sur un volcan, il fait bon connaître le moment de
l'éruption.
Les soldats du génie nous préviennent bien aussi du
travail des boches, mais Morin n'a confiance qu'en son ouïe
sûre, et j'ai également confiance en lui. Souvent, je
l'ai constaté, les explosions se produisent à
l'opposé des points signalés par le génie, et se
produisent exactement au point repéré par Morin. Aussi
je n'ai jamais eu de pertes très sérieuses du fait de
l'explosion d'une mine.
Morin est nommé adjudant, en récompense de ses bons
services. Plus tard, il obtient le grade d'adjudant-chef. Il
méritait mieux que cela.
Il est bientôt pour moi plus qu'un auxiliaire précieux
et dévoué, la cheville ouvrière de la compagnie,
mais un ami sincère et véritable.
"Morin, grâce à toi, à ton rude labeur, beaucoup
d'hommes te doivent la vie. Ton rude tempérament de paysan
français résista tant qu'il put au terrible surmenage
que tu t'étais imposé, jusqu'au jour où,
à bout de forces, tu fus évacué pour tuberculose
contractée dans tes veilles prolongées pour sauver tes
frères.
Ceux qui te rencontrent, vieilli, la figure ravagée par le
mal, mais la poitrine ornée de la croix de guerre, peuvent te
regarder d'un œil différent. Moi, ton vieux capitaine, je
m'incline bien bas devant tes hauts faits, devant ton
héroïsme, devant tes souffrances actuelles. Morin, mon
vieux compagnon de combat, mon vieil ami, je te salue."
|
 eux
adjudants eux
adjudants
|
J'ai deux adjudants dans ma compagnie qui
viennent d'être nommés sous-lieutenants : Depaule et
Coulon. Depaule est de Carcassonne. Coulon est de la région de
l'Est. Je suis satisfait de leurs services. Et je puis certifier
qu'on ne s'ennuie pas à la popote des officiers de la 2e
Cie.
Coulon reçoit un colis de friandises, fruits confits, et
bonbons variés. Immédiatement, Depaule annonce
"qué la plupart des fruits confits viennent de
Carcassonné ! qu'à Carcassonné il y a au moinsse
trois mille confiseurs !", ce qui en bouche un coin à Coulon
qui ne se doutait pas qu'il y avait tant de confiseurs à
Carcassonne.
Un jour, on mange du poisson - poisson frais, poisson salé, je
ne sais plus. Depaule hasarde "qu'à Carcassonné c'est
plein de poissons, plein, plein... mais qué ceux qui vont les
pêcher ne les mangent pas ; ils les donnent à leurs
voisins !" Coulon, qui trouve cette histoire bizarre et qui ne
gêne pas pour le dire, reçoit cette explication
inattendue de Depaule : "Oui, on donné ses poissons aux
voisins parcé qu'à Carcassonné on est socialiste
! macarel !"
Parle-t-on du métier militaire d'avant la guerre, Depaule,
ancien caporal rengagé, dit "qué les régiments
du midi valent mieux qué ceux dé l'Est. Dans lé
midi, quand on partait à l'exercicé on emportait
toujours un pli secret qui contenait le thèmé de la
manœuvré. Et cela habituait chacun à avoir
dé la décision... de mêmé on faisait des
marches de 70 km, sac au dos ! Citez-moi un régiment de l'Est
qui en faisait autant !"
Coulon hausse les épaules et ne répond pas à
pareilles fadaises. S'agissait-il de vin, de vignobles, de raisins,
oh ! alors Depaule ne tarissait plus : "chaque pied de vigne
rapporté 30 l. de vin." Et comme Coulon trouvait qu'en
comptant 6000 à 8000 pieds par hectare cela fait 1800 à
2400 hl, Depaule disait : "Otez-en un peu, si vous voulez, mais n'en
ôtez pas trop. On en récolte "presque" autant que
ça !"
Mais un jour, le froid Coulon eut sa revanche. On mangeait des
asperges et Coulon prétendit qu'à Belfort "il y a des
asperges - montrant un litre - grosses comme ce litre !" et Depaule,
modeste : "A Carcassonne, elles sont un peu moins grosses, mais
toujours de la grosseur - montrant un verre à boire -
dé cé verré. - Alors, ajouta Coulon, je me
demande quelle gueule vous devez avoir pour manger ça !"
Ce brave Depaule exaltait son pays avec son exagération
méridionale, mais tout cela était de bon aloi,
engendrait de la bonne humeur, ce qui n'était pas sans
besoin.
Depaule, en brave soldat, devait tomber plus tard à
Vaux-Chapitre. Quant à Coulon, il fut blessé aux
attaques de Champagne, et après sa guérison il fut
affecté à un autre régiment.
|
 xplosion
d'une mine xplosion
d'une mine
|
Morin, une nuit, vient me dire que les boches
sont en train de "bourrer la mine". Il n'entend plus aucun charroi
souterrain. Parfois, il perçoit un bruit de pelle ou de pioche
: mais ce bruit est un piège grossier. Les boches voudraient
nous donner le change, mais on ne trompe pas Morin.
Toutes les précautions sont prises. La tranchée est
évacuée sur une certaine longueur. Une sentinelle,
seule, est laissée pour prévenir en cas d'attaque. Les
hommes sont placés à une certaine distance du point
menacé. Des outils, pelles et pioches, sont à
portée de la main. Des sacs à terre, des chevalets sont
réunis à un point déterminé. Chaque homme
connaît sa besogne : dès que l'explosion se produira,
indépendamment du fusil, les hommes doivent prendre l'un une
pelle, l'autre une pioche, un 3e des sacs à terre, un 4e un
chevalet, etc. Puis, lorsque le capitaine en donnera l'ordre -
j'avais été nommé capitaine - on
s'élancera sur l'entonnoir, les uns à l'est, les autres
à l'ouest, et tel groupe au sud.
L'explosion se produit. Le secteur est secoué comme par un
tremblement de terre, les tranchées s'écroulent, une
épaisse colonne de terre, de flamme, de fumée
s'élève dans les airs à une grande hauteur. La
terre, projetée par les gaz, retombe et forme ce qu'on appelle
les lèvres de l'entonnoir.
Comme il faut se défier d'une seconde explosion (les boches
font quelquefois sauter deux mines contiguës, l'une après
l'autre : toujours de la trahison !), nous attendons un instant. Puis
je donne l'ordre de l'attaque de l'entonnoir, et malgré la
pluie de bombes et de grenades boches, à laquelle riposte
Delcellier qui s'est rapidement installé à
proximité, l'entonnoir est occupé et est
entièrement en notre possession.
A cette occasion, le sergent Tuffin fut cité pour avoir, le
premier, pénétré dans l'entonnoir et
placé un créneau sur la lèvre nord
(créneau inoccupé, mais qui a rendu circonspects les
boches).
J'eus deux autres tués : l'un fut enterré par
l'explosion, l'autre reçut une balle en plein front. Encore
deux braves garçons qui reposent au cimetière de Mesnil
les Hurlus !
|
l' nstallation
de l'entonnoir nstallation
de l'entonnoir
|
L'entonnoir est pris. Il est occupé par
nous. Il y a trois postes de guetteurs : l'un à droite (est),
l'autre à gauche (ouest), l'autre au sud, et un créneau
inoccupé au nord (il sera occupé plus tard).
Il s'agit à présent de creuser des sapes pour aller de
la tranchée de 1re ligne dans l'entonnoir.
L'épaisseur de la terre des lèvres de l'entonnoir est
considérable. Mais, malgré la lutte de bombes, le
travail, avec de la ténacité, avance peu à peu,
et nous arrivons à nos fins.
Un soir, une sape est terminée, celle de la partie sud, la
moins longue à faire. Les hommes profitent de la nuit pour
pénétrer dans le cratère et installer sur la
lèvre nord un blockhaus construit en sacs à terre
recouvert d'épais madriers revêtus de sacs à
terre. On construit ensuite des postes à l'est et à
l'ouest de l'entonnoir, pour avoir des vues sur l'adversaire.
Il est nuit noire : je suis à l'entrée de l'entonnoir,
surveillant le va-et-vient des hommes qui transportent des sacs, des
chevalets, prêt à parer à une attaque
boche...
Je suis accoudé à une grosse racine. Elle n'est pas
phosphorescente, contrairement à ce que j'ai remarqué :
car les racines décomposées dans ce terrain
dévasté dégagent, en effet, des lueurs
phosphorescentes.
Je touche cette racine, elle est assez molle, et a la consistance du
caoutchouc. Je me dis : "C'est bizarre ! quel drôle de bois
!"
Dans la nuit, je rentre dans ma cagna, et là, un sergent me
dit : "Avez-vous vu, à l'entrée de la sape, un mort qui
avance la jambe. Tout le fémur est sorti de terre."
C'est cette jambe que j'ai prise pour une racine.
Le lendemain, je fis extraire le cadavre. C'était un soldat
français que l'explosion avait fait sortir de sa tombe. Ses
chairs n'étaient pas consumées mais s'étaient
desséchées. Il était comme momifié.
Je le fis enterrer dans le fond du cratère, où il
repose sans doute toujours, car ce cratère fut comblé
peu à peu par les terres extraites d'une galerie voisine.
Je ne pus l'identifier, et je suppose qu'il fait partie de
l'armée innombrable des disparus.
Pour éviter que les hommes soient atteints par les bombes que
les boches lançaient continuellement dans l'entonnoir, je fis
construire à l'intérieur du cratère, et tout
autour des lèvres, un boyau protégé, du
côté du centre de l'entonnoir, par une bordure de
gabions.
De cette façon, l'occupation ne nous coûta aucune perte,
et le Colonel me dit un jour, avec son bon rire paternel : "Vous
êtes installés, là-dedans, comme dans un
fauteuil."
|
le cuisinier des  fficiers fficiers
|
Notre cuisinier s'appelle Cantaloup, un
Carcassonnais pur sang. Cantaloup est un "pauvre type",
chétif, blême - n'ayant pas deux sous de santé.
On se demande pourquoi ce garçon-là n'est pas dans
l'auxiliaire où l'on voit souvent des gens à mine
fleurie, frais et portant beau. C'est parce que Cantaloup est un
malingre que je l'ai choisi comme cuisinier.
Il s'acquitte plus ou moins bien de sa besogne. Mais quand on vit
dans la crasse, qu'on est couvert de poux, qu'on couche par terre,
qu'on n'a pas les commodités de déguster un bon repas,
Cantaloup suffit comme cuisinier.
Je crois que les soins de propreté lui sont à peu
près inconnus. Mais j'ai soin d'ajouter que l'eau est rare
dans le coin de Champagne où nous sommes. On l'amène
dans des tonneaux aux cuisines et on la distribue
parcimonieusement.
Employer de l'eau pour se laver, alors qu'on n'en a pas assez pour
les cuisines, paraîtrait un gaspillage éhonté.
Aussi Cantaloup fait comme ses officiers, comme tout le monde, il a
supprimé le débarbouillage.
Les plats et ustensiles dont il se sert ont une origine suspecte.
Aussi, un jour, Gossart et moi, pris d'hilarité devant un
récipient rempli d'un liquide noirâtre - de la verveine,
disait Cantaloup - lui avons-nous dédié - au
récipient ou à Cantaloup, au choix - les vers suivants
:
|
Le vase
trouvé
Le vase où bout cette
verveine
Par Cantaloup fut ramassé...
Mais où ? N'en soyez pas en peine :
Sur un mort et dans un fossé...
Il reluit comme un pot de
chambre
Maintenant qu'il est tout astiqué !
Son parfum est celui de l'ambre
Joint à celui du vin
piqué.
Autrefois ce vase qui
brille
Exhalait d'atroces senteurs...
Maintenant l'âne qu'on étrille
N'a pas de plus douces odeurs.
Par qui ce miracle
sublime
A-t-il pu se réaliser ?
Par Cantaloup avec sa lime,
Un chiffon noir et un baiser.
Ce n'est pas un baiser de
muse
Ni le doux baiser d'un amant !
Non ! C'est Cantaloup qui s'amuse
A frotter son vase en crachant.
|
|
|
Visite du  énéral
Grossetti énéral
Grossetti
|
Le général Grossetti vient
visiter le secteur. Chacun est prévenu. Ma compagnie occupe un
secteur de 1re ligne, à l'ouest du boyau Lorrain, qui part de
Mesnil les Hurlus.
On l'attend vainement toute la matinée. Le Commandant qui
était en ligne, en un point où le général
pouvait déboucher, reçoit un message
téléphonique : le général est à
son P.C. où il va déjeuner. Vite, le Commandant regagne
son poste de commandement.
Dans l'après-midi, vers 2 h, le général arrive,
suivi de notre Colonel Henry, suivi à son tour du Chef de
Bataillon derrière lequel je me place. Et nous voilà
tous quatre, hiérarchiquement placés, suivant la
tranchée de la 1re ligne.
Le Général Grossetti est tout grisonnant. Il est
énorme et circule difficilement dans les boyaux et les
tranchées. Il adresse la parole à toutes les
sentinelles, leur demandant des renseignements sur leur pays, leur
famille.
Le Général est très populaire. On sait qu'il a
du cran, et cette visite aux premières lignes, dans un mauvais
secteur, produit bonne impression.
Arrivé en un point où la tranchée était
couverte, le général se tourne vers moi et me dit : "
Pour passer là-dessous, je suis obligé de me
contorsionner !" Et, en effet, le Général est
obligé de se baisser pour passer sous le pont...
Un peu plus loin, nouveau pont, nouvelle exclamation du
général : "Je suis encore obligé de me
contorsionner !"
Notre bon Colonel explique que ces "ponts" ont leur utilité.
Ils sont placés au-dessus d'un puits où commence une
galerie. Si une bombe arrive, le travailleur est à l'abri,
protégé par le pont... N'importe... le
Général veut avoir raison : si on ne peut enlever le
pont, on creusera le sol pour pouvoir circuler facilement ou on fera
un boyau contournant le pont.
Puis une autre discussion surgit : "Pourquoi garnissez-vous les
tranchées de sacs à terre ? Il vaudrait mieux faire des
abris avec les sacs." Et notre Colonel explique que les terres, par
suite des secousses fréquentes causées par les
explosions, sont excessivement friables ; il faut donc les retenir
avec des murs de sacs à terre.
Pendant toute la durée de l'inspection, le secteur fut d'un
calme surprenant. Mais le soir, à la nuit, les boches
attaquèrent le secteur à l'est du boyau Lorrain
occupé par le 142e régiment d'infanterie et
s'emparèrent de quelques éléments de
tranchées (au trapèze).
Notre Cie, alertée, passa la nuit, l'arme au pied, et surtout
la grenade à la main. Mais nous ne fûmes pas
attaqués.
Le lendemain du jour de l'inspection, on creusa le sol de la
tranchée, à proximité de la galerie. Mais, la
pluie survenant, l'eau s'accumula sous le pont et envahit la galerie.
Il fallut remettre les choses en l'état. Pour obéir
à l'idée du général, on fit un boyau pour
contourner le pont.
|
 e
village de Somme-Suippe e
village de Somme-Suippe
|
Le bataillon va au repos à Somme-Suippe.
Voilà la nouvelle qu'on nous apprend. C'est une bonne affaire.
La relève a lieu comme d'habitude. Cheminement dans les
boyaux. Arrivée aux Hurlus.
Là, il n'y avait qu'à suivre le chemin à un
trait qui va des Hurlus à Somme-Suippe, en passant par la
côte 189, et au bout de 3h de marche nous aurions
été arrivés.
Mais le commandant veut suivre un autre itinéraire. Il nous
fait passer par Laval, St Jean, Somme-Bourbe, ce qui double le
trajet, et nous arrivons fourbus à Somme-Suippe, en pleine
nuit.
Toute la Cie est logée dans le même local. C'est une
lamentable masure en planches dont beaucoup sont à
moitié rongées ou absentes. Le sol est tapissé
de paille qui ressemble plutôt à du fumier.
Les cuisiniers ont fait le café. Il fait bon prendre quelque
chose de chaud quand on arrive au cantonnement après une
longue marche. Les hommes savourent leur moka et ils vont s'allonger
les uns à côté des autres dans leur pauvre
gîte. Les pauvres gens ne se plaignent guère, car ils
sont tellement habitués à souffrir !
Le lendemain, réveil assez tard. Douches, nettoyage des
vêtements, des armes. Revue dans la soirée.
Une corvée est commandée pour enlever le fumier contenu
dans la grange où logent les hommes. Le sol est formé
d'une épaisse couche de fumier qui n'a jamais
été enlevée depuis la guerre. Et ce sera
l'occupation de cette corvée (renouvelée chaque jour)
d'enlever, pendant les trois journées passées au repos,
le fumier qui s'est accumulé là pendant des mois. Que
font donc ces nuées de brancardiers et d'infirmiers ? Sans
doute des bagues, ou bien ils rédigent des revues. Quelle
misère !
A Somme-Suippe, on peut se laver. Il y a une belle eau courante dans
le village, non loin de l'église. Aussi les poilus "s'en
payent !"
Le 2e jour, il y a distribution de linge et d'habits.
Les hommes rendent leurs vieux linges et effets : jamais je n'ai vu
un pareil grouillement de poux étalé sur leurs
défroques entassées.
Je suis logé avec Gossart dans une pièce vide de son
contenu. Nous faisons installer de la paille dans un coin. Il n'en
faut pas plus pour faire deux bons lits et pour se croire
heureux.
Nous avons une vraie table, quelques chaises boiteuses. Bref, nous
sommes en pays civilisé. Mais le bois manque. Comment faire
bouillir la soupe ?
Les cuisiniers connaissent le système D : ils
dégarnissent de quelques planches la triste masure où
logent les hommes. Et le cuisinier du Capitaine ? Eh bien ! dans un
local se trouve une commode. Cette commode a des tiroirs, n'est-ce
pas ? Elle a un fond. Tout cela est enlevé, subtilisé
par nos peu scrupuleux cuisiniers...
Et quand nous retournâmes à la tranchée, la
commode n'existait plus qu'en façade. Tout le reste avait
été brûlé.
Je me demande pourquoi l'on ne nous fournissait pas de bois ;
pourquoi les locaux affectés aux troupes étaient
démunis de paille et de tout ce qui aurait pu procurer un
certain bien-être aux troupes au repos. Toutes les troupes non
combattantes qui restaient à l'arrière, occupaient les
meilleurs locaux, ne manquaient de rien. Pourquoi réservait-on
aux combattants les écuries pleines de fumier ?
Ce n'est que bien plus tard, presque à la fin de la guerre,
qu'on a réagi contre ce système absolument
détestable, pour ne pas dire honteux.
|
la mort de  andine andine
|
Le bataillon est allé relever un
bataillon du 53e dans le secteur de Perthes-les-Hurlus.
Itinéraire : chemin à un trait, cote 192 - maison
forestière. En cet endroit, il y a un immense
cimetière. Nous trouvons des guides à la maison
forestière. Nous nous engageons dans des boyaux. Direction
générale : nord-est. On passe auprès d'un
immense cratère, un peu au nord de Perthes. L'air est
empoisonné par une odeur cadavérique très
prononcée : dans ce cratère sont des quantités
de pauvres victimes ensevelis par une formidable explosion. Je sors
mon flacon d'eau de Cologne de la musette et j'en aspire l'odeur. Je
le passe au brave Gossart qui est derrière moi. Les boyaux
sont pleins d'eau, pleins de boue.
Enfin, on arrive en ligne... Le secteur ne vaut pas celui que nous
quittons. Les tranchées ne sont pas profondes. Tout
s'écroule, car rien n'est entretenu. Est-ce une idée ?
Chaque fois que le 143e a remplacé une autre troupe soit
à la tranchée soit dans le cantonnement, il m'a
semblé qu'il y avait des négligences dans l'entretien
du cantonnement ou de la tranchée. On aime son
régiment, mais je crois qu'au point de vue travail et
installation, le 143e a toujours laissé une succession
propre.
Mon brave Morin me seconde de son mieux. Tout un coin du secteur,
celui qu'il occupe, est dans le désarroi le plus grand.
En quelques jours, tout est remonté. Un blockhaus boche nous
gêne. Morin entreprend de le faire sauter à l'aide de
bombes. Delcellier et ses deux acolytes sont de la fête. C'est
dans cette entreprise que fut tué Dandine, un vieux brave de
la compagnie.
Dandine était sentinelle en face du blockhaus boche. Il
surveillait les points d'arrivée de nos bombes que
lançait Delcellier, et il réglait ainsi le tir de nos
crapouillots. Encouragé par le silence de l'ennemi, Dandine se
hasarda à lever la tête par-dessus le parapet pour mieux
observer. C'est à ce moment qu'il reçut d'un bandit une
balle retournée qui lui enleva la boîte crânienne,
et il tomba (les pieds bien plus hauts que la tête, car il
était perché sur la lèvre d'un entonnoir)
perdant son sang à flots. Bientôt la terre, toute
crayeuse, en fut imprégnée.
Pauvre Dandine, pauvre victime du devoir ! Il était
aimé de ses camarades et de ses chefs et chacun le pleura et
jura de le venger.
J'ai ramassé la calotte demi-sphérique que portait
Dandine (car les hommes n'étaient pas encore munis de casque,
et mettaient une calotte en fer, sans grande efficacité).
L'ouverture faite par la balle au point d'impact, dans cette calotte,
avait 5 cm de diamètre, et à la sortie du projectile la
coiffure métallique avait été
déchirée en trois endroits.
Quelle triste chose que la guerre !
|
le  rapèze rapèze
|
A chaque séjour de tranchées,
ai-je besoin de le dire, nous y laissons des plumes, des tués,
des blessés en nombre élevé. On peut estimer les
pertes moyennes d'un bataillon, pour 6 jours de tranchées,
entre 30 et 40 hommes, surtout le bataillon qui était au
Trapèze, à l'est du boyau Lorrain.
Après avoir été relevés de notre secteur
de Perthes, et avoir fait trois jours de repos à Somme-Suippe,
c'est au Trapèze que nous sommes envoyés.
Le Trapèze, c'est l'enfer. C'est la guerre de mines dans toute
son horreur. C'est la lutte des bombes perpétuelle. Delcellier
est dans son élément : il place des centaines de bombes
chaque jour, et les boches trouvent à qui parler.
Morin aussi a de l'occupation : partout où il tend l'oreille,
il entend le pic du mineur qui creuse une galerie, qui prépare
une mine souterraine. Toutes les tranchées sont minées
et le sol n'est pas sûr.
Les hommes, couchés dans les abris, entendent sous eux le
travail souterrain des boches. Il faut vivre dans cet enfer - mourir
aussi - faire face à toutes les attaques, parer à
toutes les explosions, réparer sans cesse les tranchées
qui s'écroulent sous les détonations des bombes et des
torpilles - on se sert déjà de ces engins -, remonter
le moral des hommes qui n'aiment guère ce genre de sport :
sauter en l'air à cinquante centimètres de hauteur, et
être réduit en bouillie.
A la suite d'un combat de bombes, un de nos petits postes est
détruit, nivelé, et l'homme qui l'occupait, tué,
enseveli (soldat Record). C'est l'époque où l'on ne
doit céder aucune parcelle de terre. Il faut donc
réoccuper le petit poste et le refaire solidement.
C'est le brave Courtejaire qui est chargé de cette besogne.
Avec quelques hommes, il déblaie l'emplacement et, en quelques
nuits, son PP est installé à 2m 50 du PP boche. Les
annales du régiment relatent ce fait. Courtejaire fut
cité pour son action, et s'il porte la croix de guerre, on
peut dire qu'il l'a bien gagnée.
|
 ne
attaque ne
attaque
|
Après un séjour au repos au camp
Bonnefoy (toujours ni tables, ni bancs) au sud de la voie romaine,
dans un petit boqueteau à l'est de la cote 206, nous remontons
au Trapèze, dans l'après-midi.
La Cie que nous allons relever a dû "causer", les boches
doivent savoir qu'il y a relève. Un avion boche passe
au-dessus de nos têtes... Je fais coucher les hommes au fond du
boyau ou placer contre le parapet. L'avion continue sa route.
En arrivant en ligne, le servant du canon Aazen, de la Cie
relevée, lance des bombes. C'est une imprudence. Les boches
nous attaquent : savent-ils qu'il y a relève ? Oui,
certainement. La Cie que nous relevons s'en va et nous laisse nous
débrouiller. En quelques instants, j'ai 18 hommes hors de
combat.
Mais Delcellier est là. Barthélemy s'installe au canon
Aazen. J'envoie une corvée prise dans la section de
réserve chercher des bombes au P.C. du bataillon, et notre
riposte ne se fait pas attendre. Le 75 se met de la partie, et tout
rentre dans le calme après cette violente tempête.
A cette occasion, j'eus plusieurs petits soldats cités ;
entr'autres le soldat Cazel, le soldat Reine, le soldat Grant, etc.
J'en passe, et des meilleurs.
Brave Cazel ! Il eut la jambe droite broyée par une bombe.
Reine enleva sa cravate et, sous une pluie de projectiles, fit une
ligature à son malheureux compagnon qui, se traînant sur
ses mains, quitta la tranchée en rampant et en criant : "Ne
touchez pas ma jambe ! Qu'est-ce qui retient ma jambe !" Pauvre
enfant ! Les brancardiers, malgré mes appels, ne vinrent le
prendre que 45 minutes après qu'il reçut sa blessure.
Je ne devais plus le revoir. Je retrouvai sa tombe au Mesnil,
à côté de celles de tant d'autres
infortunés camarades. Toute notre chère jeunesse
va-t-elle être ainsi fauchée dans sa fleur.
Quant à Reine, un enfant, je me l'attachai comme
caporal-fourrier, en pensant à mon fils qui venait de partir
comme volontaire dans un régiment actif.
Documents trouvés à
l'intérieur de ce 1er carnet
L143e Régiment
d'Infanterie
Ordre du Régiment N°116
(Extrait du Journal Officiel du 16 Juillet
1915)
Par
décret du Président de la
République en date du 15 Juillet 1915, rendu
sur la proposition du Ministre de la Guerre, est
nommé à titre définitif dans
le Cadre des Officiers de l'Infanterie de
l'Armée territoriale :
M. Perrussot (E.H)
Capitaine de Territoriale
A T.T (1) au 143e Régt
d'Infanterie
le
24-7-15
Le Lt Colonel Ct le
143e d'Infanterie, Henry
(1) à titre
temporaire
|
|
Copie d'un rapport du
Colonel
Document original
Notifications
diverses
I - Mal du 3 au 4 : Bourbaki
- Belfort
II - Le 1er Btn sera relevé ce soir par le
3e Btn à partir de 21 heures. Des
ordre
s de détails
seront donnés ultérieurement.
III - Le puits du Génie au Mesnil est pour
le moment tari : le colonel rappelle qu'il est
interdit de faire usage de l'eau des anciens
puits.
IV - Les cartouches ramassées dans le
secteur doivent être réparties en 2
lots : a) celles dont la déformation
empêche toute utilisation ; b) celles qu'un
nettoyage suffit à rendre
immédiatement utilisables. Les
premières doivent être versées
au PC du Colonel ; les autres doivent servir
à constituer l'approvisionnement des
tranchées.
V - Le ministre prescrit d'expédier sur les
établissements de l'intérieur la
totalité des fusils pris à l'ennemi
ainsi que les cartouches provenant de prises. En
conséquence, toutes les armes et munitions
allemandes doivent être versées au P.C
du Colonel.
VI - Prière de faire connaître si les
s-off. Coulon et Malphettes veulent être
proposés au titre de la réserve ou au
titre de l'active.
Col.
Henry
|
|
|
Confidentiel
26 octobre
Impossible de se procurer en
ce moment des renseignements officiels sur
l'origine exacte des parents de Mme Plassard Kehen.
Le Luxembourg, leur pays d'origine, étant
vous le savez très bien occupé par
l'ennemi.
Madame Plassard Kehen s'est toujours
entourée d'allemands. Ses domestiques, avant
la guerre, étaient presque tous allemands et
sa meilleure amie était parfaitement cette
Kutsemberg, sujette allemande et protestante
employée comme institutrice dans une
œuvre catholique dirigée par
l'abbé Violet, rue du Chemin Vert.
La dite Kutsemberg, qui se trouvait soit disant en
Allemagne au moment de la mobilisation, habitait
à Paris, 25 rue Froideveaut, où elle
avait comme voisine un de ses compatriotes artiste
peintre. Elle recevait journellement de nombreuses
visites de dames et 5 à 6 lettres venant
d'Allemagne.
Quelque temps après la mobilisation, Mlle
Kutsemberg a écrit à Madame Plassard
pour la prier de payer son loyer et, lorsque
celle-ci s'est présentée ou
plutôt a envoyé sa femme de chambre
pour payer, il lui a été
répondu que l'œuvre avait fait le
nécessaire et que même le mobilier de
Mlle Kutsemberg, y compris sa bibliothèque,
avaient été portés à
l'œuvre.
Si la bibliothèque de Mlle Kutsemberg
aujourd'hui sous séquestre contenait quoi
que ce soit de suspect au moment de la
mobilisation, il est probable qu'elle aura
été vidée avant le
déménagement par les amies qui ont
été autorisées à
entretenir son appartement et qui l'ont
visité très souvent entre la
déclaration de guerre et l'enlèvement
du mobilier.
N.B. Mme Plassard habitant
depuis la guerre Epernon et M. Plassard
tantôt à Canuz tantôt St
Léger où il est maire, j'ai dû,
étant très malade, faire prendre les
renseignements par un de mes camarades et ils m'ont
coûté 75 f.
espionne
?
|
|
|
143e Régiment
d'Infanterie
Félicitations
Le
Lieutt-Colonel Commandant le 143e a
été heureux de constater la belle
tenue sous le feu de tous les militaires du
régiment pendant les journées parfois
fort dures qu'il vient de passer au Trapèze.
Il félicite en particulier les 2e, 6e et 9e
Compagnies qui ont fait face à plusieurs
attaques et ont consolidé une situation
spécialement visée et
menacée.
Le 24-6-15
Le Lieutenant-Colonel Commandant le 143e
Régiment d'Infanterie, Henry
|
|
Notifications
diverses
MP du 8 au 9 : Pétrograd
I
- Une croix de guerre avec palme a
été trouvée le 28 juin par un
soldat du 15e près du camp des Artilleurs.
La réclamer au Q.G. du C.A. (section du
courrier).
II - Un billet de banque a été
trouvé sur la route de Lacroix en Champagne
à St Rémy sur Bussy. Le
réclamer au Q.G. du C.A.
III - Le st Paul Boissaydes de la 2e Cie est
autorisé à adresser au colonel Ct le
143e une demande de permission de 8 jours.
IV - Demandes de tir de l'Artillerie du Groupe
Vésigné
rajouté
64e Brigade Etat Major
Au point de vue
spécial de la défense du secteur,
l'Artrie peut exécuter les genres de tir
suivants :
1° tir de barrage ; 2° tir de
demi-barrage ; 3° tir de représailles
sur telle ligne ou partie de ligne ennemie ;
4° tir de précision à
démolir sur tel ou tel objectif bien
défini.
Chacun de ces tirs a son effet particulier et
demande des dispositions qui augmentent le moment
de l'ouverture du feu et la consommation des
munitions.
Il est certain que les tirs de barrage ou de
demi-barrage sont beaucoup plus rapidement
exécutés qu'un tir de
précision (n° 4) qui
exige
certains
déplacements angulaires et certains
réglages. Il y a donc intérêt
dans un cas pressant, surtout la nuit, à
demander un tir de barrage ou de demi-barrage,
suivant la circonstance, avant tout autre tir. Le
tir de demi-barrage est préférable en
ce sens que, consommant moins de munitions, il peut
cependant être continu plus longtemps et
transformé en tir de barrage si c'est
nécessaire.
Ces prescriptions n'empêchent nullement les
chefs de corps lorsque le demi-barrage est
déclenché, de préciser les
points les plus dangereux et qu'il est
nécessaire de battre spécialement.
L'Artrie reporte alors son tir tout entier ou
partiel sur les points désignés et
répond ainsi à la demande faite, tout
en ayant fait bénéficier les troupes
de l'effet produit par le déclenchement d'un
bombardement immédiat.
Une cause de retard dans l'ouverture du feu de
l'Artillerie réside dans le mode de
transmission des demandes faites à cette
arme.
Le colonel
commandant la Brigade ne
saurait trop insister sur la
nécessité qu'il y a d'assurer d'une
façon parfaite tous les modes de liaison
avec cette arme.
En résumé : en temps habituel, en
particulier la nuit la demande initiale à
faire à l'Artrie sera la suivante : tir de
½ barrage sur telle partie de tel
secteur.
Signé
Moignan
Cette note intéresse
seulement le secteur A. Pour le secteur S, il y a
des conditions différentes, étant
donné que ce n'est pas la même
Artillerie qui tire sur ce secteur.
Signé
Henry
|
|
143e Régiment
d'Infanterie
Ordre du Régiment n°85
(Extrait du J.O. du 18 juin 1915)
Infanterie -
Promotions
Par
décision ministérielle en date du 13
juin 1915 et par application du décret du 2
janvier 1915, les promotions à titre
temporaire et pour la durée de la guerre
ci-après sont ratifiées :
Réserve
Au Grade de
Capitaine
M.M. Trolliet, Lieutenant au
56e d'Infanterie - passe au 143e à dater du
8 juin 1915
Chamboredon, Lieutenant au 143e - Maintenu à
dater du 8 juin 1915
Perrussot, Lieutenant au 89e d'Infanterie - passe
au 143e à dater du 8 juin 1915
Au Grade de
Lieutenant
M.M. Blanchecotte,
sous-lieutenant au 143e d'Infanterie - Maintenu
à dater du 8 juin 1915
Gossard, sous-lieutenant au 143e d'Infanterie -
Maintenu à dater du 8 juin 1915
Gobillard, sous-lieutenant au 143e d'Infanterie -
Maintenu à dater du 8 juin 1915
Masson, sous-lieutenant au 143e d'Infanterie -
Maintenu à dater du 8 juin 1915
Au Grade de
sous-lieutenant
M.M. Husson, adjudant au 143e
d'Infanterie - Maintenu à dater du 8 juin
1915
Chesnelong, aspirant au 143e d'Infanterie -
Maintenu à dater du 8 juin 1915
Teisseire, aspirant au 143e d'Infanterie - Maintenu
à dater du 8 juin 1915
Salomon, sergent au 143e d'Infanterie - Maintenu
à dater du 8 juin 1915
Dalleau, adjudant au 143e d'Infanterie - Maintenu
à dater du 8 juin 1915
Le 22-6-15
Le Lieutenant-Colonel Commmandant le 143e
d'Infanterie, Henry
|
|
|
Communiqué
la présente note (ajoutée comme avis
à ses propositions de ce jour) à
titre privé au Capitaine Perrussot qui
pourra la conserver.
Signé :
illisible
Propositions
approuvées
Le Capitaine
Commandant
provisoirement le 1er Bataillon
a l'honneur de demander en même temps que le
Capitaine Perrussot soit lui-même l'objet
d'une citation donnant droit à la croix de
guerre.
"Instituteur, ayant dépassé
l'âge de la libération des obligations
militaires, est venu volontairement dans les
troupes actives. Y est, par sa conviction, son
énergie et son calme, un objet d'admiration
pour ses camarades et ses inférieurs. Aussi
modeste que dévoué, s'efface
toujours, à l'heure des récompenses,
au profit de ses inférieurs auxquels il
donne le plus bel exemple à l'heure du
danger. Dans un secteur violemment bombardé,
ayant eu de lourdes pertes, a refusé de se
laisser relever, considérant comme un
honneur d'être en danger ; à
l'explosion d'un entonnoir ennemi, est
arrivé le premier sur la lèvre."
Le capitaine de St Fergeux, commandant le 1er
Bataillon
en l'absence du chef de Bataillon,
a l'honneur de faire respectueusement observer que
le chef de Bataillon
avait d'ailleurs proposé déjà
une fois le Capitaine Perrussot pour une
récompense. Le Capitaine Perrussot s'est
acquis, depuis, de nouveaux titres.
Signé :
illisible
|
|
|
2e
Cie
Heures des comptes-rendus écrits et
téléphoniques journaliers
Rendre compte téléphoniquement de
tout évènement important qui se passe
dans le secteur
5h15 - Compte rendu téléphonique des
évènements de la nuit
7h - Compte rendu écrit, très
détaillé, des travaux
exécutés la veille et pendant la
nuit
13h30 - Compte rendu des évènements
et pertes - Concours demandé à
l'artillerie
15h - Compte rendu des évènements
Concours demandé à l'artillerie
15h - Demande motivée et
détaillée des matériaux
nécessaires pour la journée et la
nuit du lendemain
Nota - Les heures
indiquées sont celles auxquelles doivent
parvenir les comptes rendus au P.C. du Chef de
Btn
Le 8 avril
1915
Signé Fargeon
|
|
|
Note du
Colonel
Dans
sa note 7.606, le Gal Cdt l'Armée prescrit
qu'on ne doit pas se contenter de former quelques
rares équipes de grenadiers par Btn ou Cie,
mais qu'on doit s'efforcer d'habituer le plus grand
nombre d'hommes possible au lancement d'un engin
dont les effets sont considérables dans la
guerre de tranchées.
Le colonel prescrit que, dans chaque Cie, le plus
grand nombre d'hommes possible soient
exercés au lancement de vraies grenades de
combat.
Les chefs de Btn mettront à profit leur
séjour à Somme-Suippes pour achever
cette instruction.
Ils rendront compte le 12 avril de ce qui aura
été fait. Ils feront la demande au Ct
du Génie à Somme-Suippes des engins
nécessaires.
Col.
Bertron
|
|
|
Note de
Service
Ce
soir, à partir de 21h, le 1er Btn
relèvera le 2e dans le secteur A. Les 2 Cies
du 1er Btn relevant la Cie du Centre (4e Cie), la
Cie de gauche (3e Cie) passeront par le boyau
Laurin. Les Cies relevant la Cie de droite (1re) et
la Cie de réserve (2e Cie) passeront par le
boyau Souligne. Des guides du 2e Btn seront rendus
à 2h30 à l'église du
Mesnil.
Les cantines, caisses à bagages, outils,
seront chargés pour 18h. Les conducteurs du
train de combat viendront atteler les voitures
à 20h30.
Le Médecin divisionnaire étant
passé ce matin au camp Bonnefoy a rendu
compte au commandement qu'il était dans un
état de saleté repoussante et que les
mesures élémentaires d'hygiène
n'étaient pas prises. M.M. les Cts de Cie
voudront bien faire faire cet après midi une
corvée très sérieuse de
nettoyage du camp et des feuillées. Les
excréments dans les feuillées doivent
toujours être recouverts de terre, à
défaut de chlorure de chaux qui n'a pas pu
être distribué. Les différents
déchets seront réunis et
brulés immédiatement en des points
tels qu'aucun danger d'incendie ne puisse
exister.
S'il y a des matières qui ne puissent
être brûlées, elles devront
être enterrées très
profondément. Le cantonnement lors du
départ qui aura lieu à 20h devra
être laissé dans le plus grand
état de propreté. Chaque Ct de Cie
fera placer sur les fronts qui correspondent
à leur bivouac un gradé de planton
chargé de veiller à ce que les hommes
se conforment aux règles d'hygiène
qu'il prescrira.
Chaque Ct de Cie enverra un s-off. rendu à
19h dans le secteur A pour prendre consigne du
matériel.
Le sergent Bergé de la 2e Cie sera rendu
à la même heure au P.C. du chef de Btn
A pour prendre la consigne du matériel.
Le Btn sera rassemblé au même
emplacement que la dernière fois et dans la
même formation à 19h40.
Ordre
de marche : 4 ; 3 ; 1,
2
Signé Ct
Demontier
|
|
143e Régiment
d'Infanterie
Félicitations
Le
Lieutenant-Colonel félicite la 2e Compagnie
de l'entrain et de l'activité qu'elle a
montrés pour l'organisation de l'entonnoir
du 5 août.
Il félicite en particulier Monsieur le
Capitaine Perrussot, l'adjudant Rodor, les caporaux
Soula et Souquet, les soldats Souby et
Martin.
Le 7-8-15
Le Lieutenant Colonel Commandant le 143e
Régt d'Infanterie, Henry
|
|
143e Régiment
d'Infanterie
Ordre du Régiment n°187
(Extrait de l'Ordre Général n°55
de la IIe Armée du 27-10-15)
Le
Général Commandant la IIe
Armée cite à l'ordre de
l'Armée :
Capitaine Massol,
François, Auguste du 143e Régt
d'Infanterie
"Officier d'une énergie et d'un courage
à toute épreuve, payant en toutes
circonstances de sa personne, blessé une
première fois le 2 novembre 1914 (Belgique),
a été de nouveau grièvement
blessé le 27 7bre 1915."
Lieutt-Colonel Henry
François, Guillaume du 143e Rt
d'Infanterie
"Chef de Corps froid et méthodique, payant
beaucoup de sa personne. A dirigé avec
compétence, pendant plus de 5 mois,
l'organisation d'un des secteurs les plus
exposés de notre ligne, et contribué
le 26 septembre 1915 par la manœuvre
exécutée par son régiment
à l'enlèvement d'un des points les
plus importants des positions ennemies."
Capitaine Perrussot,
Eugène, Henri du 143e Rt d'Infanterie
"S'est fait remarquer, depuis qu'il est au
régiment, par le soin et la méthode
avec lesquels il commande sa compagnie, pour
laquelle il est constamment un exemple de
sang-froid et de courage réfléchi. A
été remarquable par son attitude au
feu (27 7bre au 6 Octobre 1915)."
Capitaine Castel Armand du
143e Rt d'Infanterie
"A fait preuve de beaucoup d'énergie et
d'une magnifique bravoure en conduisant sa
compagnie au combat le 26 septembre 1915, faisant
une soixantaine de prisonniers et prenant une
mitrailleuse. Le 27 septembre 1915, a
été grièvement blessé
en entraînant de nouveau sa compagnie au
combat."
Lieutenant Vidal Pierre du
143e Rt d'Infanterie
"En campagne depuis le début de la guerre,
plein de courage, a le 26 septembre 1915 conduit
avec énergie sa compagnie à l'attaque
des positions ennemies, a fait une trentaine de
prisonniers et pris 3 mitrailleuses."
Sous-lieutenant Husson du
143e d'Infanterie
"Alors que son commandant de Cie venait
d'être tué, a entraîné le
27 septembre 1915 sa compagnie à l'attaque,
donnant ses ordres debout pour encourager ses
hommes. (Déjà cité à
l'ordre
de la
Division)"
Sous-lieutenant Porquet,
Pierre du 143e d'Infanterie
"Officier d'un entrain et d'un courage magnifique.
A été blessé 3 fois pendant
l'attaque, le 26 septembre 1915, en portant sa
section de mitrailleuses dans des positions
avancées et a néanmoins
continué à assurer son
service."
Sergent Dommanget Sion, Mle
9600 du 143e d'Infanterie
"A l'attaque du 6 octobre, son chef de section
étant tué, a pris le commandement de
sa section en prise à des violents feux de
front et de flanc. L'a maintenue sur place pendant
toute la journée. Il n'est rentré
dans les lignes que le soir, après avoir
reçu l'ordre, et en ramenant ses
blessés malgré le feu et les
appareils éclairants. Par son attitude au
feu, a su prendre, malgré sa jeunesse, un
grand empire sur ses hommes."
Caporal Chevalier, Marcel,
N° Mle 6053 du 143e d'Infanterie
"Atteint de 10 blessures pendant l'attaque du 6
octobre 1915, a fait preuve d'héroïsme,
ne songeant qu'à encourager ceux qui
l'entouraient."
Soldat Devals Sylvain Mle
7586 du 143e Rt d'Infanterie
"Le 26 septembre 1915, s'est offert pour assurer la
liaison en terrain découvert avec une
compagnie voisine, a accompli sa mission jusqu'au
bout malgré une blessure sérieuse,
refusant d'aller se faire panser avant d'avoir
rendu compte."
le 3-10-15
Le Lieutenant Colonel Commandant le 143e
Régt d'Infanterie, Henry
|
|
143e
Régiment d'Infanterie
Décision du 28 juin 1915
|
|
 etour
à l'accueil etour
à l'accueil
|

|
https://www.stleger.info
![]() ugène
ugène
![]() ARNET N°1
ARNET N°1![]() ugène
ugène
![]() ARNET N°1
ARNET N°1![]() obilisation
obilisation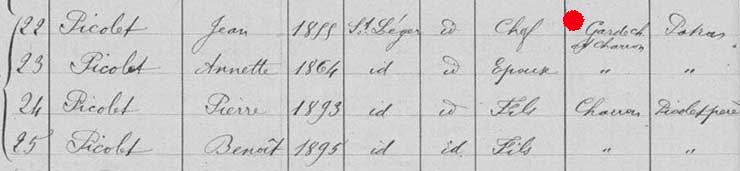
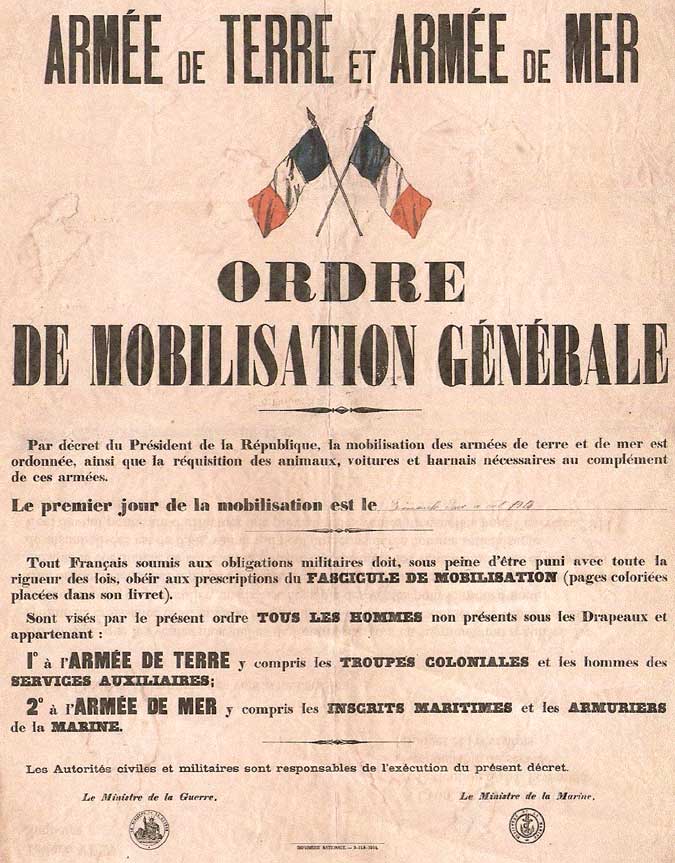
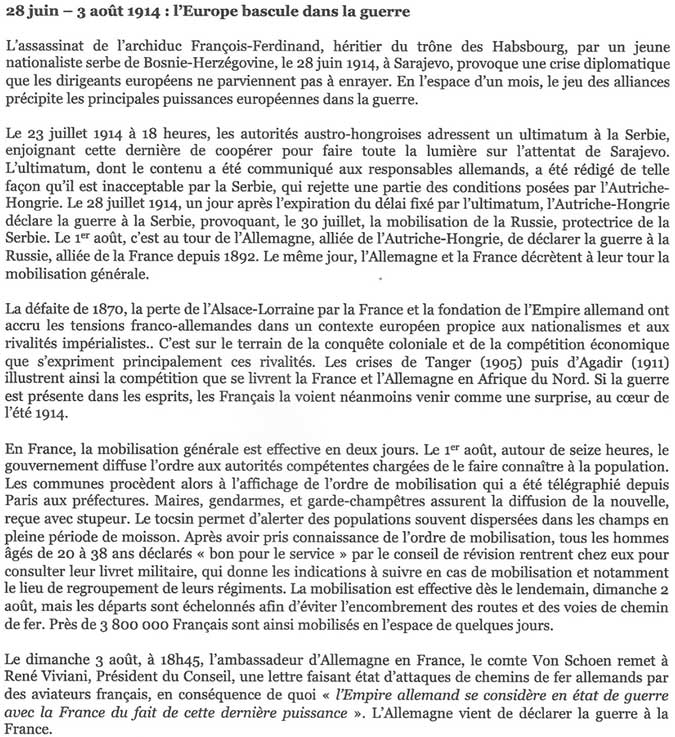

![]() épart
épart![]()
![]() artouches
artouches![]() iffleur
opportun
iffleur
opportun![]() remières
nouvelles
remières
nouvelles
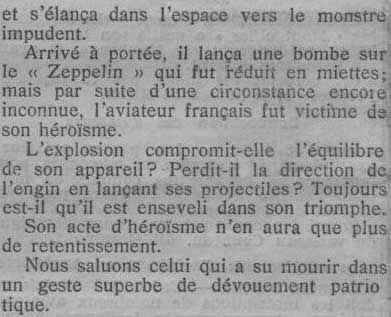

![]() remier
prisonnier
remier
prisonnier![]() ou
ou![]() épart
épart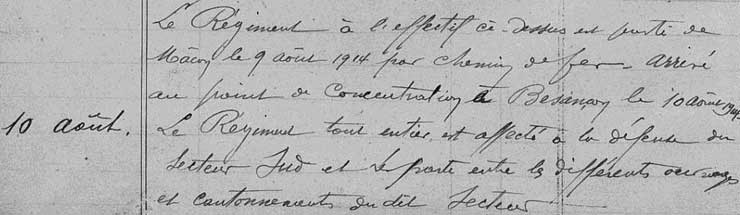
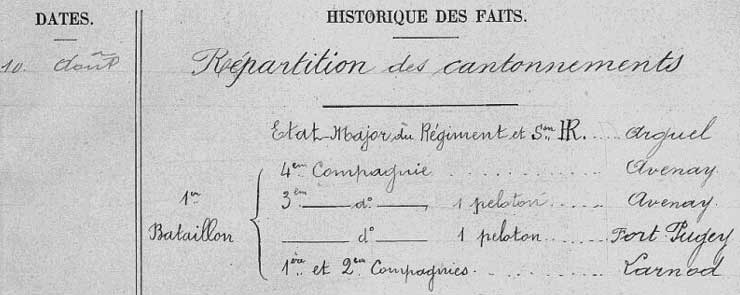


![]() apitaine
apitaine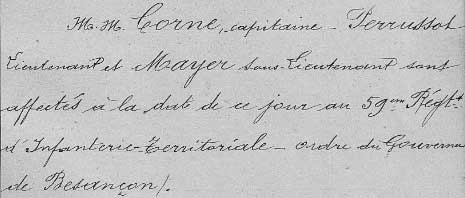
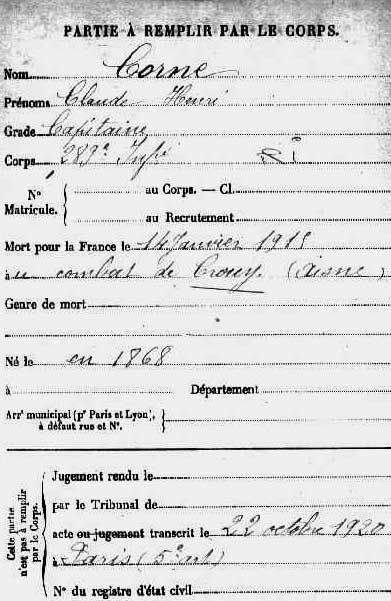
![]() uérite
uérite![]() vrogne
vrogne![]() ergent
de ma section
ergent
de ma section![]() ubergiste
en temps de guerre
ubergiste
en temps de guerre![]() rrivée
inopportune
rrivée
inopportune![]() olitesse
olitesse
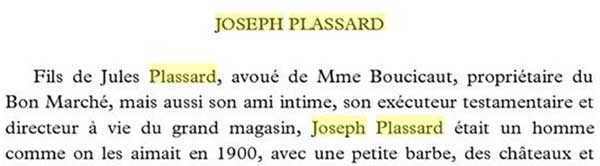
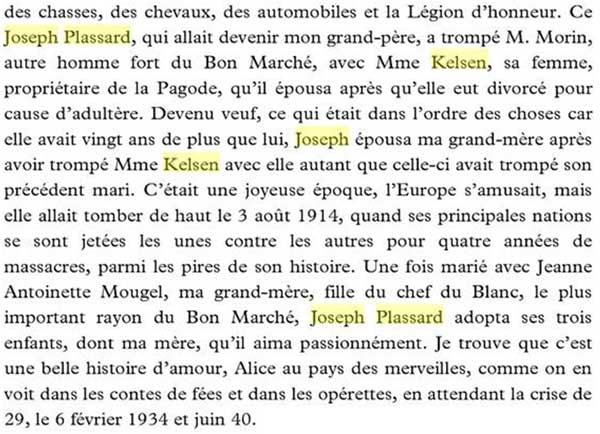
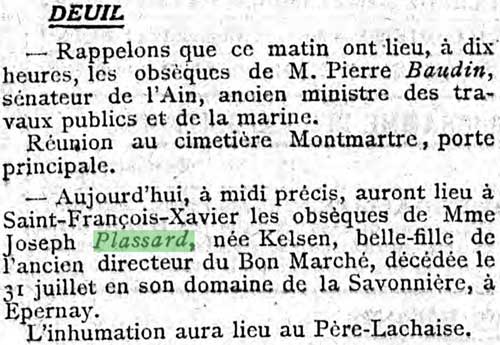
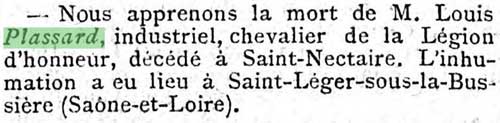
![]() épart
pour le front
épart
pour le front![]()
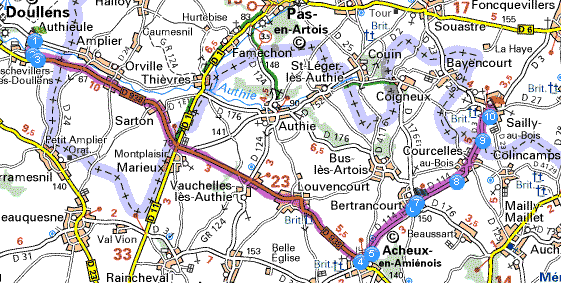
![]() etour
etour![]() oyage
manqué
oyage
manqué![]() otre
arrivée sur le front
otre
arrivée sur le front


![]() ttaque
de Vauquois
ttaque
de Vauquois![]() igne
igne
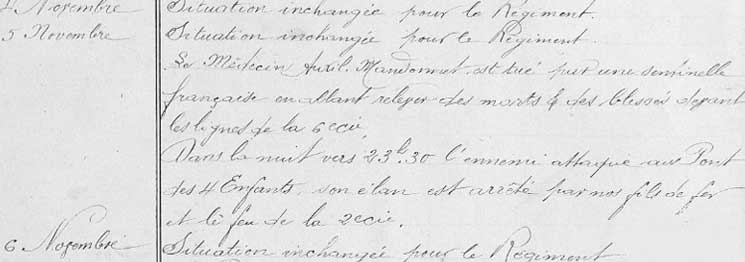
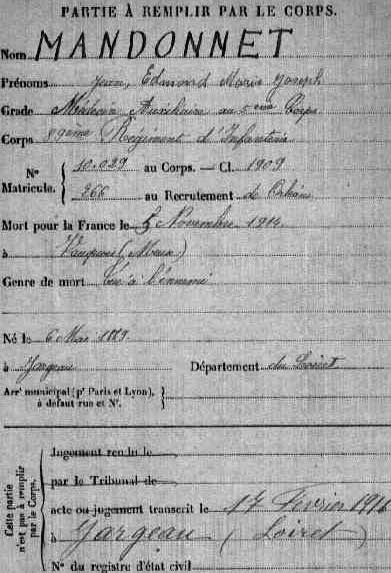
![]() uart
uart![]() ervice
ervice![]() lerte
lerte![]() elève
elève![]() u
cantonnement
u
cantonnement![]() ncendie
ncendie![]() iège
iège![]() rdre
bien donné
rdre
bien donné![]() eux
bons repas
eux
bons repas![]() remiers
abris à Neuvilly
remiers
abris à Neuvilly![]() aire
aire

![]() épôt
épôt![]() isite
isite![]() épart
brusqué pour le front
épart
brusqué pour le front![]()
![]() on
arrivée au 143e
on
arrivée au 143e![]() ombes
ombes![]() n
bon abri
n
bon abri![]() e
sous-lieutenant de ma Cie
e
sous-lieutenant de ma Cie![]() on
cher Gob...
on
cher Gob...![]() es
crapouilloteurs
es
crapouilloteurs![]() a
cote 196
a
cote 196![]() leues
leues![]() amp
de repos
amp
de repos![]() u
repos
u
repos![]() esquineries
et manigances
esquineries
et manigances![]() otre
colonel
otre
colonel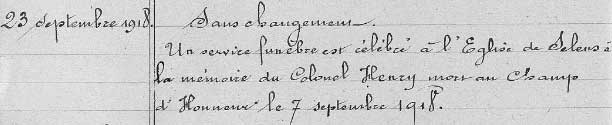
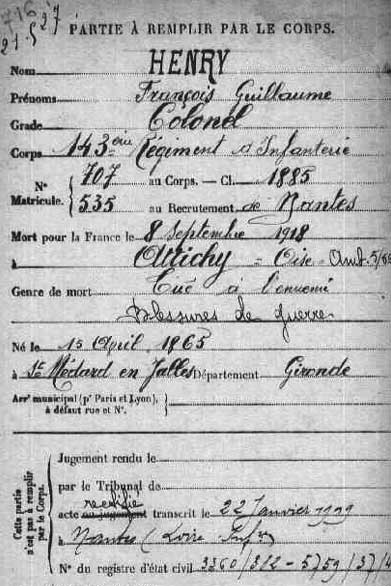

![]() djudant
Morin
djudant
Morin![]() eux
adjudants
eux
adjudants![]() xplosion
d'une mine
xplosion
d'une mine![]() nstallation
de l'entonnoir
nstallation
de l'entonnoir![]() fficiers
fficiers![]() énéral
Grossetti
énéral
Grossetti![]() e
village de Somme-Suippe
e
village de Somme-Suippe![]() andine
andine![]() rapèze
rapèze![]() ne
attaque
ne
attaque![]() etour
à l'accueil
etour
à l'accueil![]()