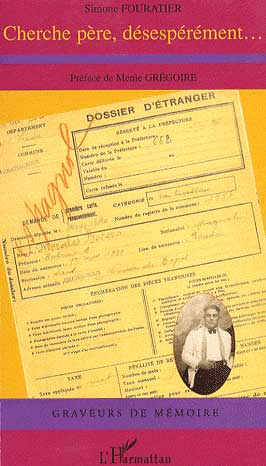|
l'exode des niños |
(...) A la gare de Dunkerque, notre petit groupe est dispersé. Un homme prend en charge chaque adolescent. Mon accompagnateur me fait monter dans un wagon. Durant le voyage nous causons. Je l'interroge sur ce qui m'attend. L'homme n'en sait rien. Il connaît juste ma destination, Saint Léger Vauban, dans l'Yonne, où il doit me remettre aux bons soins de monsieur le maire. La suite me sera probablement révélée par l'édile. Alors, pour passer le temps, on parle un peu politique, puis de l'Espagne et enfin de football.
 |
Antonio à 12 ans, avant son départ de Petite Synthe
À l'arrivée, cet homme me remet aux bons soins du docteur Chevillot, le maire. Quelqu'un me mène chez monsieur Chillane où je suis placé comme commis de ferme. C'est mon premier employeur. Je n'en garde pas un très bon souvenir. Ce monsieur est très rude à mon égard. Il se déclare bon catholique, mais il m'exploite sans vergogne. Je suis accablé de travail. Mes mains me font souffrir, elles se crevassent et sont boursouflées par le maniement d'outils très lourds, dont je n'ai aucune pratique. Mais je n'ai pas le temps de m'appesantir sur mes petites douleurs, il faut du rendement. Toujours houspillé, je trime du matin au soir, sans relâche. Malgré cela, les repas sont maigres. Le plus souvent, un œuf à la coque et un morceau de pain. Le soir, la dernière bouchée avalée, je cours à la grange où exténué, je m'affale sur un tas de paille, tout habillé. Le sommeil me prend à la minute même où je m'abandonne. Petite Synthe et son confort sont bien loin.
Cet homme porte ses contradictions, haut et
fort. Le profond dédain qu'il me manifeste, il le justifie en
disant à qui veut l'entendre :
"C'est le fils d'un
communiste ; il ne mérite pas autre chose que le
mépris."
À mon âge, que puis-je
répliquer ? Je prends conscience des désaccords dans
les prises de positions politiques. Porté aux nues par les
uns, le communiste est vomi par les autres.
Peut-être un bon mois plus tard, ma condition m'a fait perdre la notion du temps, taraudé par la faim et la fatigue, je mobilise le peu d'énergie qui me reste et, mon baluchon sur l'épaule, je prends mes jambes à mon cou ; c'est décidé je quitte les Chillane.
Comme je ne connais personne d'autre au
village, je vais trouver monsieur le maire. Je suis un peu
intimidé, mais résolu. Plus que les mots, ma
présentation en dit long sur ma situation. À part le
museau et les mains, je n'ai pas fait, une seule fois, ma toilette
depuis mon arrivée. Je ne peux demeurer plus longtemps chez
ces personnes-là. Monsieur le maire hoche la tête,
grommelle des paroles inintelligibles et hèle quelqu'un. On me
conduit chez monsieur Grandet, boulanger-pâtissier. Cette
destination me réjouit. Je me vois déjà, mordant
de bon cœur, dans de tendres miches de pain. Hélas, j'en
serai quitte pour saliver, le reste ne suivra pas. Là aussi,
on m'exploite, sans même me nourrir en suffisance ! Je
travaille dur et les journées sont longues. Elles se terminent
très tard et commencent très tôt. Les repas sont
chiches et le pain, qui pourtant ne manque pas, est compté. La
femme du boulanger a un caractère difficile et n'est pas
très tendre avec moi. Lassé de mon état et
toujours affamé, j'en suis à me demander si je ne vais
pas retourner voir le maire, quand un homme vient me voir. Je ne le
connais pas. Il m'entraîne à l'écart pour me
parler. Il me dit qu'à la ferme Rébrotte où il
travaille, on cherche un petit garçon comme moi.
J'écoute la présentation qu'il me fait de la vie dans
cette ferme. Une seule chose m'intéresse : mange-t-il à
sa faim ? Pour ça je suis prêt à tout.
"Oh ! Pas de
problème, on mange bien." me
rassure-t-il.
Qu'ai-je à redouter de pire, de ce que je viens de vivre ces
derniers mois ? Alors, allons-y. Pour conclure le transfert ! Je
laisse l'ouvrage et me rends chez les Rébrotte. Je redoute le
courroux de mes employeurs, mais tant pis. Roger, mon visiteur, me
présente au patron. Je lui vante mes récents
savoir-faire, et il m'engage de suite. Je retourne chez les Grandet
et leur annonce mon départ. Ça crie à
l'ingratitude, au va-nu-pieds qu'on recueille par charité, que
sais-je encore ? Les mots se diluent, tandis que je ramasse mon
baluchon et m'éloigne sans me retourner...
La ferme Rébrotte est située entre l'étang du Roi et le hameau de Trinquelin. Elle est grande. Il y a une dizaine d'employés dans cette exploitation ; tous sont adultes. Le contact avec eux est facile et amical. Enfin un peu d'humanité ! Le travail ne manque pas au domaine, mais les heures de repos sont plus importantes, et surtout nous sommes bien nourris. J'avais si faim ! J'en suis soulagé ; mon sort s'améliore. Les lourds travaux auxquels je suis confronté depuis mon arrivée à Saint Léger Vauban, m'ont endurci. Je supporte mieux mes petites misères. L'ambiance est bonne à la ferme, les patrons aimables et les ouvriers me traitent en copains. Assez souvent, il y a des moments de franches rigolades. Cela me fait du bien et me relâche un peu. Cependant, fourbu, je les laisse souvent à leurs rires et me couche. Comme mes compagnons, je dors dans la paille et je reste habillé pour lutter contre le froid. J'ai deux couvertures, trop minces pour être vraiment efficaces, mais "bien enroulé dedans, ça fait l'affaire" m'a-t-on affirmé. Où sont le confort et l'insouciance de Petite Synthe ? Je n'ai pas le loisir de m'y attarder, terrassé par la fatigue, je sombre chaque soir dans un sommeil de plomb.
 |
Antonio en militaire, à 16 ans probablement, après son incorporation, à son retour de France
Au printemps 1939 de bon matin, je rencontre
un homme qui me salue et dit :
Ça va, mon
garçon ?
- Ça va M'sieur.
- Que fais-tu à la ferme Rébrotte ? Ça te
plaît ?
- Pour ce qui est du travail, oui, ça me plait ; j'aime les
bêtes et les travaux de la ferme.
Il faut dire que je me suis
habitué. À mon arrivée chez les Chillane, j'ai
beaucoup souffert des mains : ampoules à vif qui
s'infectaient, crevasses et engelures. Des pieds aussi. Depuis des
callosités se sont formées et je supporte mieux les
durs travaux. J'hésite un peu à lui en dire plus, mais
je suis encouragé par un regard doux et bienveillant.
- Ce qui me manque
le plus chez les Rébrotte, c'est l'hygiène. On ne peut
se laver, qu'à la pompe, dans la cour, (ce
qui excluait de me laver les parties intimes, mais ça, je n'ai
pas osé le dire) et
l'hiver comme l'eau est gelée…"
Puis-je dire que je n'ai plus porté un pyjama depuis Petite
Synthe ? Que j'ai toujours froid, même si je m'y accoutume, et
qu'il m'est difficile, pour ne pas dire impossible, de changer de
linge ?
Cet homme se montre sensible à mes dernières paroles. Il veut savoir où je couche et comment. Devine-t-il ce que je lui ai tu ? Il est vrai que je suis dans un piteux état. Quasi en haillons, et très, très sale. Je ne dois pas sentir très bon non plus. Si papa me voyait !
Mon interlocuteur continue à
s'inquiéter de moi, sa sollicitude me touche. Il me rappelle
le bon docteur Serrano. Le même regard bienveillant
m'interroge. C'est la première fois depuis que je suis ici
qu'on s'intéresse vraiment à moi. Après m'avoir
gentiment questionné, il me dit :
"Je m'appelle
Hippolyte Guyard, j'habite Trinquelin à quelques
kilomètres d'ici, où j'ai une ferme. Je vis avec ma
femme et mon fils. Si tu veux, tu peux venir chez moi, tu seras bien
traité et tu auras tout ce qui te manque ici.
Les douces paroles ! Je balbutie :
- Je veux
bien." la gorge nouée par
l'émotion. Qu'est-ce qui me prend ? Je ne vais tout de
même pas me mettre à pleurer. Nous convenons que
Monsieur Guyard viendra me chercher après le déjeuner.
Son regard amical se pose sur moi avec douceur, Mon visage
s'empourpre. Il y a bien longtemps que je n'ai pas été
regardé de cette manière-là. Pourquoi ces
sensibleries tout à coup ? Je les ravale, échange
encore une chaleureuse poignée de main, et m'éloigne
à grandes enjambées, honteux de ma faiblesse.
Après le déjeuner je m'explique avec les Rébrotte qui regrettent mon départ. Je serre la main des copains, prends mon baluchon et pars. J'ai le cœur confiant mêlé d'une pointe d'inquiétude, me suis-je laissé abuser ?
Me voilà dans la cuisine de la
famille Guyard, un peu intimidé. La maîtresse de maison
me sourit et me lance d'une voix forte :
"Bienvenue chez nous
mon garçon !
Et joignant le geste à la
parole, elle me plaque deux gros baisers chaleureux sur les joues.
Elle s'appelle Céline. Ce prénom, si doux à mon
cœur, ajoute à l'accueil. Raymond, le fils, un grand qui
doit avoir au moins vingt ans, me donne une vigoureuse poignée
de main :
- Content de
t'accueillir à la ferme."
Et moi d'être là. Je ne
l'ai pas dit, mais je le pense avec conviction. Ces gens-là
m'inspirent confiance. À l'issue de cette première
journée, je saurai que je suis enfin bien tombé. Pour
occuper l'après-midi, je commence par bêcher le jardin.
Je sais le faire, et m'en acquitte sans peine. Ensuite, je pars aux
labours. Hippolyte tient fermement la charrue, tirée par le
cheval. À sa suite, Raymond sème. Je ferme la marche
avec la herse, aux pas lents d'un couple de bœufs. Je ne dis pas
que j'ai su tout de suite maîtriser l'attelage, ni la
manœuvre pour tourner au bout du champ, mais j'ai vite appris.
Ça me plaît ces activités paysannes ! La
glèbe ensemencée, je reviens au jardin où je
continue à préparer la terre pour les semailles de
printemps. Je bêche, ramasse les feuilles mortes, nettoie les
allées…
J'œuvre et me dépense sans compter jusqu'à l'heure de la soupe. Je veux exprimer à ces gens-là que j'apprécie leur accueil et veux m'en montrer digne. Monsieur Guyard se montre surpris par mon travail et mon zèle. Il m'en fait compliment. Un fait rare ces derniers mois.
Nous voici tous réunis autour de la table. La fermière nous sert une soupe au lait. Oh ! là, là, délicieuse ! Elle est suivie d'une copieuse omelette aux pommes de terre, de fromage, noix et pommes. Je renoue avec la bonne cuisine et l'abondance, je suis comblé.
Après le souper, madame Guyard me dit
qu'elle me prépare de quoi me laver. "Enfin
!" pensais-je. Où ? Dans
l'étable. Il y fait doux, les bêtes par leur
présence ont réchauffé l'endroit. Raymond a
installé un grand baquet de bois qu'il remplit d'eau bien
chaude. Puis, il me laisse seul. Le délice de me fondre dans
cette matrice accueillante. J'y oublie mon corps un long moment, tout
à la bienfaisante chaleur et à la détente.
Après un bon savonnage, rosé à point, les
cheveux coiffés et vêtu de linge propre qu'on m'a
dégoté, me voilà de retour à la cuisine.
J'y suis accueilli par un concert de compliments :
"Quel beau
garçon !… Mazette… ! Tu es superbe…
!" Je renais à
moi-même.
La maison n'a qu'une grande chambre, meublée de deux belles armoires en vis-à-vis, avec chacune un lit sur leur gauche et sur leur droite. Une table et des chaises complètent l'ameublement au centre de la pièce. Mon lit est près de celui de Raymond. Les époux Guyard dorment en face. Me glisser dans des draps qui sentent bon le propre et retrouver le confort d'un lit douillet est une nouvelle félicité.
Le lendemain, le petit déjeuner
ressemble, pots pour pots de confiture, à ceux de Petite
Synthe. J'en retrouve les saveurs avec avidité et gourmandise.
Après une matinée passée au jardin à
faire les premiers semis avec Hippolyte, me voici de nouveau
fourchette et couteau en main devant une terrine maison du plus bel
aspect, suivi d'un savoureux bœuf bourguignon, de salade, de
fromage, et d'une tarte aux pommes. Le père Hippolyte pousse
les plats devant moi :
"Mange, mon
garçon, mange !"
Je ne me fais pas prier. Ah ! Renouer avec le plaisir de bien manger ! Quelle différence avec la cuisine sans grâce de la ferme Rébrotte. Soupe au pain à tous les repas, y compris au petit déjeuner. A midi cette soupe était suivie de ragoûts, à la viande rare, mais qui ne manquaient pas de pommes de terre. Le soir, l'assiettée était complétée de lard ou de fromage et pain. Rarement de fruits. Ces repas étaient lourds, et peu savoureux, mais au moins, je mangeais à ma faim.
Les époux Guyard ont tenu ce qu'ils promettaient. Je suis propre, bien habillé et chaudement vêtu. L'hiver venu, je porte des moufles, un passe-montagne pour remplacer le béret de Petite Synthe qui ne m'a pas quitté, de gros bas de laine et suis chaussé de sabots. Sous mes yeux attentifs et surpris, Hippolyte, avec beaucoup de dextérité, les a tirés d'une pièce de bois que je croyais destinée à brûler. La métamorphose me va bien aux pieds et me les tient au sec et au chaud. Certes, au début j'en ai été un peu embarrassé pour marcher, mais le rodage a été rapide. Adieu les engelures qui, l'hiver précédent, m'ont tant fait souffrir !
Quant à la nourriture, elle ne se dément pas, elle est délicieuse et abondante. Pour ce qui est de la santé, je suis soigné au moindre bobo ! De plus, le père Guyard me donne chaque mois cent francs ! Je crois que c'était beaucoup d'argent pour l'époque et c'est certain, une vraie fortune pour moi. Il est le seul employeur qui m'ait payé. Je dépense cet argent en achats de livres. Si je ne vais plus en classe, j'approfondis ma culture littéraire avec Zola, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Jules Verne, Balzac, La Fontaine, Daudet, Proust… et tant d'autres.
À tous ces bonheurs, s'en ajoute un
plus grand encore : ce couple me traite comme leur fils. Raymond n'en
prend pas ombrage, il se comporte en grand frère. Tous les
trois me font oublier ce que j'ai connu à mon arrivée
dans le pays. Jamais je n'ai reçu d'ordre brutal ou
impératif, mais toujours : "Voudrais-tu...
; peux-tu faire, ceci ou cela…"
Et par-dessus tout, ils me donnent leur affection ! La mère
Céline m'embrasse comme du bon pain et veille à mon
confort. Elle coud mes vêtements, bassine mon lit dès
les premiers froids, me régale de confitures et de bons petits
plats. Le père Hippolyte est doux avec moi et m'enseigne tout
ce qu'il sait. Et il en connaît des choses ! Son savoir est
très différent de ce que j'apprenais en cours, mais il
ne manque pas d'intérêt. Raymond est gentil et attentif.
Je suis vraiment très heureux. Moi, le déraciné,
l'orphelin sans nouvelles de mes parents, séparé d'eux
depuis ce terrible jour de décembre 1936, j'ai retrouvé
la chaleur d'un foyer. L'affectueuse et attentive présence
dont je suis entouré me console des pincements au cœur
que j'ai souvent le soir, lorsque chacun dans notre lit, j'entends
Raymond dire :
"Bonsoir maman,
bonsoir papa."
Au fil des jours, j'ai moi aussi fini par les appeler maman et papa
Guyard, et de concert avec Raymond, je leur dis le même
chaleureux et reconnaissant :
"Bonsoir maman,
bonsoir papa."
Je suis devenu costaud. Aucun travail ne me rebute. Scier, fendre le bois, ramasser les pommes de terre, planter, semer, racler, battre le blé…. Je sais manier la faucille et faire les gerbes, faucher, couper les haies et les branches, et aussi curer les étables, laver, brosser les vaches et les traire. J'accomplis mes tâches comme un jeu, et y prends grand plaisir.
Tout à la ferme est événement et découverte : les foins à rentrer, la batteuse, tuer le cochon (ma sensibilité en a beaucoup souffert) et jusqu'à la naissance assistée d'un petit veau ; une vraie surprise et une grosse émotion. La maman est touchante de sollicitude pour son nouveau-né. Je viens souvent auprès d'elle pour observer leur relation. D'autres naissances ont suivi… Toutes ces nouvelles vies qu'il faut nourrir et choyer, sont source de formation et d'émerveillement…
S'y ajoute une curiosité à laquelle Hippolyte me rend attentif : observer Dame Nature au travail, lorsqu'elle fait bourgeonner les arbres, pousser les carottes et s'épanouir les grains de blé… J'apprends à la connaître et à travailler avec ses lunes. Je me découvre une vraie passion pour la terre !
C'est ainsi que les jours et les mois
passent, au rythme lent des saisons. Nos travaux les accompagnent,
dans une succession de tâches coutumières et
sacrées. J'en ai bavé au début chez les
Chillane, Grandet, et autre Rébrotte. M'adapter à la
vie paysanne n'a pas été facile, j'y étais si
peu préparé. Cependant, petit à petit je me suis
approprié tous les gestes quotidiens du fermier. La famille
Guyard, au fil des jours, m'en a livré le sens profond. Et
quand Papa Hyppolite lance avec un grand rire :
"La terre, c'est
comme une femme ; pour qu'elle soit féconde, faut l'aimer et
la traiter avec respect."
Pour la femme je ne peux rien dire,
mais pour la terre, mes observations m'incitent à croire qu'il
a bien raison.
Fondu dans cette vie simple et parfois rude, loin, très loin
des périls endurés par ma famille en Espagne, je
goûte ici un bonheur paisible. Fils d'un intellectuel
obstiné qui m'avait inculqué avec beaucoup de rigueur,
d'intransigeance et de taloches le désir d'en être un
à mon tour, contre toute attente paternelle, je suis devenu un
vrai petit paysan, heureux et fier de l'être.
Je n'ai pas de nouvelles de mes parents,
depuis mon départ de Petite Synthe. Les deux dernières
lettres de mon père que j'ai reçues là-bas,
m'ont beaucoup intrigué. Il écrivait :
"Si tu dois rentrer
en Espagne par tes propres moyens, ton nom est Alvarez Martin et non
Morales Martin, comme tu t'es toujours appelé."
Pourquoi ? Papa n'en disait rien.
Dans une lettre en retour, je lui ai posé la question. Sa
réponse a été brève et lapidaire :
"La situation
actuelle ne permet pas d'échanges d'information, il faut t'en
tenir à ce que je t'ai dit."
Ce refus a été déconcertant et m'a laissé
perplexe. Faute de mieux, je l'ai rangé dans un coin de ma
mémoire en attendant que l'injonction s'éclaircisse. Au
maire du village, j'ai été présenté sous
mon nom habituel.
|
les parents d'Antonio |
Peu de temps après mon installation
chez les Guyard (avant c'était impossible), je m'empresse
d'écrire plusieurs lettres à mes parents pour les
rassurer. Je ne reçois aucune réponse, et ce silence
m'inquiète. Je demande à Papa Guyard s'il a des
informations sur ce qui se passe dans mon pays. Il évite de me
répondre et paraît embarrassé. Pourquoi ?
"T'en fais pas mon
garçon, t'en fais pas, quand un pays est en guerre, les
Postes, ça ne marche plus ! Les gars sont au front, pas au tri
de courrier !"
Mais son argument ne fait qu'accentuer mon trouble. Nous avions bien reçu des lettres à Petite Synthe ; alors, que comprendre ? Qu'est-ce qui pourrait empêcher mes parents de répondre ? Ces questions me taraudent et réveillent de vieilles peurs. Cela décide Hippolyte à me lâcher quelques bribes d'informations. Et c'est ainsi que j'apprends, incrédule, la fin de la guerre dans mon pays. La République a capitulé en février dernier (1939) et contraint des milliers d'Espagnols à fuir en France...
La nouvelle est effrayante. Que sont devenus mes parents ? Sont-ils morts ? Ont-ils fui eux aussi ? Comment nous retrouver s'ils ont passé la frontière ? Je me sens perdu et ne peux contenir mes larmes…
J'apprends aussi qu'en France, le ciel politique s'assombrit et la guerre menace. J'écris à mes sœurs pour me rassurer sur leur sort. En retour, je reçois une lettre du directeur, le docteur Serrano, qui m'apprend qu'elles se trouvent à Merlimont-Plage (sans m'en préciser l'adresse) "dans un lieu de soins très agréable" précise-t-il. Isabel y est soignée depuis quelque temps pour manque d'appétit. Ses repas sont placés sous haute surveillance et on la stimule avec des vitamines. Elle est astreinte à des séances de chaise longue au soleil, pendant que Provi joue dans l'établissement. Bien entendu, elles ont fait des pieds et des mains pour ne pas être séparées et elles ont réussi. J'en suis heureux ; les savoir ensemble me rassure. Elles ne vont pas tarder à m'écrire, ajoute mon correspondant, car le séjour à Merlimont se termine. Toujours attentionné, le bon docteur s'informe de mon séjour et me transmet le bon souvenir qu'il garde de moi. Cette lecture me touche et me rassure. Mes sœurs sont ensemble et bientôt de retour à Petite Synthe.
Un mois passe, puis deux, puis trois…
Je ne reçois aucune lettre. Ni de mes parents, ni de mes
sœurs. J'écris de nouveau à Isabel et Provi. Au
dos du courrier, je mets cette fois mon nom et mon adresse. Comme il
en a été pour moi, l'agitation politique
française pourrait avoir motivé un changement de
lieu.
Cela a pris du temps, mais le pli m'est revenu. Quelqu'un a
écrit sur l'enveloppe : "l'établissement
est fermé." Ça m'a
fait un choc. Elles sont parties et je ne sais même pas
où ? Comment le savoir ? J'en discute avec Papa Hippolyte qui
se montre confiant :
"Puisque la guerre
est finie en Espagne, elles sont peut-être rentrées au
pays ?"
Cette perspective me paraît rassurante, mais alors pourquoi n'est-on pas venu me chercher ? Ont-elles pu rejoindre nos parents ? Si la guerre est finie pourquoi n'ai-je pas de leurs nouvelles ? Et s'ils étaient morts ? Où iraient mes sœurs toutes seules en Espagne ? Toutes ces interrogations ont broyé mon fragile bonheur, l'anxiété m'empoigne.
Les adultes autour de moi sont eux aussi très inquiets, ils redoutent le pire. Les époux Guyard, le nez dans le journal et l'oreille aux aguets, guettent et commentent les nouvelles. Elles n'apportent rien qui soit propre à dissiper leurs craintes ; l'horizon se charge de sombres présages. Pour les oublier, je m'acharne à la besogne et puise réconfort dans l'affection chaude que je reçois chez nous.
En vain !
L'annonce de la déclaration de guerre
de la France et l'Angleterre, à l'Allemagne, le 3 septembre
1939, consomme ce qui me reste de bonheur. La guerre, je ne la
connais que trop. La peur me saisit avec violence. Tout ce que j'ai
oublié du fléau espagnol me revient en mémoire :
les courses éperdues sous l'éclatement des bombes,
l'attente interminable dans les abris, les cris, les
hurlements…. Maman Céline, devant mon visage blême,
me prend dans ses bras et me donne un gros baiser. Hippolyte tente de
me rassurer :
"Ici, nous ne
craignons rien, le front est loin."
J'ai très envie de le croire, mais je suis paniqué. J'ai goûté aux affres de la guerre, et sais très bien qu'aucun lieu n'est sûr. Où puiser de l'espérance ? Dans l'attente de retrouver mes parents et mes sœurs, je ne veux pas que ma vie change, je veux rester là, auprès de ces gens que j'aime et qui me le rendent bien. Je file à l'étable et y pleure tout mon saoul...
Presque tous les hommes valides sont mobilisés. Je les vois partir en grappes, au fur et à mesure du rappel des classes. Raymond, lui aussi, nous quitte. C'est à mon tour de sécher les larmes de maman Céline. Elle contient son chagrin aussi longtemps que son fils est présent, mais quand l'autobus l'emporte, les vannes s'ouvrent. Sans grand succès, je tente de la consoler. Les jours suivants, je redouble d'ardeur au travail pour compenser l'absence de Raymond et vaincre ma détresse.
L'oreille collée au poste TSF que
papa Hippolyte a acheté en la circonstance, nous quêtons
l'information.
Que devient notre soldat, incorporé dans la division de fer ?
Rongés d'inquiétude pour Raymond, chaque jour nous
commentons les nouvelles et redoutons les combats auxquels il est
exposé. La guerre se rappelle à moi avec force. Je
guette aussi ce qui se dit sur l'Espagne… Bien peu de choses,
hélas !
Les époux Guyard, pourtant soucieux
pour leur fils, s'efforcent de se montrer rassurants quand ils
parlent avec moi. Hippolyte répète souvent :
"Quand le pire est
passé, le meilleur est à venir."
Oui, mais le pire est-il atteint ?
Sur quelle pente sommes-nous ? Qui répondra à ces
questions ?
Malgré les incertitudes de la guerre, je reste heureux de vaquer aux travaux de la ferme, de m'occuper des bêtes, et de vivre les petits et grands évènements de la vie paysanne…
 |
Antonio avec sa fiancée, bien des années plus tard
Jusqu'à ce 5 juin 1940…
Stupeur !
Les Allemands sont passés à
l'offensive sur la Somme ! Ils avancent et la situation devient
très dangereuse pour les civils. C'est l'affolement et la
consternation autour de nous et chez nous. Les voisins viennent nous
visiter. Que faire ? Les avis divergent. Hippolyte invite chacun au
calme et à observer ce qui va suivre.
L'inquiétude me tient aux tripes.
Les communiqués entendus sont confus.
Pourtant, nous tentons de comprendre comment avance l'invasion
allemande et si le danger se rapproche. La voix nasillarde à
la TSF annonce :
"... Paris est
déclarée ville ouverte par le gouvernement..."
Ouverte à quoi ? A qui ? Je
n'ai pas de réponse, Papa et maman Guyard non plus. On entend
encore :
"… le
cessez-le-feu est refusé par le
Général…"
J'ai oublié son nom. Je ne comprends pas pourquoi certains
veulent poursuivre la guerre et d'autres la terminer. Moi je veux que
ça s'arrête ! De toute ma volonté tendue je le
veux… ! Je le veux… ! Assez de bombes, assez de morts,
assez de familles éclatées ! Assez aussi d'avoir peur,
d'avoir faim et assez de tout ce qui accompagne la guerre dont je ne
veux plus me souvenir ; assez ! Rendez-moi mes parents, mes
sœurs, mon pays et laissez-nous vivre en Paix …!!! Rendez
le cher Raymond à ses père et mère. Que tout
cela s'arrête ! Submergé par la douleur, je cours
à l'étable et pleure, pleure…
Un autre jour, le crachouillis de la TSF
révèle :
"…des batailles
de chars à Champaubert et Mondement…"
Personne ne sait où ça
se trouve. À défaut d'encyclopédie, je cherche
sur le calendrier des Postes, sans trouver. Même le vieux livre
de géographie de Raymond n'a su me donner la réponse.
Nous nageons en pleine incompréhension. Malgré cela, il
n'échappe à personne que la situation est très
grave, et ne va pas en s'améliorant !
C'est le garde champêtre qui met fin
à nos incertitudes. À grand renfort de roulements de
tambour, il annonce aux villageois ébahis, que les Allemands
occupent Paris et que l'avancée va certainement continuer.
Accouru comme les autres, je suis écrasé par la
nouvelle. Tous, autour de moi sont consternés. La panique me
prend, instantanément. Le garde se tourne vers moi et me dit
:
"Toi, le petit
Espagnol, t'as intérêt à filer, car si les
Allemands te prennent, couic !
Et il a fait du doigt le geste de se
trancher la gorge.
Je fais un volte-face et cours rejoindre papa Guyard. J'ai du mal
à parler tant l'émotion m'étouffe. Au
récit des propos du garde, Hippolyte hoche la tête et
dit :
- Il a raison, mon
garçon, il faut te sauver. Me
sauver ?
- Je ne peux pas, où vais-je aller tout seul ?
Papa Guyard tente de me faire
comprendre que je n'ai pas le choix, qu'il me faut partir
sur-le-champ.
- Mais où
veux-tu que j'aille ?
- Vas vers le Sud mon garçon, et cherche à rentrer en
Espagne."
Quel cauchemar !
L'angoisse me tétanise. En
hâte, maman Céline, muette de saisissement, met quelques
victuailles dans un carton pendant qu'Hippolyte court à la
grange chercher le vélo. Il le gonfle avec soin et ficelle sur
le porte-bagages le paquet que Céline lui tend. Ce vélo
a été une source de plaisir intense, et aucun chemin
n'a échappé à mes coups de pédales
vigoureux. Le voilà futur compagnon de ma misère,
après avoir été celui de ma joie. L'un
après l'autre, mes chers parents adoptifs me serrent sur leur
cœur et me couvrent de baisers. Papa me recommande
d'éviter les routes nationales, et pour commencer, de me
diriger vers Château-Chinon. Je connais cette route. Maman me
dit de bien faire attention à moi.
"Et vous, que
va-t-il se passer avec les Allemands si vous restez ici ?
- Des vieux comme nous, cela ne les intéresse pas !
dit Hippolyte en me donnant une
bourrade affectueuse :
- Va !
Mais au premier coup de
pédale, il me retient :
- Attends !
Il se précipite dans la
maison et en revient quelques secondes plus tard avec sa montre qu'il
m'attache au poignet.
- C'est à
toi. Tu es un homme maintenant. Tu vas devoir te débrouiller
tout seul (silence)…
et tu vas y arriver."
J'enfourche la bicyclette et sur un dernier signe d'encouragement me voilà parti, sans me retourner.
Je hais ce départ. Cet arrachement encore une fois ! Mon cœur n'est plus assez fort pour contenir le chagrin qui le déchire. En un instant ma vie vient de basculer. Je pédale avec rage, le visage noyé de larmes… Je veux bien être un homme, mais je trouve le rite de passage, brutal et cruel.
Et si homme il y a, il est bien seul et désemparé en ce triste 14 juin 1940 où j'entre, seul, dans mon troisième exode, à tout juste quinze ans. Je me serai bien passé de ce parcours-là. Me voilà encore plus insécurisé que pour les deux premiers. Personne pour me conduire, me dire que faire et où aller. Je suis en chemise, le béret de Petite Synthe bien vissé sur ma tête, sans bagages, livré à moi-même. Mes chers livres sont restés sur l'étagère, mon enfance avec. C'est ça, être un homme ? (...)
Antonio et sa femme Incarnacion " (...)
C'est un bel homme, très élégant :
chemise blanche, veste blanche sur pantalon sombre. Noeud
papillon et écharpe légère. Une main
négligemment dans la poche, l'autre sur la boucle de
sa ceinture. Sérieux. Le visage est
séduisant, et les cheveux bouclés (...)
|
la préface de
Menie la quête de
Simone le récit
d'Antonio
![]()
![]()
![]()
Sinon, merci de fermer l'agrandissement.